|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Avertissement :
Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-Pierre Bartolini.
Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m'adresser une demande écrite par lettre ou par mel.
Merci.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
253, 254,
255, 256, 257,
258, 259, 260,
261, 262,
| |
C'est la Rentrée
Chers Amies, Chers Amis,
Je vous retrouve, après une longue pause informatique estivale, très pris par ailleurs, sur une assez longue durée, puis des petits tours par-ci et par-là en fonction de mes aléas physiques.
Le 1er septembre, c'était généralement le 15 fructidor du calendrier républicain français, officiellement dénommé jour de la truite.
Le 1er septembre 1715 c’est aussi : La mort de Louis XIV, surnommé le Grand
Les jours que nous vivons, nous les recommençons chaque année en cette période de rentrée scolaire. Une nouvelle année de fin de vacances est toujours l’occasion de se fixer des souhaits, des vœux, des objectifs, parfois des défis pour bien vivre cette nouvelle année de rentrée !
Heureux de vous accueillir ou de vous retrouver sur le site, pour de nouveaux numéros à écrire ensemble si vous le voulez bien.
L’été touche à sa fin, et c’est une nouvelle page qui s’ouvre avec la rentrée scolaire. Un moment toujours chargé d’enthousiasme, d’attentes, et parfois d’un peu d’appréhension, pour les enfants comme pour leurs parents.
Mais la rentrée, ce n’est pas seulement le retour à l’école : c’est aussi le moment de retrouver les associations (qui existent encore), un rendez-vous incontournable qui peut mettre à l’honneur toute la diversité et l’énergie de notre patrimoine Pieds-Noirs. C’est aussi un temps d’échange avec celles et ceux qui font vivre nos associations, et peut-être l’occasion, pour certains, de s’engager à leurs côtés.
Très belle rentrée à chacune et chacun d’entre vous ! Que cette nouvelle année soit portée par l’énergie, la curiosité, l’envie d’apprendre, de créer, de partager, de transmettre. Je me réjouis de vous retrouver lors des rendez-vous mensuels que j'espère encore nombreux qui feront vibrer vos mémoires au travers de la Seybouse.
Bon mois de septembre
" Bône " lecture
A tchao, Diobône,
Jean Pierre Bartolini
| |
|
C'était après la guerre de 39-45 et à cette époque, la jeunesse Calloise ne songeait qu'à passer du bon temps. Les bandes de jeunes-gens se formaient et l'amitié était de rigueur. Ils passaient leur temps = sur les plages - à faire des balades à la campagne - s'en aller danser au bal du marché - se promener le soir sur le cours Barris, pour reluquer les belles petites demoiselles...
Un beau soir, ils décidèrent, d'aller en bande jusqu'à la presqu'île, afin de faire une sérénade, sous les fenêtres de la fille d'un pêcheur, dont, l'un des garçons du groupe s'était épris. Ils attendirent que la soirée s'avance et qu'il fasse nuit noire, pour s'en aller vers la presqu'île, faire une belle et douce sérénade, au pied même de la maison de la jeune-fille. Dans le petit groupe, se trouvait un jeune tirailleur algérien, qui possédait un vieux gramophone à manivelle, qu'il trimbalait sur la chéchia qu'il avait sur la tête et ainsi que quelques vieux disques, qu'il se plaisait à faire tourner suivant les circonstances. Donc, tout était prêt, pour faire une sérénade à la donzelle.
Les voila partis joyeux vers la presqu'île et ils se dirigèrent sans bruits, vers l'endroit où, résidait la demoiselle. Arrivée à destination, ils s'installèrent en silence sous les fenêtres, lesquelles, étaient grandes ouvertes en cette chaude nuit de l'été. La sérénade commença, lorsque, le tirailleur algérien, lança son gramophone qu'il tenait toujours sur sa tête et qui se mit à cracher une chanson langoureuse. Combien de temps dura cette sérénade ? Pas bien longtemps il me semble, car, pas du tout appréciée par les intéressés, notamment, les parents de la jeune - fille.
Si cette douce musique devait ravir la donzelle, elle ne devait pas ravir son père, car, soudain ! Des éclats de voix en colère jaillirent des fenêtres, alors qu'un pot de chambre d'urines, devait s'abattre sur toute l'assemblée en inondant au passage le pauvre gramophone et le tirailleur, ce qui mit fin à a voix du gramophone.
Toute la bande pris la fuite en rigolant de plus belle. C'est ainsi que se termina la sérénade presqu'îlienne.
UNO PERITILE
Mais puisque nous sommes à la presqu'île, laissez-moi vous conter une petite histoire bien amusante.
C'était par une chaude nuit d'été où, un couple de personnes d'un certain âge qui habitait la presqu'île, s'étaient couché en gardant les fenêtres grandes ouvertes. Le vieil époux mal entendant, qui était marin-pêcheur de métier, dormait comme un loir depuis déjà un bon moment et près de lui, sa corpulente femme, indisposée par la chaleur, avait du mal à trouver le sommeil.
Au beau milieu de la nuit, soudain ! Le vieil homme se réveilla en sursaut et se précipita vers la fenêtre, pour observer un bon moment le ciel. Puis, en grommelant de plus belle, il alla se recoucher en disant à sa femme, qu'il avait été brusquement réveillé dans son sommeil, parce qu'il avait entendu un violent coup de tonnerre. Pourtant, lui dit-il, en regardant par la fenêtre, le ciel était clair, sans nuages et que la lune brillait.
Dans la pénombre de la chambre, sa femme lui dit d'un air détaché =" Mais non ! C’est moi, qui ai fait uno péritile", autrement dit un petit pet.! Mais, quel pet, venant de cette grosse mémère, car, ce n'était pas un péritile, mais un pet éclatant et bruyant, à réveiller son époux malentendant et même tout le quartier.
Cette histoire fit alors le tour de la cité et curieusement on en parle encore aujourd'hui.
Jean-Claude PUGLISI
- de La Calle Bastion de France.
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
Giens en presqu’île - HYERES ( Var )
(le 28 Mai 2025. )
|
|
|
ANGUSTIAS STAR
Gilbert Espinal
Echo de l'ORANIE N° 249, MARS/AVRIL 1997
|
|
La cour elle est Catastrophée !
Je crois qu'Angustias elle s'en va...
A Hollyvoode...
Elle s'est reçue une proposition : Mirobolante !
Un ponte! Un ponte du cilima ! Y I'y a écrit une let' avec un timb' plus rare sur I'envelopp'. Doudou y l'a découpé avec des ciseaux pour le met dans sa collection, mais dans I'opération, le timb’ il a perdu ses dents.
Ça fait qu'y vaut plus rien du tout, y parait.
Dans cet' let' y lui dit, que c'est une grande artiss', que y en a rien que deux qui comptent : elle et Greta Garbo. Qu'y I'a vue dans la bataille des cigarières de Carmen et que depuis y peut plus dormir de la nuit de tellement qu'y pense à elle, et que si elle veut partir pour aller tourner, non seulement y lui paye le voyage en quatrième sur un cargo, mais z'encore y lui donne je sais pas combien de dollars par semaine. Tout ça écrit en américain. C'est grâce à Madame Sacamuelas qu'on a compris : elle a un liv' formidab', gros, avec une couverture rouge ; vous z'avez le mot américain par ord' alphabétique et en face, le mot français. Ça s'appelle un dictionnaire. C'est d'une simplicité enfantine ! De nos jours y a de ces choses !
Bigoté il est jaloux comme un tig', surtout au passage que le ponte il écrit qu'y peut pas dormir de la nuit, pasqu'y fait que penser à Angustias.
- ll a qu'à prend' du tilleul, il a fait, ce sans vergogne ! Mais que moi je comprenne I'américain et que je le lise ça du premier coup ? Qu'est-ce je fait ? Pos, je m'attrape un revolver et je te le troue comme une passoire.1111..
- Y faudrait que tu vises bien, elle a rigolé, Angustias, et que ton revolver y soye fort, pour que tu lui touches j'qu'à Nevyorke.
- Et tu vas t'en aller par ces mondes, elle a commencé Martyrio, qu'y parait qu'y se passe des choses terrib' : des tremblements de terre, des orages et des typhons, avec un vent que les gens y sont emportés comme un rien !
- Qui ne risque rien n'a rien, ma fi' ! elle a déclaré. Angustias. Quand je vous rapporterai ici, des milles et des cents et qu'on pourra manger rien que de la langouste et du veau de France (qu'encore il a augmenté de quatre-vingt-dix francs la livre !) vous vous souviendrez plus si je suis été emportée comme un fétus de paille ou non comme tu dis toi. C'est que en Amérique, les artiss' ça se paye !
- Main' nant que j'ai I'impression que tu vas z'êt' grand-mère ! elle a repris Martyrio... i
- Et quoi ? elle a sauté Angustias : Marlène Dietrich elle est pas grand-mère, elle aussi ? Et elle arrête pas de tourner et de retourner ses pellicules...
- Et de tourner et de retourner la tête aux hommes, elle a insinué Consuelo ; y parait qu'elle va se marier pour la cinquième fois.
Bigoté y s'est mis comme un fou...
- Si je te vois moi en train de faire comme cet' sans honte de Brigitte Bardot, c'est que je te tue ! il a crié à Angustias.
Angustias elle a deshaussé les épaules et elle a dit :
- Y faut que je fasse venir la couturière pour qu'elle me fasse des robes, pasque si j'arrive là-bas, je veux pas qu'on me prenne pour Marie Trapos. Y faut que les journalisses y soyent éblouis. Je me vois dans un ensemb' avec des fleurs de toutes les couleurs, comme la main de grosses, en train de descendre les escayers de la passerelle de I'aréoplane en recevant une gerbe de fleurs en matière plastique au miyeu d'une foule délirante, qu'elle crierait en américain : "Vive Angustias" !
- Et avec quel chapeau ? Elle a interrogé Martyrio.
- Pas, mon chapeau tonkinois que je me suis acheté, pour si on irait à la plage, y a trois ans, qu'encore il est bon, elle a répondu Angustias.
- Le chapeau tonkinois non ! elle a fait Martyrio, c'est plus la mode ! T'y as pas vu sur le journal, qu'à présent, à Paris c'est la mode des couscoussiers.
- Moi je veux pas faire des frais à tant que le type du cilima y m'a pas donné des sous, elle a coupé Angustias.
- Pourquoi faire des frais ? elle a dit Martyrio. T'y as pas le tien de couscoussier ? D'un côté on lui met une fleur artificielle et de I'aut' un oiseau (qu'on a qu'à envoyer Doudou avec son estac, pour en a'oir un), ciquante centimet' de oilette, et t'y as un chapeau au poil...
On I'y a essayé Ie couscoussier à Angustias et y lui allait comme un gant. Un mannequin !
- Y faut t'acheter un corset, elle I'y a dit Consuelo, que si t'y es vedette, y faut que tu te recueilles. Tu peux pas laisser comme ça des parties de ton individu vagabonder sans sa'oir où elles sont.
- Moi un corset ! elle a sauté Angustias, jamais de la vie ! Y a cinquante-huit ans, que je suis sans corset et je vais pas main'nant, me mett' à tirer des ficelles. D'abord je pourrais pas respirer.
- Pos y faut que tu choisisses, elle I'y a déclaré Consuelo Hollyvood ou le corset...
Angustias elle a baissé la tête el elle a dit :
- Je peux pas laisser mon mari tout seul ici. Surtout main'nant qu'y risque d'êt' grand-père ! Nous tous on s'est mis à pleurer comme des bourricots.
|
|
MERS EL KEBIR
Par Yves REMY
ACEP-ENSEMBLE N°288
|
3 juillet 1940 Churchill imposa à ses amiraux l'infamie de Mers el Kebir
A l'époque j'habitais Sainte Clotilde petit village entre Oran et Mers-el-Kébir, il est vrai que je n'avals alors que trois ans, pourtant j'ai des souvenirs qui me restent.
Le massacre de Mers el Kebir fut ordonné par le Premier ministre anglais M. Winston Churchill.
Baptisé sous le nom de code « catapulte », il ne devait laisser aucune chance aux marins français.
Lors de cette opération, la Royal Navy, tua en une semaine plus de marins que la Kriegsmarine allemande pendant la guerre. : 1297 morts et 350 blessés.
Selon l'Amiral Alphand, la flotte française serait passée dans les ports alliés sans sourciller, si le ministre de la marine dans le cabinet dont faisait partie le général De Gaulle, lui en avait donné l'ordre, M. Reynaud ministre de la défense nationale pouvait le donner avant de démissionner.
Le 7 juin 1940 Dudley Pounds, suggère à son amirauté : La seule solution possible est de couler la flotte française, parce que l'amiral Darlan ne voulait pas leur livrer.
Message de l'amiral Darlan : quelle que soit l'évolution de la situation, la marine peut être certaine qu'en aucun cas la flotte sera livrée intacte à l'ennemi. J'ai donné l'ordre à la flotte de combattre, avec la plus grande énergie.
Le 18 juin message de l'amiral Darlan : « Ne laissez aucun bâtiment tomber intact aux mains de I'ennemi. »
Le 19 juin nouveau message de Darlan : «Je vous donne ma parole d'honneur, que la flotte française ne sera jamais livrée et qu'elle sera plutôt détruite que de subir une infamie. »
Le 20 juin, Churchill déclare : « Je n'ai pas confiance en la parole de Darlan la meilleure place de la flotte française est au fond ».
Ajoutons que De Gaulle le 22 juin déclarait à la BBC, Rien n'est fait, il résulte de ces conditions d'Armistice que les forces françaises, de terre, de mer et de l'air seraient livrées » alors que des soldats français se faisaient encore tués, défendant la mère patrie, sur un sol que De Gaulle avait déserté
M. Cordel, secrétaire d'Etat Américain déclare : « J'ai entendu dire que la marine britannique avait été opposée à cette Attaque. »
Notre marine militaire, commandé par I'amiral Darlan, comPortait au moment de I'armistice :
2 cuirassés de 35000 tonnes : le Richelieu et le Jean Bart ce dernier inachevé.
2 croiseurs de bataille : le Dunkerque et le Strasbourg.
5 cuirassiers de 22OOO tonnes : la Lorraine, le Bretagne, le Provence, le Courbet et le Paris.
7 croiseurs de 10000 tonnes : le Duquesne, le Tourville, le Suffren, le Colbert, le Foch, le Dupleix, l'Algérie.
11 croiseurs de 6000 et 7000 tonnes, type Dugay Jean de Vienne.
Le porte avion Béarn
Le transport d'aviation commandant Teste
28 contre-torpilleurs type Jaguar, Tigre, Vauquelin, Fantasque et Mogador de 2100 à 2880 tonnes
41 torpilleurs
78 sous-marins
Soit un total de 620 000 tonnes de navires de combat.
L'escadre attaquée par l'amiral Somerville, comprenait : les cuirassés Provence, Bretagne, Strasbourg et Dunkerque, le transport commandant Teste et les contre-torpilleurs : Kersaint, Terrible, Tigre, Lynx, Volta et Mogador.
En tout 120 000 tonnes, soit 20% du tonnage global de notre flotte. « Cette victoire éclatante annoncée par Winston Churchill »
Déclenchée dans la nuit du 2 au 3 juillet 1940, sur ordre de Winston Churchill, l'opération Catapulte fut menée par des commandos anglais.
Par surprise les anglais occupent les navires de guerre français basés dans les ports de Grande Bretagne ou sous contrôle anglais. Des ordres l'étendant au monde entier, avaient été donnés ainsi qu'il apparaÎt dans les propos tenus par l'amiral Decoux, commandant en chef des forces navales en extrême orient par son ami I'amiral sir Percy Noble, commandant en chef des forces navales britanniques en Chine, lors du dernier entretien qu'ils eurent à Saigon, le 30 juin 1940.
Le lendemain du 4 juillet 1940, l'amiral Muselier se rend chez Dudley Pound manifester son indignation, suite à ce massacre. Il demande et obtient du « First Sea Lord » la promesse que les enfants et les veuves des victimes du massacre de Mers el Kebir, soient indemnisés. Ce projet est signé le 5 juillet, quelque temps après, Winston Churchill refuse d'entériner le projet au motif, que si celui-ci est confirmé, son interprétation donnerait à croire : « un aveu de faiblesse »
Pour approcher les bâtiments français, afin de ne pas éveiller de soupçons, les vedettes transportant les commandos anglais, sont maquillés aux insignes de la Croix rouge.
Les marins français sont surpris, ils tentent de résister, plusieurs d'entre eux sont abattus par des rafales de mitraillettes, les autres sont désarmés
Attaque de Mers el Kebir
A 16h, 56 le 3 juillet 1940, la première salve Anglaise s'abat sur les vaisseaux français.
Les navires français à Mers el Kébir se trouvaient au mouillage, sans aucune possibilité de manœuvre et de dispersion, avec des chefs et des équipages rongés depuis 15 jours par les pires épreuves morales. En réalité les navires étaient hors d'état de se battre.
Ils ont laissé aux Anglais les premières salves qui sont décisives sur mer à de telles distances.
Branle bas de combat.
Le signal à peine déferlé aux bras de signaux de Dunkerque est aussitôt répété par les clairons des bâtiments.
Or l'escadre a disparu du large où ne brille plus que la vedette blanche venue pour une ultime tentative, minuscule tentative, minuscule sur la mer violette qui emmène le commandant Holland.
Le Hood, le Valiant, la Résolution sont venus à l'Ouest jusqu'à être masqués par l'éperon rocheux qui porte le fort de Mers-el-Kebir afin d'être abrités du feu que nous pourrions déclencher. La tactique de l'amiral Somerville était de rechercher pour les siens la position offrant le minimum de risques.
Par contre nos navires n'avaient pas la possibilité de combattre à égalité et aux salves qui dès l'ouverture du feu allaient s'abattre sur eux, ils ne pouvaient valablement répondre.
Etant donné la cadence des tirs des cuirassés anglais, ils devaient être écrasés avant toute défense.
La flotte française ne bougera pas.
Avant les premières salves anglaises.
Quatre geysers de 100 mètres de haut s'élèvent le long de la jetée, c'est la première salve anglaise. Aussitôt le signal d'appareillage général, qui flotte aux drisses du Dunkerque est hâlé bas, devenant exécutoire.
A cet instant l'amiral Somerville envoi le télégramme suivant à l'amirauté anglaise :
« I am engaging ennemi », L'amiral atlantique à l'amirauté française ; «combat engagé contre forces britanniques ».
Les contre-torpilleurs ont 900 mètres à parcourir avant d'atteindre les filets de barrage. Ils s'ébranlent en ligne de file manœuvrant pour éviter les gerbes d'eau qui se dressent sur leur route.
Toute l'escadre anglaise tire maintenant à cadence accélérée. De minutes en minutes, 24 obus de 380 s'abattent dans l'étroit espace. A moins de quinze mille mètres aucun blindage ne peut résister.
Les cuirassiers appareillent aussi , la Bretagne a mis en avant à la vue des premières gerbes. Mais un obus de 380 le touche par tribord arrière sous la cuirasse à hauteur des soutes à gargousses, des tourelles 4 et 5. Les poudres s'enflamment en fusant disloquent la coque.
A travers les ponts béants, une flamme gigantesque s'élève.
La Bretagne est touchée à nouveau par un obus qui explose dans les machines arrières, en quelques instants la moitié du navire est en flamme. D'énormes colonnes de fumée provenant des deux cheminées de la plage arrière montent vers le ciel.
De la passerelle déjà coupée du reste du navire, le capitaine de vaisseau Le Pivain, essaye malgré tout de poursuivre sa manœuvre. Grâce au compartimentage, l'avant pourra peut être échapper au feu, si les soutes à munitions ne sautent pas et profitant de l'erre que semble conserver le navire, peut-être pourra-t-on l'échouer ?
Les tirs continuent avec un nouvel obus qui explose au voisinage de la tourelle 3. Les incendies se multiplient gagnant et ravageant les batteries, ponctués par des détonations violentes des munitions de casemates de 138 qui sautent. Le navire prend de plus en plus de gîte. Par les déchirures, I'eau embarque par centaines de tonnes. Le Directeur de tir vient informer le commandant que l'artillerie est désormais inutilisable.
Le capitaine de frégate Rochas, commandant en second, fait observer que le navire va chavirer. Il ne reste plus qu'à l'évacuer. Le Pivain en donne l'ordre, Rochas quitte la passerelle pour diriger l'opération. On ne le reverra plus.
Bientôt le malheureux navire encaisse un nouveau projectile au pied du mat tripode. Il n'est plus qu'un brasier. Une dernière explosion, un éclat, une gerbe de fumée et de flammes d'une hauteur de près de deux cents mètres. Le drame est consommé.
En quelques secondes la Bretagne chavire, les eaux bouillonnantes entraînant dans la mort les survivants dans leur prison d'acier, que l'ordre d'évacuation n'a pu atteindre.
Neuf cent quatre hommes d'équipage, trente officiers tués, restés à leurs postes suivant les règles immuables de la marine de guerre.
Honneur à eux.
Le Dunkerque.
Le Dunkerque est touché ses tourelles bloquées, après deux minutes de combat, alors qu’il commençait à tirer sur le Hood.
Un premier obus l'atteint à bâbord arrière, sans causer d'avarie majeure, en effet I'obus traverse de part en part le hangar d'aviation, le pont, une chambre d'officier en ressortant, il perfore la coque sans exploser,
Aussitôt, le capitaine de vaisseau Séguin fait mettre en route très prudemment en raison des petits fonds qui le limitent sur son avant.
Au même moment deux nouveaux obus de 380 atteignent leur but sur tribord. Le premier traverse la cuirasse, la chambre de distribution d'une tourelle de 130 pour aller exploser dans l'entrepont cuirassé perforant le pont blindé inférieur, au-dessus des compartiments des machines avant.
La station d'huile qui régit les manœuvres à distance, des vannes à vapeur malgré les différents panneaux blindés sont mises hors d'usage.
Immédiatement, l'incendie ravage le compartiment des machines lequel se trouve envahi par les gaz d'explosion, refoulés par les ventilateurs.
Le groupe électrogène, alimentant les circuits principaux de bâbord est détruit.
Les ingénieurs, mécaniciens et le personnel survivant s'emploient à combattre l’incendie.
On ne dira jamais assez le sang froid et I'abnégation de ces hommes qui payèrent de leur personne.
Le second obus, traverse la cuirasse à la flottaison et explose dans les chaufferies qui alimentent le groupe de machines arrière, sectionnant les collecteurs de vapeur. Plus de cent mécaniciens et chauffeurs et deux ingénieurs trouvent une mort atroce.
On tente, mais en vain d'accoupler les machines arrière sur les chaufferies avant épargnées par le premier obus, mais les avaries sont trop importantes. Comme une catastrophe en entraîne irrémédiablement une autre, l'obus détruit les circuits principaux d'alimentation électrique tribord. Le navire tout entier privé de courant se trouve complètement paralysé.
En effet si les machines arrières peuvent encore utiliser pour un temps la pression de vapeur restante, si la barre peut être manœuvrée à bras, le manque d'énergie électrique interdit tout espèce de tir.
Un quatrième obus s'abat sur la tourelle 2, perforant le toit à hauteur de la demi-tourelle de droite se brise en fusant sans exploser, à quelques mètres de la passerelle, tout le personnel est indemne.
Par contre, le culot de ce projectile après avoir ricoché, s'en ira défoncer à trois cents mètres de là le poste de direction de tir de la Provence.
Il n'en est pas de même pour l'armement de la demi-tourelle, les gargousses en cours de chargement, touchés par des débris incandescents prennent feu, provoquant une explosion fulgurante qui volatilise les canonniers.
Le vaisseau Amiral est hors de combat. C'est tout juste s'il lui reste assez de vapeur pour qu'il puisse chercher un abri dans le fond de la rade, mouiller pour réparer ses avaries.
La Provence.
La Provence porte la marque de l'amiral Bouxin. Dès le signal d'appareillage général à 17 heures, il met en avant, décolle du quai d'embarquement très lentement afin de ne pas gêner le Dunkerque devant lui. Trois de ses tourelles ont commencé à tirer.
Les premières salves, destinées au Hood sont un peu courtes. Au moment où le tir doit être corrigé, la Provence doit l’interrompre. Son poste de direction de tir, qui est le seul endroit d'où l'on peut voir I'adversaire est bloqué par le culot qui a ricoché du Dunkerque. Le lieutenant de vaisseau Cherrières, directeur du tir est grièvement blessé ainsi que deux de ses serveurs les plus proches.
Vingt deux obus de 340, n'en sont pas moins partis à son adresse.
La tourelle 4 est dans I'impossibilité de tirer, masquée par la fumée et des flammes provoquées par un obus de 380 anglais, qui pénètre profondément à l'arrière.
Le feu fait rage à l’intérieur et la passerelle est prévenue que la température des soutes à munitions des tourelles 4 et 5, augmente de minute en minute. Il convient de les noyer pour éviter une catastrophe. S'élançant au travers des flammes, officiers et hommes de la sécurité réussissent à atteindre les vannes.
Dans les chambres à poudre, le personnel attend les ordres en dépit de l'envahissement des locaux par les fumées et les gaz suffocants refoulés par les ventilateurs.
Le sort de la Bretagne est évité à la Provence, il n'en risque pas moins que petit à petit l'arrière s'enfonce, la pression de l'eau pénétrant par la brèche fait sauter l'une après l'autre les cloisons ébranlées par les explosions. L’incendie progresse, malgré tous efforts.
Le tir ennemi ayant cessé, il ne reste plus qu'une chose à faire ; s'échouer pour sauver le navire.
Le Commandant Teste.
Il est le seul grand navire à ne pas être cuirassé. Un seul 380 l'aurait volatilisé. Le plus grand des hasards a voulu qu'il ne reçoive pas un seul obus.
Nous avons laissé les contre-torpilleurs au moment où ils se dirigeaient vers la passe, pour rejoindre leur chef de division.
Mogador, Volta, le Terrible le bâtiment de guerre le plus rapide du monde, le Tigre, le Lynx. Le Kerdaint dont une machine est avariée, les accompagnent sachant qu'il ne pourra les suivre longtemps.
À vingt quatre nœuds, ils s'élancent, les salves anglaises trop longues tombent dans l'axe de la jetée, qu'ils doivent doubler pour sortir.
Le Mogador s'engage déjà dans la passe dans le but de joindre un torpilleur anglais, qui s'était engagé en direction de la pointe de Canastel.
Son commandant, le capitaine de frégate Maerten fait ouvrir le feu, ses 138 ont déjà tiré une vingtaine d'obus, quand le capitaine de frégate Jacquinet, commandant le Volta qui suit le Mogador, voit une explosion formidable qui fait disparaître le Mogador.
C'est avec difficulté qu'il a le temps de mettre à 25 degrés de barre pour éviter son devancier.
Arrivant à sa hauteur, il constate que ce dernier est coupé en deux atteint par un obus de 380, provoquant l'explosion des grenades sous-marines de l'arrière. Un quart du bâtiment disparaît avec 37 hommes.
Cependant les cloisons de l'avant tiennent toujours, il continue à flotter droit.
Pris en remorque par le courageux équipage de la gabarre, la puissante, malgré l’incendie qui le ravage, Incendie qui nécessitera plus de quatre heures d'efforts.
Pour sortir de cet enfer, Jacquinet qui a pris le commandement met à 30 puis 40 nœuds.
Il a l’intention de piquer sur le Nord-Est puis de revenir dans l'Est de I'ennemi pour engager le combat au plus vite en tournant vers Ie Nord pour l'attaquer à la torpille la nuit tombée.
Il agit ainsi car à ses yeux c'est la solution d'obliger l'escadre anglaise à manœuvrer de manière à attirer les coups sur lui et de cette façon soulager les camarades pilonnés.
Sortant du barrage, le Terrible apercevant un torpilleur anglais ouvre le feu. Ses pièces de 138 suivies de celles du Volta crachent à plein débit Le Britannique répond par une courte salve puis se dérobe à toute vitesse derrière un écran de fumée.
Peu après un nouveau torpilleur plus gros que le précédent, débouche à grande vitesse de l'extrémité Est du rideau de fumée. Il est pris sous notre feu. A la troisième salve, le but est encadré à la quatrième touché. Des flammes jaillissent de l'arrière. Accusant une forte bande, il ne trouve son salut qu'au travers un rideau de fumée. Il était là pour télémétrer la division.
Dans un ronronnement monstrueux une salve de 380 destinée aux contre-torpilleurs, heureusement trop longue les coiffent et va s'abattre sur la côte
A ce moment le Tigre et le Lynx, abattent sur la gauche pour attaquer un sous-marin qui vient de lancer des torpilles.
Soudain de toutes les passerelles monte une immense clameur :
Le Strasbourg, voici le Strasbourg !
En effet splendide de majesté, donnant une impression de puissance invincible, son pavillon claquant au vent dans le soleil, le grand croiseur de bataille fonce vers la haute mer.
Dès l'arrivée de la première salve, il a largué ses amarres arrière, filé sa chaîne et mis en avant ses machines .
A l'arrivée de la troisième salve, celle qui frappe l'arrière de la Bretagne sa voisine en le criblant d'éclats, il amorce son mouvement. Par une chance inouïe, moins d'une minute aPrès, une salve groupée tombe à l'endroit précis où se trouvait son arrière. Un éclat fauche son mat de pavillon de poupe. Quelques secondes plus tard il était immobilisé.
Remontant ses camarades à Petite vitesse son évolution achevée, il longe la Bretagne en feu et la verra chavirer.
L’attention de son commandant, le capitaine de vaisseau Colinet, se concentre sur l'ouverture des filets, qu'il va falloir aborder.
Juste à toucher sur sa droite, pour éviter les mines mouillées par les avions anglais son étrave labourant les eaux bouillonnantes, il atteint la zone critique. Passera-t-il ? Il Passe.
Lui au moins pourra se battre, riposter, venger les morts tués lâchement.
Aussitôt les filets franchis, il met à 28 nœuds, à son bord tous sont tendus, dans l‘imminence du combat.
Aussitôt les 330 du Strasbourg crachent leurs bordées, dès la Première, le Britannique est encadré. Il fuit de toute la vitesse possible. La seconde tombe à le toucher à l’instant où il entre à l'abri de la fumée protectrice. On ne le reverra plus. Les cuirassés pas d'avantage, à part le Hood aperçu vers 17,40 h dans une échancrure du rideau de fumée avant que le Strasbourg, paré partout, n'ai eu le temps de rouvrir le feu.
Jumelles et télémètres braqués en direction de l'adversaire, tourelles orientées, il ouvrira le feu de toutes ses pièces, sitôt I'ennemi aperçu.
Mais alors que les cuirassés britanniques, devraient se profiler dans le soleil rien n'apparaît.
A huit milles environ, une sombre muraille qui couvre 20% d'horizon se dresse. on comprend. Dès que le Dunkerque et la Provence ont commencé à tirer, les vaisseaux anglais se sont fait couvrir par des rideaux de fumée
Le combat n'était pas du tout au programme. Massacrer sous des déluges de feu, une flotte empêtrée dans un espace restreint était sans risques pour l'assaillant, Mais dès qu'il y a une riposte tout change.
Mais ce qui pour l'heure, s'avère le plus urgent est le secours aux blessés.
Les derniers obus tombés, tous les bâtiments mettent à l'eau leurs embarcations afin de secourir les rescapés de la Bretagne qui se débattent comme ils le peuvent dans une mer souillée de mazout qui les aveugle et les étouffe.
Les actes d'héroÏsme et de solidarité se multiplient pour sauver leurs camarades
Le soir tombé l'escadre martyre compte ses morts.
De tous les bords on s'est élancé pour rechercher les blessés. Les médecins et infirmiers s'empressent et constatent l'horreur de groupes pitoyables, aux membres brisés ou gazés, brûlés, intoxiqués, commotionnés, choqués.
Les officiers suivant la tradition refusent d'être repêchés aussi longtemps qu'il restera un homme à I'eau
Certains s'entraident afin de pouvoir tenir la tête hors de l'eau. Un matelot du Dunkerque plongera douze fois ramenant à chaque lois un camarade jusqu'à qu'il s'affale complètement exténué. Un quartier maître du Teste, la clavicule cassée ne pouvant nager que d'un bras, plonge du haut du bord par trois fois.
Peu à peu, les morts sont remontés des chaufferies, des soutes où ils ont été surpris à leurs postes de combat, héros obscurs, victimes innocentes sur lesquelles se penchent avec une sollicitude marquée d'effroi, leurs chefs, leurs camarades, certains les plus cruellement atteints succombent aux atroces morsures de la vapeur fusant des collecteurs disloqués, n'ont parfois plus de visage.
Appelé de partout, le révérend père de Geüseer, grand mutilé de la guerre de 14-18 et aumônier de la 2ème division de ligne, qui après avoir au début de l'action donné l'absolution générale, n'a cessé de s'agenouiller et à découvert sur une des passerelles de la Provence, de réciter les prières des agonisants.
Sur les quais du port, ce ne sont que des files d'ambulances et de camionnettes pourvues de cadres porte-brancards qui conduisent aux hôpitaux el sur le navire hôpital Sphinx, les blessés les plus touchés, Les autres sont conduit sur Sidi-Bel-Abbès et Tlemcen. Cela durera une bonne partie de la nuit.
Un peu avant I'aube, à I'exception de quelques hommes de sécurité laissés à bord, pendant que le commandant Teste tous feux éteint se glisse vers Oran, les équipages du Dunkerque et de la Provence gagnent la terre. Si rien ne devait se produire au jour, on reviendra pour procéder aux réparations les plus urgentes.
Du Dunkerque, où les pertes sont particulièrement lourdes, l'amiral Gensoul peut prendre une vue de la situation de son escadre.
La Bretagne chavirée, la Provence en feu de l'arrière, le Mogador en feu mais flottant encore tout droit, le Strasbourg et les contre-torpilleurs échappés, le Teste miraculeusement épargné, le Dunkerque provisoirement immobilisé
L'amiral sud déclare dans un communiqué en clair, pour le moins maladroit , disant que les avaries du Dunkerque minimes, seraient bientôt réparées.
Les Anglais reviennent
Le 6, après ce communiqué, entre 5h30 et 6 h du matin trois vagues d'avions torpilleurs, lancés de l'Ark Royal, attaquent le croiseur.
( Ce que mon père, qui habite à Mers-El-Kébir, voit et prend pour des hydravions étaient en réalité des avions torpilleurs.)
La première vague arrive par I'Ouest, survole la jetée, l'épave du Mogador, lance ses torpilles sans résultat vire à gauche et regagne le large.
La deuxième, venant du sud-est, très gênée par le feu nourri de la DCA de la Provence, n'insiste pas.
La troisième, abordant la rade par le sud-ouest, lance une double attaque sur bâbord et sur tri bord. Un remorqueur, l'Esterel et un chalutier le Terre Neuve accostés au Dunkerque, reçoivent des torpilles.
Mais alors que l'Esterel à gauche coule, le Terre Neuve chargé de grenades sous-marines explose créant une large brèche dans le flanc du cuirassé, tuant ou blessant 4 officiers et 150 hommes.
Entre temps, un nouveau bâtiment coule.
S'ajoutant à celles de l'avant-veille, ces nouvelles victimes portent à 1297 le nombre de morts
Terrible bilan de I'attaque, tués, disparus :
Officiers : 47 - Maîtres principaux : 5 - Premiers Maîtres : 16
Maîtres : 44 - Seconds Maîtres : 134 - Quartiers Maîtres 352
Matelots : 701
Total 1297
Blessés :
officiers : 14 Premiers Maîtres : 5 - Maîtres : 11 - Seconds Maîtres : 20 - Quartiers Maîtres : 109 - Matelots : 192
Total 351.
Bibliographie : Ouvrage d'Yves Remy : « Aussi loin de Dieu et si près de la France ».
Yves Rémy
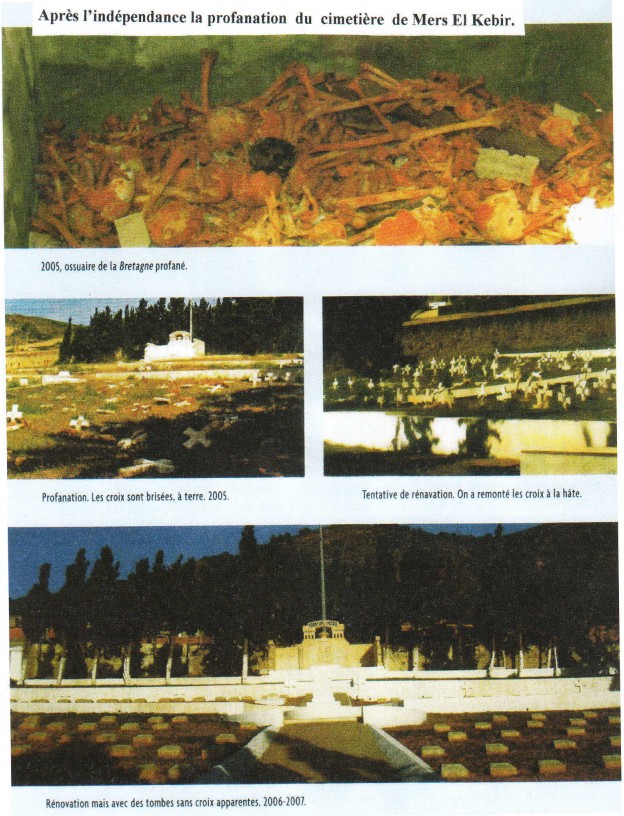
|
|
|
LE MUTILE du N° 162 à 176
|
SOUVENIRS
DE MA CAPTIVITÉ EN ALLEMAGNE
(12 OCTOBRE 1914-17 JUIN 1917)
VII - 168
Nous étions divisés en cinq bataillons. Chaque bataillon comprenait 1.000 hommes qui occupaient 12 à 15 baraques, très symétriquement bâties et bien pourvues de fenêtres.
Chaque baraque était divisée, intérieurement en trois chambres dont une grande, chauffée par deux poêles pour les hommes, deux petites chauffées également et bien éclairées pour les sous-officiers et caporaux.
Au point de vue administratif, chaque bataillon, commandé par un lieutenant et un feldwebel se divisait en quatre compagnies dont le chef est un sous-officier ou un soldat allemand qui avait sous ses ordres des sergents ou des caporaux pris parmi les prisonniers, pour la désignation des corvées ou le commandement des exercices de rassemblement. Il y avait également un sergent prisonnier dit, chef de bataillon, chargé de donner, mais plus souvent de transmettre, les ordres.
Le 1er bataillon, composé, au début, des derniers prisonniers arrivés, devint, dans la suite, le bataillon des volontaires pour la Turquie. Le 2ème bataillon, où se trouvait le bureau de la Kommandatur et le bureau arabe, était en majeure partie, composé de tunisiens.
Le 3ème comprenait les goumiers, les civils et les amputés. Le 4ème recevait les nouveaux arrivés et les prisonniers du 1er bataillon, qui avaient refusé de se faire inscrire pour la Turquie. Ce bataillon n'avait été constitué qu'en mai 1915, de l'arrivée des prisonniers fait, le 22 avril 1915 à Langemark.
Enfin le 5ème comprenait les prisonniers hindous.
Le plus haut gradé, commandant le camp, était le commandant major Von Halden qui avait beaucoup voyagé Algérie. Il était secondé par le capitaine Meutz, consul d'Allemagne au Maroc et qui était arabisant.
Mais le vrai chef, celui qui avait secrètement le Commandement du camp, était le lieutenant du 1er bataillon, le lieutenant Grobbal. Celui-ci avait, en effet, le droit de punir ou de récompenser qui il voulait, de gracier toutes les peines prononcées par von Halden ou par Mentz ou, s'il jugeait utile à la propagande, de mettre quelqu'un à la compagnie de discipline ou au cachot et même de le traduire devant un conseil de guerre.
Son compagnon favori était Mohamed ben Larbi, professeur de diction, marocain d'origine mais vivant à Berlin depuis longtemps et qui avait placé dans chaque bataillon un ou deux espions dont la mission consistait à lui rapporter les paroles ou les aces, voire même les pensées parfois clivés des prisonniers.
Plus tard, un lieutenant déserteur du 7ème tirailleurs, Boukabouya, vint le seconder ; il entreprit la propagande anti-française. Il prêcha plus que ses émules l’engagement des prisonniers dans les rangs turcs :
« Vous m'avez, peut-être connu, dit-il dans l'armée française comme lieutenant ; j'étais proposé comme capitaine, mais ayant vu l'injustice et la vertu non récompensée chez les arabes, mon cœur s'est révolté et j'ai déserté. Vous gagnerez beaucoup si vous suivez mes conseils. L’Allemagne sera victorieuse et vous donnera les postes de choix après la paix. »
Pendant quelques mois Boukabouya fut chargé du 1er bataillon et c'est pendant ce commandement éphémère qu'il a publié une brochure intitulée : « l'Islam dans l'armée française.»
C'est pour démontrer les mensonges qu'un professeur français à Genève, M. Montet, écrivit dans la suite : -«l'Islam et la France ». Dans, cette brochure, M. Montet démontra l'attachement, la fidélité et le dévouement des Arabes envers la France. Irrité, Boukabouya publia une autre brochure : «Les Musulmans dans l'armée française », qui ne produisit aucun des résultais espérés par son auteur.
Boukabouya agissait ainsi dans l'espoir de s'attirer la confiance des autorités allemandes et d'être, désigné au Maroc comme agent de propagande auprès des chefs indigènes dont il prétendait connaître les plus influents et dans le but de provoquer un soulèvement, contre la France.
Malgré son zèle ardent pour arriver à dompter ses coreligionnaires prisonniers, Boukabouya finit par perdre la confiance des officiers allemands et son rival Mohamed ben Larbi contribua à sa chute.. «C'est un espion envoyé par la France, dit ce dernier aux officiers allemands.
Cela suffit pour discréditer Boukabouya qui fut chassé du camp.
Il sollicita, dans un moment de colère, son envoi immédiat dans l’armée turque, où il recommença ses intrigues .auprès de l'autorité allemande dont il réussit à nouveau à capter la confiance. Il fut alors, à Berlin, employé au service du bureau oriental.
VIII - 169
Dès ce moment il fit paraître dans la presse berlinoise des articles, injurieux pour la France et qu'il signait de divers pseudonymes. Les extraits de ces articles m'ont été enlevés le jour où j'ai quitté le camp de Halbmondlager.
Le bureau oriental comprenait, une quarantaine d'employés musulmans émigrés de toutes les catégories. Le chef du bureau se nommait Chabniga, un allemand très fort en arabe littéraire, les employés travaillaient à lui imaginer toutes les espèces d'injustices dont les musulmans étaient les victimes dans les colonies des alliés et cela, d'ans le dessein de révoltes contre la France- et l'Angleterre la conscience des pays neutres.
Les agents de propagande étaient, en plus de Mohamed ben Larbi et Boukabouya, un nommé Sadek, d'origine tunisienne et qui avait été auparavant à la sûreté de Damas ; un Salah également tunisien émigré, professeur de français à Damas, et enfin un marabout, Cheik Mohamed, professeur d'arabe, à Damas qui, d'une « voix de cérémonie », célébrait les prières obligatoires du vendredi ou faisait, des harangues publiques, auxquelles tout le camp, même les amputés, était obligé d'assister et que nous devions approuver malgré nous : Il nous donnait aussi des leçons de Sidi-Khelif, une heure par jour et dans la mosquée.
Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur la façon dont les prières du vendredi étaient faites, aucune règle religieuse n'était observée. Elles se faisaient dehors, la mosquée étant trop, petite, on n'exigeait pas les ablutions, on tolérait le port de la chaussure pendant, les prières.
Le seul but de ces prières ne pouvait échapper à aucun de nous, elles se faisaient non pour obéir à la religion, mais tout simplement, pour nous réunir et essayer, de surprendre nos véritables, sentiments. En effet, les sentinelles allemandes nous entouraient et veillaient à ce que, aucun de nous n'échappât à la cérémonie, elles allaient jusque dans les baraquements cueillir les réfractaires à qui ces simagrées répugnaient, et qui se refusaient à prier dans des conditions si pitoyables.
La confiance des Allemands dans les Titres était très limitée, on eut soin de désigner en plus 5 agents de propagande (un pour chaque bataillon). C'était des civils allemands, connaissant bien l'arabe, l'hindou ou un dialecte égyptien. Leur principal rôle était d’attirer l'attention de tous les prisonniers musulmans sur la grandeur et la force du militarisme germanique et de les convertir à leurs idées en leur parlant, principalement de l'alliance de l'Allemagne avec la Turquie.
Trois professeurs militaires allemands, très forts en arabe parlé et littéraire, servaient, d'interprètes dans le camp. Ils donnaient également des leçons d'allemand à une soixantaine de prisonniers. Ceux-ci étaient exempts de corvées et d'exercices journaliers durant les deux heures par jour que duraient les leçons. C'était le seul avantage qui les poussait d'ailleurs à fréquenter les cours.
Quelques jours après notre arrivée au camp trois bureaux de renseignements qui constituaient une sorte de conseil d'enquête furent fondés. Les chefs de ces bureaux étaient naturellement tout désignés : ce furent Mohamed Larbi, Salah et Sadek.
Chaque prisonnier était appelé et interrogé sur son opinion sur la guerre et sur la France. On nous posa des questions du genre de celle-ci : Est-ce que les Français vous traitent avec douceur ? Etes-vous leurs égaux en droit ? Respectent-ils votre, religion ? Est-ce que la justice est la même pour les Français et pour vous ?
Emploient-ils l'argent de vos impôts pour votre intérêt personnel et votre bien-être ? Etes-vous venus combattre, volontairement ou par la force ? Serez-vous content de la victoire allemande ? etc., etc.. »
Par l'intermédiaire de l'interprète allemand qui était contre, cette propagande, nous apprîmes que nos réponses étaient notées : bon, mauvais, jeune algérien, susceptible, etc. ; en dernier terme signifiait : reste fidèle à la France.
Les effets de ces trois bureaux de renseignements ne tardèrent pas à se faire sentir. Quelques jours après, l'envoi en représailles au camp de Buton fut décidé pour, l'un d'entre nous nommé Bouzar.
IX - 170
Après un long silence, Bouzar parvint à me donner de ses nouvelles et à me faire part de ses souffrances morales et matérielles, à cause de l'isolement dans lequel il se trouvait, du travail sévère auquel il était soumis et des mauvais, traitements. D'autres prisonniers, au nombre de 250 furent dirigés sur divers camps du côté de la frontière russe.
Par les soins de ces trois bureaux de renseignement, des journaux prêchant la guerre sainte étaient, distribués en masse : El Fatoua, El Djihade, La Défense, etc., ou des feuilles volantes calomniaient la France, l'Angleterre et la Russie. Les victoires d'Hindenburg étaient amplifiées et traduites en arabe, affichées dans chaque bataillon et célébrées par des conférences.
On nous montrait très souvent, des cartes du front et celles indiquant, les immenses possessions de l'empire ottoman ravie par les chrétiens ennemis. « Voyez ce que vous "possédiez autrefois» nous disaient les meneurs habituels. Ces cartes finirent par disparaître, car elles étaient habilement détruites, par des prisonniers.
Dans les journaux El Feloua, El Djihade, etc., on lisait des articles soi-disant émanant des prisonniers en Allemagne. Ils étaient, en réalité, préparés au bureau oriental, puis adressés au camp où ils étaient, par force recopiées par quelques prisonniers tunisiens ; ces articles ainsi recopiés, étaient ensuite adressés à la presse berlinoise.
D'autre part la Kommandatur a obligé certains prisonniers à se faire photographier avec le drapeau turc flottant au-dessus de leur tête. Dans, les baraques écoles, on enseignait en plus de la guerre sainte, l'histoire sainte de la photographie générale, mais surtout une préparation pour l'avenir. On essayait de nous faire révolter contre la France..
Tout le monde, sauf les employés, était astreint, sous peine de punition sévère, d'assister, deux heures par jour, à des leçons anti-françaises. On passait également, alors, deux heures par jour et par ordre de baraque, et de bataillon, à des représentations cinématographiques. C'était des projections de vues de villes animées (allemandes bien entendu), d'opérations de généraux illustres, de grandes revues militaires, de travaux de grandes usines allemandes, etc., etc..
C'est à cette époque que fut définitivement fondé le 1er bataillon qui fut désigné sous le nom de bataillon de guerriers saints el qui comprit un certain nombre de déserteurs et traîtres. Ces « guerriers saints » étaient mieux nourris ; ils allaient en promenade sous la surveillance de sentinelles et ils reçurent fout d'abord un uniforme de drap bleu, puis quelques mois après la véritable «Feldogian» allemande avec le bonnet de police turc, l'équipement complet et une solde journalière, de 0 F 25. Ils eurent en même temps un drapeau spécial et une fanfare.
Mais pour préserver le 1er bataillon de la colère des autres bataillons, on l'entoura d'une barrière en bois ; on nous défendit sévèrement, d'y pénétrer ; on installa même sur une tour dominant le camp deux mitrailleuses qui devaient ouvrir le feu sur nous en cas de révolte contre ces renégats du 1er bataillon. Rien n'y fit. Il y eut souvent de violentes et tragiques querelles.
Les Allemands résolurent d'employer plus de douceurs tout en favorisant davantage les prisonniers du 1er bataillon. De vieilles capotes, des cigarettes nous furent distribuées ; nous participâmes aux promenades, mais il n'y eut rien de changé à notre situation au point, de vue pécuniaire et nourriture. Nous devions porter notre uniforme de drap bleu dans le camp et, seulement en cas de visite officielle. Celles-ci ne faisaient d'ailleurs pas défaut ; elles redoublèrent dès la constitution du bataillon.
La première visite d'homme d'Etat fut celle d'un émir turc, en février 1915, accompagné du directeur du bureau de Berlin, Chabinga, et d’une nombreuse suite. L'émir se contenta de prononcer quelques paroles et Chabinga nous, annonça l'envoi par le Gouvernement allemand au camp musulman, de nombreux livres de coran et d'une grande bibliothèque de livres arabes très intéressants.
Cette visite donna lieu à la publication d'un article dans le Berliner Tageblatt et dont mon ami Tazerout Mohamed, instituteur kabyle, engagé volontaire et fait prisonnier, me donna la traduction. Celle-ci me fut enlevé par les boches, mais en voici le sens général. C'est l'émir qui parle.
X - 171
J'ai visité le camp de Halbmondlager où se trouvaient internés nos frères musulmans tombés entre les mains de nos alliés. Partout où j'ai passé, j'ai été émerveillé de l'organisation supérieure de nos frères d'armes. J'adresse mon meilleur hommage à l'Empereur.
«A Halbmondlager se trouvent 1500 prisonniers tous Tunisiens. Des corans leur sont distribués, un bain et une mosquée sont à leur disposition pour leurs prières quotidiennes. Tous ne souhaitent qu'une chose, c'est de pouvoir venir combattre dans nos rangs pour coopérer à la défense et à la sauvegarde du drapeau de l'Islam et du Khalife.»
Que cet émir dise être ébloui par la colossale organisation allemande, c'est possible. Mais, qu'il ajoute qu'il y avait, en janvier 1915, 1500 prisonniers tunisiens, alors qu'il y en avait à peine au plus 200 à 250, qu'ils, avaient une mosquée, un bain maure et qu'ils faisaient des vœux pour le Sultan alors que la mosquée n'a été Inaugurée que sept mois après, cela est un peu fort et dénote la mentalité de l'autorité allemande et le but poursuivi par ses agents.
Une deuxième visite fut celle du Ministre des colonies allemandes. Celui-ci demanda aux prisonniers beaucoup de renseignements d'ordre militaire. Il tint à savoir de quelle façon se font les enrôlements des indigènes, de combien sont exactement leur solde et leur prime d'engagement ainsi que leur retraite. Il tint aussi à savoir, le choix de l'arme, qu'ils préféraient, le degré qu'ils avaient pu atteindre dans l'échelle des grades et, quel commandement on pouvait leur confier.
Ce fut ensuite le tour du Ministre des Finances turc. Celui-ci visita chaque bataillon séparément comme s'il devait faire des confidences ou en recevoir ; promettant des récompenses, il prêcha rengagement des prisonniers dans l'année ottomane, il promit des terrains, des bêtes de somme et de l'argent même aux amputés qui seraient acceptés comme mouhadjirines (émigrés). C'est pour lui répondre que le sergent Abdelkader (j'ai, oublié le nom de sa famille), du 6ème Tirailleurs algériens s'écria :
Notre fidélité jurée à la France lors de notre engagement, nos familles et nos biens laissés en pays français et confiés à la garde de la France nous indiquent, la seule et inébranlable conduite à tenir ». Puis, après un silence : « Est-ce qu'une femme peut avoir deux maris légitimes ? Ajouta-t-il. Non, répondit le Ministre. « Eh bien, notre France seule peut posséder notre unique foi jurée.»
Mais une telle liberté de langage en faveur de la France se paie cher en Allemagne. Aussi le sergent Abdelkader fut puni de 10 jours de prison et comme motif il fut allégué qu'il avait insulté le drapeau turc.
A diverses reprises nous eûmes également les visites des fils de l'Empereur qui passèrent tout simplement les prisonniers en revue; l'un des fils du Sultan de Constantinople vint aussi et enfin une trentaine de missions différentes, turques et autrichiennes devant lesquelles défilaient toujours les soldats du 1er bataillon, musique en tête.
Une de ces missions était spécialement chargée d'imprimer sur des disques, des chants arabes el des chapitres du coran. Aussi, des groupes de chaque région de l'Algérie furent-ils choisis à cet effet et obligés de satisfaire les désirs des missionnaires indiscrets.
Un certain nombre de prisonniers musulmans furent, un jour, dirigés sur Berlin. On avait, dans le but d'exercer sur eux une profonde impression, décidé qu'ils visiteraient en voiture la capitale allemande. Cette visite donna au Berliner Tageblatt l'occasion, en relatant le fait, d'ajouter :
«Les Mahométans du camp de Halbmondlager sont arrivés hier dans notre capitale et ont visité, sous la conduite de nos officiers, les plus grands monuments de Berlin. Ils se son arrêtés longtemps devant la statue du général feld maréchal Hindenburg et ont enfoncé des clous avec joie, sur cette adorable statue, exactement comme le fait la population berlinoise, avant de partir, ils ont fait une quête en faveur de la Croix rouge turque et cette quête a produit 300 marks qui seront immédiatement envoyés au Sultan. »
Mais pourquoi le Berliner Tageblatt se montre-t-il aussi aimable à l'égard des prisonniers, musulmans ? Pourquoi déclare-t-il qu'avec joie ils ont enfoncé des clous sur la statue d'Hindenburg et qu'ils ont fait une collecte qui n’aurait rapporté 300 marks ! Pourquoi n'a-t-il pas écrit plus véridiquement : Nous leur avons montré la statue d’Hindenburg ; nous leur avons donné des clous et nous les avons priés de vouloir bien les enfoncer dans la statue. »
Quant à la collecte, il est à douter que des prisonniers puissent disposer de certaines avances. Beaucoup, en effet, refusèrent d'agir comme on voulait et ceux qui obéirent ne le firent que par crainte de représailles,
Je n'insisterai pas trop, sur les articles parus dans El Djihade, dans la Défense, ou les feuilles hebdomadaires destinées uniquement aux camps de prisonniers.
(A suivre au prochain N°)
©§©§©§©§©§©§©
|
|
Algérie catholique N°8, août 1937
Bibliothéque Gallica
|
AÏN-EL-ARBA
Le village d'Aïn-el-Arba, chef-heu de canton à 60 kilomètres d'Oran, compte 4.803 habitants dont 1.200 François, 560 Espagnols, 250 Israélites et environ 2.800 indigènes, habitants du village même ou disséminés dans huit douars, sur un rayon de 15 kilomètres.
Réalisée par la générosité de M. Flavien Sénéclauze et préparée par la famille Bourde, la fondation d'un poste de mission se fit en septembre 1935.
Trois locaux construits entre le village européen et le village indigène pour la Communauté, le dispensaire et l'école ménagère attendaient les Sœurs Blanches.
C'est le 24 septembre — sous les auspices de Notre-Dame de la Merci — que l'œuvre indigène d'Aïn-el-Arba leur fut confiée. Les autorités européennes et les colons les accueillirent avec sympathie. Les indigènes vinrent respectueusement à elles dès le début, puis, en toute confiance et simplicité, ils demandèrent l'ouverture du dispensaire, tandis que les fillettes, bientôt familiarisées, suppliaient les Sœurs de les prendre à l'école.
De telles demandes ne pouvaient qu'être promptement satisfaites.
Malgré une installation encore incomplète, le dispensaire s'ouvrait le 7 octobre et la première semaine enregistrait une affluence de 800 malades.
C'est au milieu d'une de ces premières matinées de dispensaire, matinée quelque peu bruyantes, que Son Excellence Monseigneur Durand, évêque d'Oran, daigna venir, à l'improviste, pour bénir paternellement la maison et ses oeuvres, donner aux Sœurs ses conseils et ses encouragements.
Le flot des malades — qu'un peu d'engouement avait soulevé en ces premiers jours — se calma les semaines suivantes, laissant toutefois au nouveau dispensaire une moyenne ce 80 à 100 clients par jour.
Le dispensaire ouvre cinq jours par semaine et complète son action par des tournées sanitaires dans les douars, à raison d'une par semaine. II a bénéficié durant cette première année d'une consultation médicale hebdomadaire.
L'envoi de remèdes antipaludiques et antivénériens accordés par le Gouvernement général lui permettait, dès novembre 1935, de traiter plus efficacement ses malades.
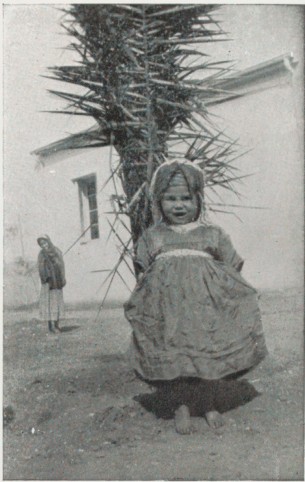 Aïn-el-Arba étant éloigné des centres, le dispensaire répond à un réel besoin de la population indigène. Les malades ne craignent pas de faire 20 à 25 kilomètres pour y recourir. II serait prématuré de parler de son influence ; on peut cependant bien augurer de ses développements. Du fait de sa situation, il est appelé à rendre de vrais services ; le chiffre de 25.800 soins donnés durant les neuf premiers mois semblent l'indiquer. Aïn-el-Arba étant éloigné des centres, le dispensaire répond à un réel besoin de la population indigène. Les malades ne craignent pas de faire 20 à 25 kilomètres pour y recourir. II serait prématuré de parler de son influence ; on peut cependant bien augurer de ses développements. Du fait de sa situation, il est appelé à rendre de vrais services ; le chiffre de 25.800 soins donnés durant les neuf premiers mois semblent l'indiquer.
Comme le dispensaire, l'école ménagère en est à ses débuts. Les femmes indigènes qui recevaient les soins des Sœurs voulurent tout de suite confier leurs fillettes. Dès le 11 novembre, l'œuvre commençait, avec 25 inscriptions, chiffre qui s'élevait à 55 en fin juin 1935. On en est encore à la période des tâtonnements. C'est la prise de contact qui exige tout d'abord une connaissance plus complète du milieu, de ses habitudes, de ses besoins, de ses dispositions et aptitudes.
Aussi, sans parler davantage d'œuvres encore naissantes, notons ce qu'une première année nous a permis de constater ou sujet de la population indigène d'Aïn-el-Arba.
Nous remarquons dans le village deux races bien distinctes :
1" Les familles nettement arabes.
Une partie de ces familles vivent relativement à l'aise ; quelques-unes sont propriétaires, d'ailleurs modestes ; dans les autres, on travaille chez les Européens.
Les femmes, ce sont elles que nous connaissons surtout, sont gracieuses, aimables. Elles tiennent proprement leur ménage, cousent un peu, mais aussi se réunissent souvent avec leurs voisines pour d'interminables causeries autour des petites tasses de café.
Les fillettes gentilles, dociles, sont toutes placées, dès l'âge de 9 ans, comme petites bonnes chez les Européens. II nous faudra les prendre très jeunes et sans doute aussi chercher à leur procurer par un travail rémunérateur les ressources qu'elles doivent, si jeunes, demander hors de chez elles.
Dans ces familles arabes, on est très attaché aux coutumes musulmanes. Les femmes et les enfants vont de temps en temps en pèlerinage aux marabouts, dans la campagne. II n'y a pas du reste de mosquée dans l'endroit.
2" Une race nègre, issue d'esclaves soudanais. Le teint foncé s'éclaircit, dit-on, à chaque nouvelle génération. Elle vit moins à l'aise que la première ; les femmes se mettent en service. Elles sont vives, intelligentes, plus exubérantes que les femmes arabes et paraissent plus susceptibles de recevoir une formation morale : elles sont moins musulmanisées
La population indigène d'Aïn-el-Arba et des environs semble plus saine moralement que beaucoup d’autres. Les familles sont en général nombreuses — malgré une mortalité infantile très grande ; on y remarque un sérieux qui ailleurs n'apparaît pas.
La note caractéristique de l'attitude des indigènes envers les Sœurs est celle d'un grand respect, dû à notre qualité de religieuses, de Mourrah, disent-elles (vierges) de la religion de Sidna Aïssa. Les femmes s'estiment honorées des visites qu'elles reçoivent, tant celles du village que celles des douars.
Il est facile de leur enseigner les vérités fondamentales : Jamais, assurent-elles, jamais un de nos marabouts ne nous a parlé de ces choses ; vous en savez plus qu'eux ..
Ce milieu doit peut-être ses dispositions favorables à l'exemple d'une vie chrétienne irréprochable que lui ont donné plusieurs familles de colons. On ne saurait exagérer le bienfait de telles influences.
Sœur M. JEANNE-FRANÇOISE
|
|
| Splendeurs et Parfums Culinaires
de Tunisie
La Cuisine Juive de Gustave.
|
Recettes
De Gustave Meinier-Nahum
(recueillies et rapportées par Mme Lyne Sardain-Mennella +)
et de Mme Josiane Rachel Guez-Sultan
( Recueillies et rapportées par M. J-C Puglisi )
Les Viandes.
Soupe Veloutée : H'rira.
( pour 8 à 10 personnes.)
Ingrédients
1 kg de viande un peu grasse coupée en dés.
3 à 4 os à moelle.
1 tasse de lentilles. - 1 tasse de pois-chiches.
2 tasses de tomate fraîche.
½ tasse de farine;
½ tasse de jus de citron frais.
4 à 5 litres d' eau.
1 tasse de vermicelles.
1 céleri entier. - 3 oignons.
1 botte de persil. 1 botte de coriandre.
1 ½ cuillérée de poivre noire.
½ cuillérée de curcuma. - Sel.
Préparation
Faire tremper les pois chiches une nuit entière / les rincer / les peler.
Émincer l'oignon et le céleri.
Dans une grande marmite, mettre : la viande + les os à moelle + les pois chiches + les lentilles + couvrir d' eau.
Faire revenir séparément : l'oignon + la sauce tomate fraîche + le céleri.
Incorporer au reste dans la marmite / Cuire 2 heures à feu doux.
Diluer la farine dans une tasse d'eau et l'ajouter avec les vermicelles / le persil / la coriandre / le sel.
Après 30' de cuisson, verser le jus de citron et continuer encore 15'.
Remuer de temps à autre pour bien diluer la farine qui a tendance à coller au fond de la marmite.
La soupe ainsi obtenue est assez épaisse : selon les goûts on pourra la rendre plus légère en y ajoutant un peu d'eau.
N.B : spécialité marocaine du Ramadan.
H'rira = autre recette.
Ingrédients
Quelques morceaux de poulets : ailes / abats...
250 g de viande.
1 poignée de pois chiches trempés la veille.
1 poignée de lentilles.
500 g de tomates fraîches.
1 oignon. - 1 c. à soupe de concentré de tomate.
1 bouquet de coriandre / 1 bouquet de persil / 2 branches de céleri.
2 c. à soupe d'huile. - 2 c. à soupe de riz. - Sel.
2 c. à soupe de beurre ou de smen / 1 paquet de safran / ½ c. à café de cannelle. - 1 pincée de poivre noir.
½ c. à café de grains de cubèbe ( kebbaba ) / 1 c. à café de carvi ( karouya ).
Préparation
Levain préparé la veille avec : 200 g de farine + 1 jus de citron + quelques gouttes de vinaigre.
Préparer le levain la veille : délayer la farine avec le jus de citron + le vinaigre + un peu d' eau.
Mettre dans un récipient, couvrir et réserver au chaud.
Passer les tomates à la moulinette / hacher la coriandre.
Faites revenir dans l'huile et beurre : la viande coupée en dés + le poulet + la moitié de la purée de tomate + la moitié de la coriandre hachée + le persil et le céleri attachés.
Ajouter : le poivre + la cannelle + la cubèbe + le safran + le sel.
Couvrir avec 2 litres d' eau.
Dés ébullition, plonger les pois-chiches + les lentilles, jusqu'à cuisson complète.
Ajouter au bouillon : la deuxième moitié de la purée de tomate + la 2ème moitié de la coriandre hachée + le concentré de tomate dilué dans 1/2 verre d'eau.
Verser le riz en pluie dans la soupe et laisser sur le feu.
Délayer le levain dans 2 verres d'eau tiède et passer à la passoire fine.
Verser ce coulis petit à petit dans la marmite en remuant rapidement et sans arrêt pour éviter les grumeaux.
Laisser cuire à petit feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse ( cette soupe doit être onctueuse et veloutée et non épaisse.).
En fin de cuisson verser 1 oeuf battu dans la soupe, donner encore un bouillon et retirer du feu.
Saupoudrer de carvi et servir chaud avec un filet de jus de citron.
N.B :
Le levain peut-être remplacé par de la farine délayée dans de l'eau et le jus de 1 citron quelques minutes avant utilisation.
Cette soupe peut être préparée également soit avec du poulet, soit avec de la viande uniquement ou encore sans les deux.
L'Khmîra : levain ou levure de pain ( autre façon ).
Ingrédients
250 g de farine.
1 c. à café de vinaigre.
1 petit morceau de mie de pain de boulanger.
1 pincée de sel. - Eau tiède.
Préparation
Verser la farine tamisée dans une cuvette.
La saupoudrer de sel et l'arroser de vinaigre.
Mouiller peu à peu d'eau tiède en la pétrissant jusqu'à l'obtention d'une pâte molle.
Placer la pâte obtenue dans un récipient et introduire au centre le morceau de mie de pain et laisser lever 24 heures, puis, retirer le morceau de mie.
Préparer avec ce levain la pâte à pain à laquelle vous prélèverez une petite boule de la grosseur d'un poing, que l'on utilisera comme levain pour une deuxième préparation du pain et ainsi de suite.
Pâtes aux anchois et fenouils sauvages.
( Recette sicilienne contée par Gustave.)
Ingrédients
1 gros bouquet de fenouils sauvages frais.
1 œuf frais. - Chapelure de pain.
1 verre de filets d'anchois à l'huile.
1 à 2 gousses d'ail.
1 belle tomate bien mûre.
Sel et poivre / Huile d'olive.
1 kg de spaghetti.
Préparation
Rincer et égoutter les fenouils et récupérer ses pousses tendres : les rameaux supérieurs des tiges avec ses petites feuilles vertes.
Réserver la partie inférieure et dure des tiges.
Dans un grand mixer, mettre : les pousses tendres des fenouils sauvages + 1 jaune d’œuf frais + 1 à 2 gousses d'ail + 1 belle tomate pelée et épépinée coupée en morceaux + les filets d'anchois à l'huile + la chapelure de pain + l'huile d'olive + Sel et poivre + 1 petit piment de Cayenne ( facultatif ).
Mixer et monter en pommade, en dosant bien l'huile et la chapelure. - Réserver la préparation au frais.
Dans un grand faitout mettre : eau + sel + les tiges dures du fenouil débitées en petits tronçons.
Plonger les spaghettis dés l'ébullition et cuire les pâtes al dente.
Passer les pâtes en réservant 1 louche d'eau de cuisson / Oter les tiges du fenouil.
Dans un grand saladier, verser : les spaghetti + 1 louche d'eau de cuisson des pâtes + la pommade aux anchois et fenouils sauvages. - Bien mélanger et rectifier l'assaisonnement.
N.B : Ce plat très simple et peu onéreux est un véritable régal.
Doser la quantité d’anchois suivant les goûts de chacun.
Parmesan et / ou gruyère si on le désire.
Le Boulou
ou pain d'épices Juif de Tunisie.
( Recette contée par Mme Josiane-Rachel GUEZ-SULTAN.)
Ingrédients
400 g de farine brune ( Brise ? ).
1 verre de sucre en poudre.
3 œufs frais.
1 sachet de levure chimique.
1 sachet de sucre vanillé.
½ verre d'huile d'arachide.
250 g de Chocolat noir ( ou pépites de Chocolat noir.).
Raisins secs. - Amandes entières.
Graines de Sésame.
Eau de fleurs d'oranger = 4 c. à soupe environ.
Préparation
Dans un saladier mélanger : 1 verre de sucre + le sachet de sucre vanillé + le sachet de levure chimique + 2 œufs entiers + le blanc de 1 œuf + l'eau de fleurs d'oranger.
Ajouter la Farine / Bien mélanger la préparation et pétrir jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte.
Verser 1 verre d'huile d'arachide et pétrir de nouveau.
Réserver la pâte dans un endroit tiède.
Faire doucement griller les amandes au four et en réserver 10 pour la décoration.
Incorporer à la pâte : les raisins secs + les amandes grillées + le chocolat noir en petits morceaux ( ou les pépites.).
Former un pain et disposer sur une plaque huilée.
Dorer avec 1 jaune d’œuf.
Répartir les amandes grillées sur la partie supérieure du Boulou.
Saupoudrer largement de graines de Sésame.
Cuire 30 à 45mn - th. 5 / 160°.
Se consomme tiède ou froid.
Jean-Claude PUGLISI.
de La Calle de France
83400 - HYERES.
|
|
|
Où est passé l'argent ?
Bonjour N° 138, 7 octobre 1934,
journal satyrique bônois.
|
|
Où est passé l'argent ?
Des sommes importantes avaient été recueillies pour offrir un banquet à M. Ben Djelloul lors de son passage dans la ville de M. Pantaloni.
Une petite partie, seulement, a été absorbée par le banquet lui-même. On nous demande : Où est passé le reste de l'argent, et cette question, nous est posée par plusieurs des Arabes de notre ville qui ont souscrit.
Nous n'en savons rien. Les organisateurs, qui sont bien connus, ne nous font pas leurs confidences.
Cependant, en cherchant bien.
C'est, peut-être, pour parfaire la somme recueillie que M. Henri Aloï, Maire de Bugeaud, passe chez les Arabes et assiège particulièrement les commerçants mozabites pour leur demander des souscriptions en faveur de la caisse du journal du Maire.
Il ne faut pas oublier que les commerçants mozabites sont les concurrents directs des commerçants israélites et une fois de plus, ceux-ci voient de quelle façon ils sont traités par M. Pantaloni et les amis de celui-ci.
Et, puis voici la campagne électorale qu'il faudra alimenter. Tout cela est bien joli, n'est-ce pas ?
Des sommes importantes avaient été recueillies pour offrir un banquet à M. Ben Djelloul lors de son passage dans la ville de M. Pantaloni.
Une petite partie, seulement, a été absorbée par le banquet lui-même. On nous demande : Où est passé le reste de l'argent, et cette question, nous est posée par plusieurs des Arabes de notre ville qui ont souscrit.
Nous n'en savons rien. Les organisateurs, qui sont bien connus, ne nous font pas leurs confidences.
Cependant, en cherchant bien.
C'est, peut-être, pour parfaire la somme recueillie que M. Henri Aloï, Maire de Bugeaud, passe chez les Arabes et assiège particulièrement les commerçants mozabites pour leur demander des souscriptions en faveur de la caisse du journal du Maire.
Il ne faut pas oublier que les commerçants mozabites sont les concurrents directs des commerçants israélites et une fois de plus, ceux-ci voient de quelle façon ils sont traités par M. Pantaloni et les amis de celui-ci.
Et, puis voici la campagne électorale qu'il faudra alimenter. Tout cela est bien joli, n'est-ce pas ?
Pierre MARODON.
| |
" La France doit indemniser l'Algérie "
Par M. Antoine Martinez
|
|
" La France doit indemniser financièrement l'Algérie pour les crimes de la colonisation ", assure le politologue Thomas Guenolé
Invité au micro de Sud Radio face à Elisabeth Levy, mercredi 18 décembre, l'ancien membre de La France insoumise a appelé l'État à " indemniser financièrement l'Algérie pour les crimes de la colonisation ".
Vous pourrez vous faire une idée précise par vous-même sur le site de Sud Radio
https://www.sudradio.fr/emission/la-verite-en-face-86
Ce Monsieur s'était déjà illustré au sujet de notre communauté, en proclamant au journal de 13h sur France Inter, le 7 juillet 2013, que le racisme dans le sud de la France résultait du grand nombre de Pieds-Noirs installés dans cette région.
J'avais démontré que cette assertion n'était pas fondée par le fait qu'il n'y avait pas un vote Pieds-Noirs mais des votes Pieds-Noirs et que la diversité du vote Pieds-Noirs est sensiblement répartie de la même manière que celle des métropolitains.
Mais Thomas Guénolé lui a toujours les bons chiffres, les bonnes études sur tous les sujets, les bons experts et les bonnes conclusions. En bon intellectuel de gauche Il a la vérité sans partage. Ce qui peut l'amener à dire des énormités avec un sérieux inébranlable et un ton professoral. Ce qu'il dit provient d'une suite de constats étayés par des sources obscures ou fortement orientées politiquement. N'oublions pas que ce politologue émérite, fut un soutien actif et enthousiaste de LFI avec qui il a pris ses distances après avoir fait l'objet d'un signalement par une militante pour " harcèlement sexuel".
Vous pourrez constater son état d'esprit si vous faites un petit tour sur la chaîne C8 avant qu'elle ne disparaisse, dans l'émission de Cyril Hanouna. Il vous prouvera que le racisme ne peut être que blanc, que la société n'est pas moins sure qu'il y a quelques années et que cette insécurité " résiduelle " est un signe des temps, une accumulation de faits divers sans cause particulière.
Pour revenir à ce qui nous concerne, il serait illusoire d'avoir un soupçon de compassion de la part d'un extrémiste d'une tendance qui n'aime pas voir les têtes qui dépassent.
Je vous livre donc pêle-mêle ses assertions avec mes remarques.
" La France doit indemniser l'Algérie pour les crimes de la colonisation... "
Il serait intéressant de savoir le montant qu'il estime légitime que nous devons donner.
Nous pouvons tout de même lui dire que pour une bonne partie c'est soldé.
- La France a fournit à l'Algérie pendant 3 ans après l'indépendance, une aide équivalente au montant du coût des grands travaux prévus au Plan de Constantine, c'est-à-dire approximativement DIX MILLIONS DE FRANCS PAR JOUR, soit pour ces trois années, PLUS DE DIX MILLIARDS DE FRANCS (1 753 017 393,99 Euros , conversion insee) versés à fonds perdus.
Qui plus est, cette aide était apportée au pays spoliateur, malgré que celui-ci n'ait pas tenu ses propres engagements dès les accords signés et se soit emparé, par la force de tous les biens et intérêts des non maghrébins, de tous les droits acquis par les personnes physiques ou morales ressortissants du gouvernement français. On aidait l'état spoliateur et on laissait dans leur misère matérielle et morale un million de Français spoliés de tous leurs biens.
- Grâce à la France qui a découvert les gisements de pétrole et de gaz, l'Algérie a bénéficié jusqu'à ce jour, d'une rente qui aurait pu la propulser au devant des pays producteurs d'énergie et en faire l'une des grandes puissances mondiales.
- De plus, pendant des années, la France a acheté le gaz à un tarif supérieur à celui en vigueur.
- Les fameux " bien vacants " qui auraient dû être protégés au moins 3 ans par les Accords d'Evian, furent préemptés sans indemnisation, à partir d'août 1962 par le gouvernement algérien. Biens vacants qui incluent, maisons, immeubles, ateliers, commerces, industries et outillages, véhicules divers, fermes, matériels et installations agricoles, cheptels etc…
- Peut être aussi, devra t'on lui rappeler que la France donne encore à l'Algérie entre 150 et 180 millions d'euros, chaque année. Depuis 65 ans la somme commence à être rondelette et nous sommes là bien au dessus des 1 milliard d'euros ridicules que l'Allemagne à versé à la Namibie.
Et puis on tire un trait sur un trait sur la dette à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, nous avons les pièces jaunes pour colmater les trous du déficit de notre Sécurité Sociale.
" Un tiers de la population algérienne de l'époque a été tué pendant la conquête. ON parle d'un million de morts, par des massacres et par la famine provoquée délibérément comme stratégie de conquête, qui a fait en elle-même 400 000 morts "...
Qui parle du million de morts sinon la propagande officielle du FLN ? Il y a avait moins de deux millions d'habitants en Algérie, en 1830, en proie, de manière endémique, à la peste, la variole, le typhus, la tuberculose, agitée d'incessantes luttes tribales et pressurée par l'administration turque. Le chiffre de la population était en diminution constante depuis l'époque romaine.
Il fut construit 138 hôpitaux, avec 30 000 lits, dans lesquels on trouvait neuf Musulmans pour un Européen.
Comme volonté génocidaire sous entendue par notre brillant politologue, on peut trouver mieux.
Les massacres, en 1945, de Sétif, de Guelma et de Kheratta : " Là on est sur plusieurs milliers de morts "...
Plusieurs milliers de morts à Sétif en 1945 c'est vrai. Mais combien et pourquoi ? Il est fort probable que l'éminent Thomas Guénolé s'en remette à son organe d'information historique préféré cité plus haut, qui proclame 45 000 victimes. Les historiens les plus sérieux, s'accordent sur le chiffre de 2 500 à 6 000 morts ce qui est déjà considérable. Quant au motif et à la sauvagerie initiale, silence absolu.
Rappelons que la répression est ordonnée par un télégramme daté du 11 mai 1945 du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la république française, qui ordonne l'intervention de l'armée, alors sous le commandement du général Duval.
Rappelons également que le Ministre de l'Air du gouvernement Charles de Gaulle était le communiste Charles Tillion dont le parti n'eut pas de mots assez dur contre ce soulèvement " indigène ", le nommant de " complot fasciste " et demande, par son organe de presse, " L'Humanité ", un châtiment exemplaire pour les meneurs.
" Je pense sincèrement qu'en termes de coût humain total, on ne peut vraiment pas mettre sur le même plan tout ce qui a pu être fait à des colons
ou à des Français par des Algériens "...
Voilà ensuite, dans la logique du propos, la séparation des victimes. Il est sincère le bougre ! Je pensais naïvement que toutes les victimes, sans distinction de race, d'origine, de couleur de peau, avaient droit à compassion, mais non. Le nombre effacerait donc une partie des victimes non désirables. Voici la preuve ce coup ci d'un apartheid pour l'éternité.
Donc les assassinés d'origine européenne sont quantité négligeable par le fait qu'il y en aurait moins. Voici donc un humaniste proclamé qui, même dans la mort, pose des différences.
Et Melouza ? Et les enlèvements ? Et quid des harkis ?
" Je n'ai pas connaissance que les Barbaresques aient fait un million de morts, qu'ils aient fait des camps de déportés "...
Les arabo musulmans, ont mis l'Afrique, l'Europe et même l'Asie en coupe réglée du VIIe au XXe siècle en déportant les noirs principalement mais pas seulement. Les estimations vont de 12 à 17 millions. Les Barbaresques, razzias sur le littoral français, en Corse en Italie, en Irlande et même en Islande, faisant 1 million à 1 250 000 chrétiens européens en esclavage en Afrique du Nord (Hors Maroc). D'autres estimations portent sur le double.
" Ce qui est souvent brandi par l'extrême droite, comme la construction de routes ou d'hôpitaux, démontrant par les chiffres que tout ce qui a été réalisé en Algérie l'a été au seul bénéfice des colons et en priorité pour le pillage des ressources "...
Si ce Monsieur avait pris soin de consulter les ouvrages de Jacques Marseille et de Daniel Lefeuvre entre autres, il aurait pu apprendre que l'Algérie, loin d'avoir été un eldorado pour la Métropole, fut au contraire portée à bout de bras pas elle.
Les seules richesses d'importance et pérennes furent le gaz et le pétrole du Sahara découverts et organisés par la France et vite abandonnées.
De plus dès le tout début de la mise en service des transports, les autochtones s'empressèrent de les utiliser ce qui leur économisait des heures voire des journées de marche.
Pour les hôpitaux, nous en avons parlé ci-dessus. Il me semble que l'abandon des infrastructures, routes, voies ferrées, ports, barrages, récupérés par l'Algérie devrait intervenir dans le décompte des dédommagements.
" 3% des propriétaires étaient des colons qui détenaient à eux seuls 25% des terres, et c'étaient les meilleures terres disponibles "...
Encore un poncif brandi cette fois-ci par le Professeur Guénolé.
L'Algérie n'avait que 11 millions d'hectares de terres cultivées. Sur ces 11 millions d'hectares, 9 millions, c'est-à-dire plus des trois quarts appartenaient à la population musulmane, 2 millions d'hectares seulement à des Européens.
Parce que, si étrange que cela paraisse, l'Algérie n'avait que 11 millions d'hectares de terres cultivables : 11 millions d'hectares sur 220 millions. Une proportion de 5 %.
De plus, la plus grande partie des terres européennes a été gagnée sur des steppes jadis incultes ou sur des marais jadis inhabités parce que mortellement insalubres
(A Boufarik, en quatre ans, de 1837 à 1840, on compte 331 colons décédés sur 450). Terres devenues fertiles à force de travail et de sacrifices. Salauds de colons !!
" Et pour finir, le Code de l'indigénat, qu'il assimile à " l'organisation de quelque chose qui est tout simplement l'Apartheid en Algérie française? "...
Le Code de l'indigénat est un avatar malheureux de la décision de la France de respecter la religion musulmane et d'en laisser la libre la pratique.
La nationalité française a été donnée à tous les Musulmans algériens par un sénatus-consulte de 1865. Le demandeur devenait français musulman, régi par la loi française et non par les dispositions du droit musulman notamment dans les domaines la polygamie, sur la condition de la femme, sur la répudiation, sur les droits à la succession…
Le musulman non demandeur se trouvait donc, de fait, à l'écart du droit français.
Le Code de l'indigénat n'aurait pas existé si justement l'accusation de génocide ci-dessus insinuée avait été réelle ou si la puissance coloniale avait opéré des conversions forcées et interdit l'islam.
Heureusement il n'en fut rien.
L'Apartheid vient ici clore le débat catégoriquement. L'Afrique du Sud avait un pendant dans le nord. C'est outrancier, mensonger et indigne d'une intelligence tellement brillante qu'elle s'éblouit et s'aveugle elle-même au miroir de l'idéologie et du sectarisme.
Et puisque nous en sommes aux indemnisations, Combien pourrait coûter une indemnisation aux espagnols pour 700 ans de colonisation ? Et trois siècles de colonisation turque stérile, ça vaut combien ?
|
|
ALGER ETUDIANT
N°24, 1er mars 1924 Source Gallica
|
| CHANTECRABE !
A mon excellent ami Georges Pérès
Si ça peut vous faire plaisir,
C'est sur un rythme aquatique
Que je vais vous entretenir ;
Tâchez donc de bien vous tenir
A cause des... transes atlantiques !
On le prétend de tous côtés,
Parmi les poissons patriotes
Que l'on savoure avec fierté
Rouget... de l'île de Beauté
Est succulent en papillote !
Heureux en choix, coquin de sort!
C'est pour nous, agréable tâche ;
Voulant toujours boucher le port
Tenons la sardine au corps-mort
Pour que jamais on ne... la lâche !
Les bigorneaux sont des toqués,
Ainsi lorsque aux jours de carême
Tinte le quart...naval au quai
Il s'échappe aussitôt des qués...
Aco ! ! Et puis rentrent en eux-mêmes !
De par ses yeux de merlans frits
N'ayant pas une vue sûre
Celui-ci dit, aussitôt pris,
Au pêcheur qui en est surpris :
Tu es, en mer, lent, je t'assure !
Quand nous tombons sur un oursin,
Qu'il soit juif ou catholique,
Même s'il nous apparaît sain
De corps, laissons-le à dessein,
Parce... qui s'y frotte, s'y pique !
C'est bien tel que je vous le dis,
L'époque où le poisson s'accroche
Sans mordre à l'hameçon maudit
C'est la semain' des quatr'chadis,
Mettez-vous ça dans la... caboche !
J'aime surtout quand il fait froid,
Les belles pieuvres de la Manche ;
En m'en apprêtant cinq par mois
J'ai, chez moi, tout comme Henri-Roi
Le... poulpe au pot chaque dimanche !
Sujette aux méchants courants d'air,
La tchelba s'éclipse en vitesse ;
A toujours un pet de travers...
S'il fait un temps de chien... de mer
De... tempêter serre les... jambes !
Moi qui lanterne à ma façon,
Ne prenant rien pour des vessies,
J'obtiens la clé et l'écusson
Eclairés par ces deux poissons :
Saint-Pierre et le t'sard...de Russie !
Oh! sans passer par l'isoloir
Nous pouvons causer politique :
Quand vous verrez sur le trottoir
L'œil de la raie au beurre noir
Criez : à bas la ...raie publique !
Soldat, crains-tu donc ma chanson
Pour me menacer de ton sabre ?
Quand je fais chanter les poissons
N'imite pas le canasson :
Non! Faut pas que mon chant..te..cabre !
ENVOI
Au Môle et pour passer mon temps
J'ai fait tous ces... vers à la hâte;
Voulez-vous donc, cher débutant,
En peu de jours en faire autant ?
Devenir poète épatant ?
Arrosez les blocs de sulfate !
Marius O.
|
|
L’HISTOIRE DE ROME
Maurice Villard
ACEP-ENSEMBLE N° 290
|
|
En ces quelques lignes je vais essayer de vous résumer I'histoire de Rome et cerner d'une façon simplifiée ce qui a fait l'Empire Romain. Son armée
L'histoire de Rome est une suite de guerres par lesquelles cette cité s'est imposée comme la maîtresse de la majorité du monde antique connu.
Par sa puissance, son éclat, sa durée et ses legs, Rome devra toujours être observée, analysée, d'une façon particulière. Elle est de ces puissances qui ne peuvent laisser indifférent. On peut haÏr ou admirer Rome, on ne peut I'ignorer.
D'après la légende, Rome fut fondée en 753 avant JC par deux frères jumeaux Romulus et Remus. Longtemps puissance de deuxième zone, elle fut conquise par les Etrusques en 616 avant JC. A partir de là jusqu'en 509 avant JC, trois rois Etrusques se succédèrent, ce sont, : Tarquin l'ancien ( 616 avant JC/578, Servius Tullius 578 / 534 avant JC ; ce roi divisa Rome en centuries et en tribus urbaines. Il protégea Rome par une muraille que l'on peut toujours apercevoir dans la Rome moderne, notamment sur la place de la gare centrale de Rome Termini. A sa mort, le roi étrusque Tarquin le Superbe lui succède, il fut renversé par une révolution en 509 avant JC.
C'est à partir de cette date jusqu'en 275 avant JC que Rome va conquérir toute la péninsule italienne.
De 509 à 396 avant JC, Rome fut en lutte constante avec les cités étrusques, la prise de la citadelle de Veles après un siège de 10 ans, vit la fin de la menace étrusque sur Rome.
Or, la même année, les Gaulois font interruption en Italie du Nord, ils détruisent la brillante civilisation étrusque. Sur leur lancée ils continuent vers le Sud ; les troupes romaines envoyées à leur rencontre subissent une défaite sur le fleuve Allia. Les Gaulois avec leur chef Brennus mettent Rome à sac. C'est l'épisode des oies du Capitole.
Une fois le retrait des Gaulois et leur défaite consommée grâce au dictateur Camille, Rome fut reconstruite.
De 387 à 290 avant JC Rome est en lutte contre les Sammites. La période qui s'ouvre voit en peu de temps un changement total du rapport des forces en Italie. Une coalition regroupant les dernières cités étrusques indépendantes, les cités grecques de la Grande Grèce ( Italie du Sud) et le roi d'Epire Pyrrhus, se dressent contre Rome
Fort de l'appui de Carthage, Rome malgré deux défaites résiste à Pyrrhus qui se voit contraint de passer en Sicile. Abandonnée par son principal allié, les villes de l'Italie du Sud et plus particulièrement Tarente font leur soumission aux Romains.
En 272 avant JC, Rome est maîtresse de toute la péninsule Italienne jusqu'aux Apennins, au-delà ce sont les diverses peuplades gauloises qui règnent en maîtres.
Ainsi, à compter de cette date, Rome va devenir une puissance internationale.
Cette entrée dans le clan fermé de ces puissances va être la source d'autres conflits qui vont aboutir à la constitution de I'empire romain qui voit son extension maximum. La conquête de l'Italie impose le contrôle des côtes pour prévenir les invasions ainsi que celui des mers limitrophes, d'où le conflit entre Rome et Carthage en 117 après JC, à la fin du règne de Trajan.
Pour arriver à cette hégémonie, Rome dut vaincre bien des adversaires. La conquête de I'Italie impose le contrôle des cotes pour prévenir les invasions ainsi que celui des mers limitrophes, d’où le conflit entre Rome et Carthage qui, après trois guerres puniques voit en 146 avant JC la destruction définitive de la cité phénicienne.
Rome, en s'installant dans Ie bassin de la Méditerranée occidentale va aussi entrer en contact avec ils monarchies issues des conquêtes d’Alexandre le Grand. Le royaume de Macédoine tombe le premier. La province de Macédoine est créée en 748 avant JC. En 133 avant JC, le roi de Pergame Attaka III donne par testament son royaume au peuple romain.
En 133 avant JC, Rome prend pied dans notre région, la province de Narbonnaise est créée.
Après une éclipse qui voit les premières guerres civiles à Rome entre Sylla et Marius (133 avant JC / 91 avant JC) après avoir battu les cités alliées qui s'étaient révoltées contre la tutelle de Rome (guerre sociale 91 avant JC), Rome reprend sa conquête du pourtour du bassin méditerranéen. Entre 88 et 64 avant JC, Rome conquiert le royaume de Mithridate.
Les années 73/71 avant JC voient la révolte des esclaves conduits par Spartacus qui sont vaincus par Crassus.
Le deuxième consul Pompée se voit confier en 67 avant JC le commandement suprême en Méditerranée qu'il débarrasse des pirates.
L'année 63 avant JC voit la disparition du royaume Séleucide.
Entre 63 et 30 avant JC, Rome va conquérir la Gaulle par Jules César en 52 avant JC et le dernier vestige du monde hellénistique ( issu des conquêtes d'Alexandre le Grand) tombe en 30 avant JC. Après la défaite des troupes de Cléopâtre et de Marc Antoine contre celles de Octave Auguste, I'Empire romain va voir le jour.
Il s'étendra progressivement de l'Ecosse actuelle aux plaines de l'Allemagne centrale, à la Roumanie actuelle, aux frontières Irano-lrakienne, sur le golfe persique aux montagnes du Caucase, pour englober enfin le Moyen-orient actuel, une partie de l'Afrique du Nord. Peu à peu toutefois après une longue période de paix qui dura environ 200 ans, l'empire va s'écrouler.
Attaqué sur ses frontières, trop importantes, l'empire romain d'occident tombe en 475 après JC, lorsque le roi wisigoth Odoacre détrône le dernier empereur romain qui se nommait, oh ! Comble de l’ironie, Romulus-Augustulus.
L’empire romain d'Orient durera lui, jusqu'en 1453, date à laquelle la capitale Constantinople succombe sous les coupes de l'armée ottomane de Mehet II.
Un empire plus que millénaire s'écroule.
L’armée romaine.
L’armée romaine de l'époque républicaine principal élément de cette épopée a trois caractéristiques essentielles : elle est : nationale, censitaire, non permanente.
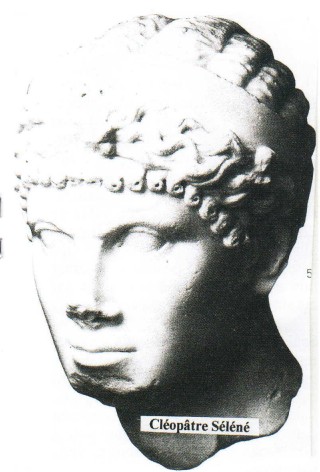 Le légionnaire romain est un soldat d'élite. Il est convaincu de la justesse de la cause pour laquelle il se bat. Il est sûr de sa force. Chaque matin au rapport, au rassemblement et avant chaque bataille, il a droit à l'Allocuto (allocution) : ordre du jour qui le lui rappelle. On y ajoute que les dieux sont avec lui. Le légionnaire romain est un soldat d'élite. Il est convaincu de la justesse de la cause pour laquelle il se bat. Il est sûr de sa force. Chaque matin au rapport, au rassemblement et avant chaque bataille, il a droit à l'Allocuto (allocution) : ordre du jour qui le lui rappelle. On y ajoute que les dieux sont avec lui.
C'est donc une armée de conscription et non de métier. Toutefois au fil du temps, des modifications vont intervenir. Ainsi, dès la fin du IIème siècle, I'armée romaine composée de légions est épaulée par des contingents d'alliés (cités latines alliées de Rome), Ces contingents vont atteindre jusqu'à 75% des effectifs des armées en campagne. Elle perd aussi dans le courant du 1er siècle son caractère censitaire. En effet, les réformes de Marius en 109 avant JC vont ouvrir les portes des légions aux prolétaires qui en étaient exclus. Par ce biais l'armée devient une armée de professionnels.
L’extension des conquêtes à tout le bassin méditerranéen entraîna aussi l'apparition de l'armée permanente. En effet, les citoyens mobilisés au début pour une campagne (localisée en Italie) pouvaient espérer être de retour chez eux au plus tard en automne. Quand les possessions de Rome eurent dépassé les frontières naturelles de I'Italie, il était hors de question que les légions reviennent passer l'hiver à Rome.
Le professionnalisme allait modifier profondément l'aspect de l'armée et ouvrir la voie aux « Légions impériales ».
Le Service militaire et la Levée.
Tout citoyen, sauf incapacité physique, est un soldat en puissance de 17 à 60 ans.
Le service est du par tous les citoyens y compris les plus pauvres (prolétaires) qui peuvent être mobilisés dans les instants les plus graves.
Le citoyen romain déserteur perd sa nationalité et devient Esclave.
En principe les affranchis ne servent pas dans les légions mais dans la flotte.
Toutefois à des moments précis le Sénat Romain fit appel aux affranchis el aux esclaves qui furent incorporés dans les légions. A l’issue de la campagne, les esclaves sont affranchis
Pour les besoins militaires, le roi Servius Tullius, avait, entre 913 et 195, divisé les citoyens romains en Centuries.
Chaque centurie devait en principe fournir le même nombre d'hommes, au moment de la levée.
Suivant sa richesse, chaque soldat avait un armement et une place distincte dans la disposition tactique. En principe les Hoplites, lourdement armés car ils pouvaient se payer une armure complète, combattaient devant. Les Velites, plus faiblement protégés et armés, agissaient en francs-tireurs et se repliaient derrière la ligne qui devait ressembler à une phalange grecque.
Ce système de phalange dura jusqu'à l'apparition de nouvelles unités nées des réformes de Camille. En effet celui-ci modifia de fond en comble le système militaire antérieur.
De toutes les classes censitaires créées par Servius Tullius, seule la dernière fut exclue de la levée. Les soldats furent divisés en trois groupes selon leur âge ; Princeps - Hastati - Tiari.
En même temps commence à s'ébaucher le système légionnaire. Le citoyen reste mobilisable de 17 à 60 ans mais pour une campagne.
Il faudra attendre la fin du IIIème siècle et surtout les guettes puniques, pourvoir ni le maintien sous les drapeaux » s'allonger. De toutes façons, ni la 1ère (Dilectus) ni le maintien n'obéissaient à une règle fixe. Le Sénat décidait de libérer ( Honesa Missio) ou de lever de nouvelles troupes quand il le voulait.
En règle générale, la levée avait lieu au Capitole. Tous les mobilisables étaient tenus de s'y rendre. Sur place ils étaient répartis par les Tribuns militaires entre les diverses légions.
On écartait lors de cette incorporation, les inaptes, ceux qui avaient déjà à leur actif de nombreuses campagnes et ceux qui étaient attachés à des fonctions religieuses.
Enfin, le Sénat pouvait gratifier certains citoyens d'une Vacatio, c'est-à-dire les exemples de service militaire, en remerciement de services divers rendus à la Cité. Ce système durera jusqu'aux réformes de Marius qui en faisant entrer les prolétaires dans les légions provoqua à brève échéance un professionnalisme des légions.
L’incorporation.
La levée a lieu par tribu, de telle sorte que les recrues de chaque tribu soit dispersées dans chaque légion afin d'empêcher la formation de légion au caractère ethnique trop marqué.
Le moment le plus marqué pour le légionnaire est la prestation de serment qui a un caractère fortement religieux.
Le serment solennel (sacramentum) rend maudit (sacrer) celui qui le viole.
Organisation de I'armée romaine.
L'unité stratégique et tactique de I'année romaine fut la légion. Une armée consulaire romaine en campagne comporte toujours quatre légions, deux pour chaque consul en exercice.
Cette organisation nous est familière grâce aux écrits de Polybe qui fut un historien grec écrivant au IIème siècle avant JC, racontant les guerres puniques, et surtout grâce aux écrits de Tite Live écrivant à l'époque d'Auguste une histoire monumentale de Rome. Pour Polybe, le nombre total d'hommes par légion était de 4.200 à 4.800.
L'armée romaine comprend des légions ( régiments) divisées en Cohortes (Compagnies) elles- mêmes divisées en Manipules (Gde. section) divisées en Centuries (section).
A chaque légion lui était adjoint un corps de cavalerie légionnaire divisé en 10 Turnes ( escadron) de 3 décuries ( peloton) soit 300 cavaliers au total.
Des contingents alliés venaient épauler chaque légion. Les légions dites impériales connurent très peu de modifications, Le système mis en place sous Marius, soit en 109 av JC allait se perpétuer jusqu'à la fin de l'Empire romain.
Les légions sont limitées en nombre, sous Auguste elles sont au nombre de 25, doublées par autant de légions alliées, le chiffre total de légionnaires défendant l'Empire peut donc se situer aux alentours de 250.000 aidés par autant de contingents alliés.
Seule différence par rapport à l'époque républicaine, les légions portent désormais un nom, ainsi apparaissent les noms de Primegina, Allouettes, Augusta, Valeria, etc.. Quand une légion disparaît dans un combat ou est dissoute suite à une révolte, son nom est rarement repris par une autre unité.
Fait important le mariage mais non le concubinage était interdit. Ce fut seulement à I'époque de Septime Sévère, père de Caracalla ( 193/211 après JC) que les légionnaires purent se marier.
L’armement.
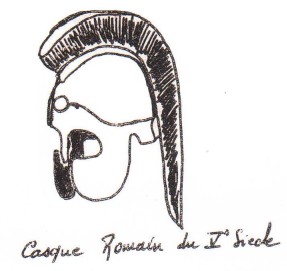 L'armement de I'armée royale et du début de la république fut certainement de type hoplitique et de style ou d'origine étrusque. Le casque lourd, les cnémides protégeant les tibias et le bouclier rond donnaient une allure grecque à notre fantassin romain. Une longue pique ( hasta) et une épée de fer viennent compléter la panoplie. L'armement de I'armée royale et du début de la république fut certainement de type hoplitique et de style ou d'origine étrusque. Le casque lourd, les cnémides protégeant les tibias et le bouclier rond donnaient une allure grecque à notre fantassin romain. Une longue pique ( hasta) et une épée de fer viennent compléter la panoplie.
Toutefois, les romains eurent très tôt I'idée d'adopter les techniques et les armes de leurs ennemis. Ainsi, il en découla trois changements principaux difficiles à dater avec exactitude.
Le premier fut la substitution du bouclier rond par un bouclier long fortement concave appelé scutum.
La deuxième fut l'adoption par les combattants des premières lignes d'une arme de jet le pilum, arme de jet très performante. Cette arme connut diverses modifications et perfectionnements. Le plus marquant date de l'époque de Marius. Le pilum une fois lancé et fiché dans un bouclier, adverse ne pouvait être réutilisé par l’adversaire. En effet sous le choc violent de l'impact, la tige en bois tendre qui unissait la tige en fer et la hampe se brisait. Le javelot pendait ainsi comme un poids mort sur le bouclier de I'ennemi, le gênant, pour combattre ou I'obligeant à se découvrir pour l'enlever.
Le troisième changement fut l'adoption de l'épée courte de type gaulois.
Le commandement
Nous sommes très peu renseignés sur les grades des sous-officiers. Le grade le plus connu est celui de centurion.
Il y eut un total de 60 centurions par légion. Tous avaient le même grade, toutefois le centurion le plus haut gradé était le centurion de la 1ère cohorte, 1ère manipule, 1ère centurie. Il était le centurion primipile. Il avait rang sur tous les autres centurions. Le cursus honorum d'un centurion consistait à gravir tous les échelons en vue d'arriver à commander la 1ère cohorte. Pour les officiers les grades sont mieux connus.
Il y avait tout d'abord 10 tribuns militaires par cohorte. Au-dessus des 10 tribuns se trouvait le Préfet du camp, sorte de vieux capitaine. Ensuite venaient les tribuns Angusticlavius de rang équestre, ensuite un tribun laticlavus de rang sénatorial, sorte de commandant en second et enfin le légatus legionis lui aussi de rang séniorial. Au-dessus du légat de légion se trouve le consul qui commande deux légions et parfois au-dessus du consul mais pour une durée qui ne doit pas excéder 6 mois un dictateur commandant suprême de l'Etat, tant au civil, au religieux et au militaire.
L'armée romaine, comme nous venons de la voir, fut en perpétuelle mutation. Evolution dans I'armement et la tactique, évolution dans la stratégie, dans la poliorcétique
 Grâce à ses perpétuelles mutations, Rome s'est forgé au cours des siècles un outil de premier ordre. Mais au-delà du caractère purement militaire de la chose, il ne faut pas oublier que l'année romaine fut aussi un vecteur de paix et de développement pour les provinces conquises. Grâce à ses perpétuelles mutations, Rome s'est forgé au cours des siècles un outil de premier ordre. Mais au-delà du caractère purement militaire de la chose, il ne faut pas oublier que l'année romaine fut aussi un vecteur de paix et de développement pour les provinces conquises.
En effet, le passage ou le stationnement des troupes profite à la province, création de routes, de cités, de comptoirs.
Bien des villes modernes ont comme origine les cités romaines. Ainsi Arles, Nîmes, Béziers, Narbonne, Carcassonne pour ne citer que les villes existant encore il faudrait ajouter Glanum, Ambrossum, Substantio, Enserune, Ruscine, et la liste serait longue. En AFN et particulièrement en Algérie la plupart des villes et aussi des villages furent construits sur des sites romains Rome, par son génie, sa puissance a transmis à l'échelle planétaire continuant en cela l’œuvre d'Alexandre le Grand, le savoir, les techniques et les connaissances du monde antique. Cet héritage pèse lourdement sur notre civilisation.
Bibliographie : Lieutenant : Claude Balmefrezol.
La Division de Constantine a repris l'insigne
De la IIIème Légion Romaine. L'aigle romaine
Encadrée d'insignes avec Phatères ( citations, décorations) « OB Virtutem.» pour le courage.
Au-dessous I'abréviation LEG III AVG
Le légionnaire romain est un soldat d'élite.
Il est convaincu de la justesse de la cause pour laquelle il se bat ; il est sûr de sa force
Chaque-matin au rapport, au rassemblement
Et avant chaque bataille, il a droit à l'Adlocuto ( allocution ) : ordre du jour qui le lui rappelle
On y ajoute que les dieux sont avec lui.
Maurice Villard
|
|
LES AMPOULES : GÉNIAL !!!
Envoyé Par Annie
|
|
Nous, Personnes Âgés, nous sommes tous comme des ampoules.
Un cadre supérieur a pris sa retraite et a quitté son somptueux quartier résidentiel pour s'installer dans une résidence pour personnes âgées, où il possède un appartement.
Il se considérait comme très important et ne parlait jamais à personne.
Même lorsqu'il se promenait chaque soir dans le parc de la résidence, il ignorait les autres, les regardant avec mépris.
Un jour, une personne âgée s'est assise à côté de lui et a entamé une conversation, ils ont continué à se rencontrer.
Chaque conversation était en réalité presque un monologue, le cadre retraité ressassait continuellement son sujet favori, sa vie d'avant.
Personne ne peut imaginer le poste important et la position élevée que j'occupais avant ma retraite, et ainsi de suite, et l'autre personne âgée l'écoutait tranquillement.
Après plusieurs jours, lorsque le cadre retraité s'est enfin intéressé à la situation des autres pensionnaires, son auditeur âgé, lui aussi, s'est permis de lui dire .
Vous savez, en retraite, nous sommes tous comme des ampoules grillées.
Peu importe la puissance d'une ampoule, la quantité de lumière ou de scintillement qu'elle donnait avant d'être grillée.
Il poursuivit : je vis dans cette résidence depuis 5 ans et je n'ai dit à personne que j'ai été membre du Parlement pendant deux mandats.
Le monsieur là-bas à votre droite a pris sa retraite en tant que directeur général des chemins de fer .
Celui qui est assis un peu plus loin était général de division dans la Gendarmeri e.
Cette personne assise sur le banc en robe blanche immaculée était la PDG d'une grande entreprise de prêt à porter avant sa retraite.
Elle ne l'a révélée à personne, pas même à moi, mais je le savais.
Toutes les ampoules sont maintenant les mêmes, quel que soit leur puissance 40, 60, 100 watts , cela n'a plus d'importance.
Le type d'ampoule qu'elles étaient avant d'être grillées n'a pas non plus d'importance – LED, CFL, halogène, incandescente, fluorescente ou décorative.
Et cela, mon cher monsieur, s'applique à vous aussi. Le jour où vous comprendrez cela, vous trouverez la paix et la tranquillité, même ici, dans ce lieu.
Le soleil levant ainsi que le soleil couchant sont tous deux beaux et adorables, mais en réalité le soleil levant a plus d'importance et est même vénéré, alors que le soleil couchant ne reçoit pas la même révérence.
Il vaut mieux le comprendre le plus tôt possible que trop tard.
Notre désignation, notre titre et notre pouvoir dans ce monde ne sont pas permanents ni immuables.
Montrer un certain ego de notre vie antérieure ne fait que nous compliquer l'existence et le rapport aux autres.
Rappelez-vous que lorsque le jeu d'échecs est terminé, le roi et les pions retournent dans la même boîte.
Alors, si vous êtes vieux, profitez de ce que vous avez aujourd'hui, profitez de ceux qui vous aiment, vivez le moment présent.
À la fin de notre séjour terrestre, tous nos certificats, qualifications, et titres pompeux seront remplacés par un seul : le certificat de décès.
Une ampoule, pas encore grillée, qui vous a éclairé, vous salue bien.
Ceci reflète vraiment la réalité de la vie. Bien amicalement .
|
|
|
PHOTOS BÔNE
Envois divers
|
|
RICHARD GUERIN
PNHA - N°200 - octobre 2011
|
|
La tête et les jambes
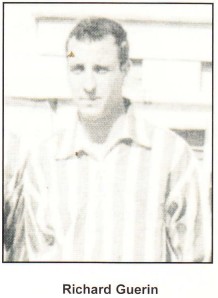 Avec un père footballeur à I'AGS Mascara, Champion d'AFN de course à pied (Charles ELKAIM) et un oncle qui évolua au CALO, avant d'être transféré à l'Olympique de Marseille à 17 ans et demi, sélectionné en équipe de France "B" avant d'être "interdit" d'Espagne - France "A" pour une sordide histoire de... religion (Emile Dahan), le jeune Richard ne pouvait échapper au sport. Avec un père footballeur à I'AGS Mascara, Champion d'AFN de course à pied (Charles ELKAIM) et un oncle qui évolua au CALO, avant d'être transféré à l'Olympique de Marseille à 17 ans et demi, sélectionné en équipe de France "B" avant d'être "interdit" d'Espagne - France "A" pour une sordide histoire de... religion (Emile Dahan), le jeune Richard ne pouvait échapper au sport.
Richard naît le 6 Janvier 1938 à Alger dans le populaire quartier de Bâb-El-Oued. Pour les Espagnols, naître hors de la Cantère, c'est naître "off-limites" de Bâb-El-Oued.
Pour les Italiens, hors le quartier des Messageries, il n'existe pas de Bâb-El-Oued. Richard voit le jour à deux pas de PADOVANI et des Bains Matarese rue Thuillier, où naîtra une gloire de la boxe française : Albert Yvel.
Situé entre la casbah et le cœur de BEO, le quartier de Richard bat au rythme des jardins Guillemin qui sont envahis dès 13 h. par une cohorte de mamans-gâteaux.
Jusqu'à la tombée de la nuit, les apprentis-footballeurs, dont fait partie Richard, sont confrontés au douloureux problème de devoir abandonner "leur" stade préféré. Car le reste du temps, le jardin Guillemin est le théâtre de rencontres épiques entre les différents quartiers de Bab-El-Oued.
C'est au cours de ces matches, ô combien disputés, que Richard apprendra tout ce qu'il saura sur le football. Les dribbles, les feintes de corps, les râteaux, les crochets, les passements de jambes, les "tchèques" n'auront plus aucun secret pour lui. Son cousin Robert ELKAIM qui fera une belle carrière au Gallia Sports Algérois puis au Racing Club de Strasbourg, joue en minimes au GSA.
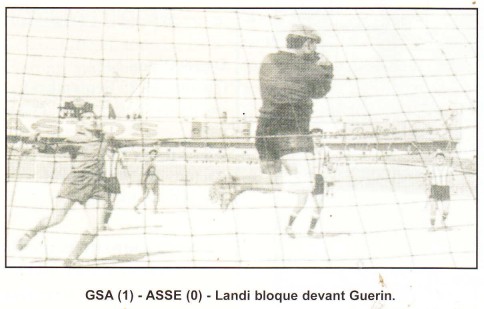 L'équipe est bonne mais I'ailier gauche "Aouah ! rien qu'il touche pas une bille" C'est ainsi que Richard signe en 1949 chez les "Coqs" algérois. MONTEL prend cette équipe en main. On y retrouve des joueurs qui brilleront au plus haut niveau : Ichalalene, Barbier, Picard, Billota entre autres. Fin connaisseur, le père de Richard suit toutes les prestations de son rejeton et il n'est pas de meilleur ni de plus honnête critique. Aussi, Richard, dribbleur dans l'âme, simplifie son jeu. Infatigable et attaquant polyvalent, il mise sur des accélérations foudroyantes pour fatiguer son adversaire direct avant de reverser dans son péché mignon, le dribble. L'équipe est bonne mais I'ailier gauche "Aouah ! rien qu'il touche pas une bille" C'est ainsi que Richard signe en 1949 chez les "Coqs" algérois. MONTEL prend cette équipe en main. On y retrouve des joueurs qui brilleront au plus haut niveau : Ichalalene, Barbier, Picard, Billota entre autres. Fin connaisseur, le père de Richard suit toutes les prestations de son rejeton et il n'est pas de meilleur ni de plus honnête critique. Aussi, Richard, dribbleur dans l'âme, simplifie son jeu. Infatigable et attaquant polyvalent, il mise sur des accélérations foudroyantes pour fatiguer son adversaire direct avant de reverser dans son péché mignon, le dribble.
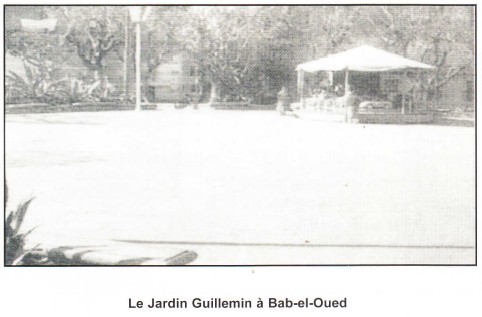 Marcel Salva suit d'un oeil, ô combien exercé, ce gamin remuant qui se faufile, tel une anguille, dans les défenses. Champion d'Alger, minimes et cadets, il sera titularisé en équipe fanion" lors d'un match au Municipal mettant aux prises le GSA et le Mouloudia Club Algérois. Pour son baptême de feu, le MCA lui propose comme adversaire direct un Amtouche réputé pour son jeu...viril. Marcel Salva suit d'un oeil, ô combien exercé, ce gamin remuant qui se faufile, tel une anguille, dans les défenses. Champion d'Alger, minimes et cadets, il sera titularisé en équipe fanion" lors d'un match au Municipal mettant aux prises le GSA et le Mouloudia Club Algérois. Pour son baptême de feu, le MCA lui propose comme adversaire direct un Amtouche réputé pour son jeu...viril.
Richard a 16 ans et, heureusement pour lui, il court vite et saute haut. L'examen de passage est concluant et il est maintenu contre le CS Hammam-Lif en Coupe d'AFN à Tunis.
Il est, à présent, junior 1ère année et ses études se passent le mieux du monde.
Malheureusement, il est obligé de les poursuivre à Lyon. Après une saison en CFA au SO Chambéry, I'OM et le SOM où Emile Dahan a gardé de solides amitiés, le contactent. Richard signe à Montpellier, alors en seconde division. Blessé sérieusement à un genou, il n'en passe pas moins très brillamment ses examens et rentre au pays.
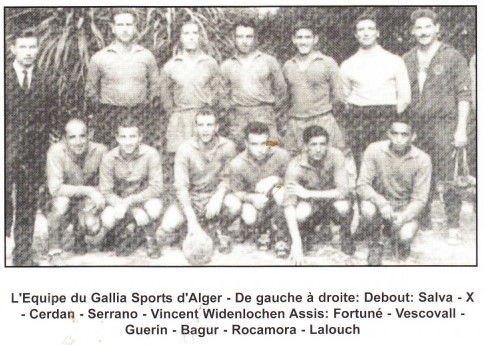 Il signe à nouveau au GSA mais ses performances se ressentent de son manque d'entraînement dû aux études de plus en plus accaparantes. Après une saison où il obtient une sélection en Equipe de France Universitaire et son diplôme de Médecine Générale, il signe à I'Association Sportive de Saint-Eugène. Il signe à nouveau au GSA mais ses performances se ressentent de son manque d'entraînement dû aux études de plus en plus accaparantes. Après une saison où il obtient une sélection en Equipe de France Universitaire et son diplôme de Médecine Générale, il signe à I'Association Sportive de Saint-Eugène.
Hélas, la saison sera interrompue par... I'indépendance du pays. L'exode le déposera à Lyon. Il évoluera à I'OL en CFA avec la satisfaction de disputer quelques rencontres au sein de la formation professionnelle.
Dermatologue diplômé, il s'installera à Toulon et répondra à I'insistance de son ex-coéquipier du GSA, Gilbert Vermeuil qui entraîne La Valette. Puis ce seront les clubs Collobrières, I'ASPTT Le Pradet qui verront Richard Guerin porter leurs couleurs. En 1912, il prendra sa retraite sportive ne disputant que quelques matches avec les Médecins du Var. Il sera à I'origine de la création de l'équipe du Caducée qui lui vaudra la Médaille de Bronze du Mérite Sportif.
Richard Guerin a su concilier le sport et les études. Sans nul doute, cela à nuit à sa carrière, mais la satisfaction qu'il retire de cette double expérience est riche d'enseignements. Un père (Charles Elkaim), un oncle (Emile Dahan), des cousins (Maxime, Marceau et Robert Elkaim du GSA), un frère (Paulo du GSA et du RSA) footballeurs !
Une sacrée famille !
Bon sang ne saurait mentir !
H.Z.
La Mémoire du Football
d'Afrique du Nord
|
|
MINISTERE de l’ALGERIE 1987
Envoyé Par M. C. Fretat, pages 107-133
|
COLONIALISME ET DÉPERSONNALISATION
CRITIQUE
L'Algérie est le type du pays annexé par une puissance coloniale ; on y trouve tous les aspects de l'impérialisme classique, politique de dépersonnalisation sociale, exploitation et oppression des masses algériennes au seul bénéfice de la puissance coloniale et des colons européens.
RÉPONSE
Rien n'est plus faux et plus sommaire que l'affirmation selon laquelle l'Algérie est une colonie. A la différence de ce que l'on observe dans un impérialisme économique, l'action de la France ne s'exerce pas par capitaux interposés, mais par hommes interposés. Caractéristique de notre époque est, en effet, l'apparition de ce que l'on peut nommer « impérialisme économique » par lequel les nations les plus avancées économiquement tiennent en tutelle plus ou moins dissimulée des nations sous-développées, auxquelles elles fournissent capitaux, techniciens, machines, etc... Ces nations « impérialistes » ont naturellement besoin de garanties politiques, ce qui les conduit à intervenir par des pressions économiques dans la vie politique du pays afin de voir maintenues la stabilité et la solvabilité des gouvernements concernés. Par suite, il est bien des cas où le pouvoir politique n'est que le masque du pouvoir économique, et où, sous l'apparence de l'indépendance et de l'autonomie, ces pays sous-développés sont en réalité plus sûrement inféodés et asservis que des pays prétendument dépendants.
D'autre part, l'impérialisme économique n'engage pas ses investissements dans l'intérêt des pays sous-développés ; il y voit seulement de bons placements. Aussi, cette forme d'impérialisme exclut-elle absolument les investissements sociaux.
Ce que les nationalistes qualifient de politique de dépersonnalisation sociale n'est, en réalité, que le malaise ressenti par une société qui, vivant repliée sur elle-même, selon des normes millénaires, s'est brutalement trouvée en contact avec une civilisation moderne.
En effet, tandis qu'au XVIIIème siècle l'Europe se développait dans la précipitation, le Maghreb restait, depuis le XIème siècle, identique à lui même et il est certain que sa structure sociale, en 1830, s'accommodait mal des exigences du XIXème siècle.
La France n'a pas délibérément voulu détruire la civilisation musulmane en Algérie, ainsi que les assertions malveillantes du F.L.N. le laissent supposer. Elle a simplement essayé de l'intégrer dans un système moderne auquel manifestement cette civilisation s'adapte avec difficulté. Il est évident, par exemple, que les structures modernes de la vie économique, politique et sociale ne pouvaient s'accorder avec l'archaïsme des coutumes et du droit musulman en certaines matières.
L'implantation en Algérie d'institutions occidentales qui avaient assez d'efficience pour faire éclater les structures traditionnelles d'une société patriarcale et tribale, sans pouvoir pour autant remplacer totalement les cadres qu'elles ébranlaient, a créé un malaise certain dans la société musulmane. La seule présence d'une communauté européenne importante qui a apporté avec elle tous les caractères de la civilisation occidentale, mode de vie, façon de penser, cadres sociaux, a fait naître chez les Musulmans, figés dans leurs traditions, un sentiment de frustration et a créé un problème humain incontestable.
CRITIQUE
Le colonialisme a essayé de faire disparaître la langue arabe. Les conséquences de cette politique : refus d'admettre l'enseignement de l'arabe dans les écoles officielles et nombreux obstacles à la libre éducation. Ce n'est que dans les instituts d'études islamiques et dans 3 medersas (cours suivis par moins de 500 étudiants) que les études arabes peuvent être poursuivies. Dans les écoles secondaires françaises, l'arabe est enseigné comme langue étrangère. L'ouverture d'écoles primaires libres est ouvertement empêchée par les autorités qui les font fermer fréquemment et arrêtent les maîtres.
RÉPONSE
Avant 1830
« Il n'y avait, ni à Alger, ni ailleurs, rien qui pût faire songer aux universités musulmanes d'« El Azhar » du Caire, de la « Zitouna » de Tunis, de la «Qaraouyine » de Fès. Il n'y avait véritablement aucune organisation de l'instruction publique, mais on donnait de nombreux cours, surtout religieux... L'enseignement demeurait partout médiéval, scolastique et suranné. » (Henri Weiler. — « Les Medersas », in « Cahiers pédagogiques pour l'enseignement du second degré », 10 novembre 1951.)
Après 1830.
La France s'intéressa d'abord à l'enseignement secondaire, qui devait ultérieurement fournir les cadres nécessaires à l'enseignement primaire de l'arabe.
Trois medersas furent créées en 1850, à Médéa, Tlemcen et Constantine. Par la suite, la medersa de Médéa fut transférée à Blida, puis à Alger et, finalement, à Ben Aknoun. Ces medersas ont été transformées en « lycées d'enseignement franco-musulman» en 1951.
Le rôle de ces medersas était de former des cadres pour l'enseignement de l'arabe (mouderrès), pour la justice musulmane (cadi, bachadel, adel) et accessoirement pour le culte musulman (muphti, iman).
Le corps des mouderrès fut créé en 1851. Compris parmi les agents du culte, le mouderrès était chargé de l'enseignement supérieur dans les mosquées de première classe où il faisait également des cours préparatoires à l'entrée dans les medersas
Nominés par le gouvernement général et inspectés par les directeurs de medersas, ils durent, à partir de 1895, être titulaires du diplôme d'études supérieures de ces établissements.
A partir de 1898, l'enseignement de l'arabe dans les écoles primaires d'indigènes devint obligatoire. L'arabe dialectal était enseigné à raison de deux heures trente par semaine dans les cours préparatoire, élémentaire et moyen, et l'arabe classique une heure par jour, dans les écoles qui préparaient au concours d'entrée dans les medersas
Les futurs instituteurs recevaient à l'Ecole Normale de la Bouzaréah la formation correspondante.
En 1938, les mouderrès furent autorisés à remplacer ces instituteurs pour l'enseignement de l'arabe.
En 1949, la fusion des enseignements A et B (anciens enseignements « européen » et « musulman ») unifia les programmes dans toutes les écoles primaires. A titre provisoire, les mouderrès furent chargés de donner quelques cours facultatifs d'arabe littéral dans les centres urbains importants.
Enfin, en 1951, les mouderrès, dotés d’un statut, furent chargés « en application de l'article 57 du Statut de l’Algérie» d’enseigner l'arabe dans les écoles primaires.
Situation actuelle.
Enseignement public. — L'article 57 du Statut de 1917 est ainsi conçu :
« La langue arabe constituant une des langues de l'Union française, les mêmes dispositions s'appliquent à la langue française et à la langue arabe en ce qui concerne le régime de la presse et des publications officielles ou privées éditées en Algérie.
« L'enseignement de la langue arabe sera organisé en Algérie à tous les degrés.»
D'autre part, il n'est pas prescrit que tous les élèves de nos établissements d'enseignement public soient obligés d'apprendre l'arabe. La doctrine a donc été jusqu'ici d'organiser et d'encourager l'enseignement de l'arabe sans l'imposer.
Un trouvera le détail de l'organisation de l'enseignement dans la partie : Documentation générale — Aspect social - Enseignement de la langue arabe.
Un problème complexe.
L'enseignement obligatoire de l'arabe aurait pour conséquence une meilleure compréhension entre les deux communautés. II se heurte pourtant à nombre de difficultés.
Ce qui importe pour la grande majorité des Européens, ce n'est pas tant de savoir lire et écrire l'arabe que de converser. Le choix de l'arabe dialectal s'impose donc, et l'enseignement doit insister sur la conversation (méthode directe, disque, magnétophone).
Il ne saurait être question d'enseigner aux jeunes Musulmans l'arabe dialectal : c'est leur langue maternelle.
Par contre, de solides connaissances en arabe littéral leur permettent :
- de lire la presse,
- de comprendre les émissions radiophoniques, les films et les pièces de théâtre,
- de lire le Coran,
- de converser avec les gens du Proche-Orient.
Faudra-t-il obliger les jeunes Kabyles à apprendre l'arabe ? Il est douteux qu'ils le souhaitent en majorité.
CRITIQUE
La juridiction musulmane est privée de sa substance, n'a pas de compétence pénale et ses décisions civiles sont sujettes à l'appel devant les tribunaux français. Les cadis sont intégrés parmi les juges français officiels payés et contrôlés par les autorités françaises.
RÉPONSE
Les juridictions musulmanes ont été maintenues et intégrées dans l'organisation judiciaire française, le cadi, juge musulman, conservant sa compétence en matière de statut personnel, de successions et d'immeubles dont la propriété n'est pas établie conformément aux lois françaises sur le régime foncier en Algérie ou par un titre administratif notarié ou judiciaire.
En 1830, à l'arrivée des Français en Algérie, le cadi n'avait, en effet, compétence ni en matière de droit pénal, ni en matière de droit commercial, domaines que s'était réservés le beylick.
Eu égard au caractère religieux qui s'attachait à sa fonction, le cadi, émanation du calife, représentant-délégué d'Allah, législateur suprême, était moins un juge qu'un « diseur de droit », gardien de l'orthodoxie musulmane. En conséquence, la procédure, devant lui, était purement contractuelle, et il n'exécutait pas la sentence ; celle-ci n'ayant même pas l'autorité de la chose jugée, son orthodoxie pouvait toujours être contestée. Dans l'Espagne musulmane, où existait une autorité centrale forte, siégeait au palais un magistrat qui, après consultation des juristes, avait la faculté d'annuler le jugement du cadi. C'est le précurseur du « vizir marocain des plaintes et des récriminations ».
En Algérie, on faisait appel au « Medjelés », assemblée de jurisconsultes, purement consultative, qui ouvrait toutefois une voie de rétractation. En tout état de cause, la compétence du cadi était limitée puisqu'il existait une voie de recours.
Par ailleurs, par application de la théorie de la nécessité, les Musulmans ont toujours considéré comme régulière la nomination d'un cadi par l'autorité infidèle.
Telle était la situation en 1830. Ce n'est que par ignorance de ces données que l'arrêté du général en chef du 22 octobre 1830, l'ordonnance du 10 août 1831, attribuèrent aux cadis officiellement reconnus et rétribués par le gouvernement français la connaissance de toutes les affaires musulmanes au civil comme au criminel. Les ordonnances du 28 février 1811 et du 26 septembre 1812 enlevèrent au cadi la compétence pénale qui devait être exercée par l'autorité française et selon la loi française, la France étant l'héritière de l'autorité administrative du dey ou des beys. Ces textes instituaient l'appel des sentences du cadi devant la Cour d'Alger, ce qui répondait à la tradition musulmane quand il existe une autorité centrale forte.
Le décret du 10 octobre 1831, faisant revivre les « Medjelès », désormais véritables juridictions du second degré, eut de fâcheuses conséquences. Le système sombra dans la corruption (on dut déférer en cours d'assises quelques-uns de ces magistrats musulmans), souleva les protestations des Musulmans eux-mêmes et dut être abandonné.
Non seulement la justice musulmane s'est maintenue, mais la diversité des coutumes et les particularismes ont été respectés. L'organisation judiciaire en Kabylie d'une part, et au M'Zab d'autre part, diffère de celle qui existe dans le reste du territoire.
Quoi qu'il en soit et quelles que soient les critiques auxquelles a pu donner lieu l'œuvre accomplie par la France dans le domaine de la justice, il faut reconnaître qu'elle s'est inspirée du souci de respecter les institutions et les usages des populations, de donner plus de garanties aux justiciables, de créer des juridictions mieux adaptées aux conditions modernes et d'humaniser la justice traditionnelle.
Un avant-projet de codification dit à M. le professeur Morand qui, bien qu'il s'agisse d'un travail préparatoire, fait autorité auprès des juristes musulmans et européens d'Algérie, ainsi que la Jurisprudence de la Chambre de révision musulmane de la Cour d'Appel d'Alger ont fait prévaloir, autant qu'il se pouvait, des solutions d'équité. C'est ainsi que le droit pour un père de marier sa fille d'autorité, ou droit de djebr, a été restreint, que l'on tend à substituer la preuve écrite à la preuve par témoins dans les contrats, que l'on exige pour la validité du mariage un acte dressé par le cadi, que la femme musulmane peut, dans certains cas, obtenir le divorce alors que jusqu'à une date récente le mari seul pouvait assez facilement répudier son épouse, qu'un terme a été mis à l'usure qui se pratiquait sous la forme d'un contrat de rahnia (antichrèse), etc...
L'application du code pénal français a donné à l'inculpé des garanties que la justice expéditive et sommaire de l'époque turque ne lui accordait pas. Quant aux peines appliquées jusqu'en 1830 : bastonnades, emmurements, pal et, pour un simple vol, ablation d'une main qui sont encore en vigueur dans certains Etats arabes, elles ne sauraient plus être admises dans un Etat civilisé. Faut-il regretter que la France ait travaillé à les faire disparaître ?
CRITIQUE
La politique coloniale française vise à saper la religion musulmane. Les rites religieux, la religion et la propriété habous sont contrariés. Sur 106 mosquées qui existaient à Alger en 1830, il n'en reste que 8 ; les belle mosquées d'Alger et de Constantine ont été transformées en cathédrales.
RÉPONSE
Dans la convention de capitulation d'Alger du 5 juillet 1830, il est assuré que « l'exercice de la religion mahométane restera libre». Cette déclaration est demeurée une des bases de la politique française en Algérie, et il est assez curieux de voir les nationalistes accuser maintenant la France de diminuer le prestige de la religion musulmane, après lui avoir maintes fois reproché de s'appuyer sur les éléments traditionalistes, les marabouts et les confréries religieuses, pour maintenir son autorité.
Les biens habous
Il faut, ici, distinguer le habous public du habous de famille.
Le premier est simplement une fondation pieuse ou faite dans un intérêt public. Le second l'est aussi, mais de façon immédiate : en attendant le jour où le bien habousé recevra effectivement sa destination, un certain nombre de destinataires en auront successivement la jouissance. En réalité, la fondation pieuse passe ici au second plan, elle n'est qu'un prétexte à réaliser une dévolution successorale différente de celle que prescrit la loi coranique.
En 1830, les habous publics avaient un très grand développement dans le pays : la plupart des maisons, boutiques, ateliers, jardins et vergers étaient en habous au profit de la Mecque et Médine, des mosquées marabouts, des pauvres, des routes, des eaux et assuraient, par leurs revenus, le fonctionnement des services publics élémentaires (voirie, culte, assistance, instruction, etc...) dont le beylik ne se préoccupait guère.
Par arrêté du 7 décembre 1830, le rattacheraient des habous publics au service des domaines fut prononcé. Moyennant quoi, l'administration des domaines aurait à pourvoir à tous les frais d'entretien des mosquées et à toutes les autres dépenses au payement desquelles les revenus des habous publics étaient affectés. L'Etat moderne, régulièrement organisé et équipé se substituait en Algérie au vieux beylik et prenait en charge les services publics auxquels seuls avait pourvu jusque-là l'initiative privée par des fondations habous. Il était juste et nécessaire qu'il recueillit les éléments d'actif en même temps que le passif.
Seuls les habous consacrés aux pauvres furent exclus de cette mesure. Ces biens furent remis aux bureaux de bienfaisance on, à défaut, aux communes.
Le bureau de bienfaisance musulmane fut créés à Alger, puis d'autres dans les différentes villes d'Algérie. Ces institutions charitables ont toujours fonctionné avec régularité.
Quant aux habous de famille, ils ont subsisté et la loi du 1er août 1926 a expressément fait entrer la matière de habous parmi les questions de statut personnel et successoral.
Aussi, la distinction des terres habousées et des terres non habousées s'étend-elle à toutes les terres de propriété privée : les terres francisées appartenant à des musulmans peuvent faire l'objet de habous comme les terres non francisées.
Non seulement les immeubles francisés peuvent être habousés, mais les juges musulmans sont compétents pour statuer sur les contestations relatives au habous, les cadis peuvent dresser des actes de habous se référant à des immeubles francisés et la question de validité d'un habous peut donner lieu à un pourvoi en annulation, alors même que le bien habousé n'est pas régi par la loi musulmane.
Le F.L.N. fait grief à la France d'avoir, à la conquête, intégré au domaine de l’état les habous publics. Or, l'un des premiers actes du gouvernement autonome de la Tunisie, conscient que l'expansion de l'agriculture tunisienne exigeait de toute urgence la solution du problème foncier, a été de décréter (31 mai 1956) — ce que n'aurait pu faire la puissance de tutelle - la nationalisation des habous publics.
Il se conformait en cela aux .vœux de l'U.G.T.T. qui avait dénoncé le caractère archaïque de cette institution, et au rapport adopté fin 1955 par le congrès du Néo-Destour à Sfax. Dans ce rapport était réclamée, outre l'interdiction de toute nouvelle constitution de habous, préjudiciable à la mise en œuvre de la politique de développement agricole de la Régence, la nationalisation des habous publics.
Le 17 juillet 1957, le Conseil des ministres tunisien a, en outre, adopté le décret portant abolition des habous privés et mixtes.
Les mosquées.
Il parait assez exagéré de donner le chiffre de 106 mosquées existant à Alger en 1830, et il semble que les nationalistes d'aujourd'hui commettent la même erreur que quelques fonctionnaires français de 1830 en gratifiant du nom de « mosquée » les sanctuaires plus ou moins délabrés et les nombreuses salles de prières disséminées à travers la ville.
Les témoignages de l'époque sont cependant unanimes :
« Alger renferme 10 grandes mosquées et 50 petites : la plus belle est celle que l'on a commencée en 1790 ; elle a 60 pieds de haut sur 10 de large, forme trois étages que soutiennent des colonnes de marbre blanc apportées de Gênes. Les autres mosquées sont fort simples, et semblables aux plus mesquines du Levant. » (Renaudot : « Alger - Tableau du Royaume, de la ville d'Alger et de ses environs ». Paris, 1830, p. 15.)
"... Alger a 9 grandes mosquées et 50 petites... » (Pananti : « Relation d'un séjour à Alger ». 1820.)
« ... Il y a à Alger 10 grandes mosquées et 50 petites... » (Laugier de Tassy, Paris, 1757 : « Histoire des Etats barbaresques qui exercent la piraterie », p. 259.)
« ... On y compte 10 grandes mosquées et 50 petites... » (Shaw, 1830 : « Voyage dans la Régence d'Alger », p. 291.)
L'agglomération algéroise compte actuellement 23 mosquées domaniales dont l'entretien est assuré par l'Etat, une vingtaine de mosquées privées, et une centaine de marabouts et de salles de prières aménagées dans les écoles coraniques.
S'il est vrai que trois mosquées d'Alger uni été transformées en églises, il convient pourtant de signaler qu'elles étaient toutes trois de rite hanéfite, rite prédominant en Turquie et pratiquement inexistant en Algérie au moment de la conquête turque. Ces trois sanctuaires étaient donc presque uniquement fréquentés par des Turcs, l'immense majorité des Musulmans d'Algérie pratiquant, même actuellement, le rite malékite.
CRITIQUE
De nombreuses facilités sont fournies aux missions évangéliques françaises (surtout les Pères Blancs).
RÉPONSE
La France a respecté les convictions religieuses des populations algériennes et l'on ne peut pas dire qu'elle ait favorisé des campagnes d'évangélisation massive des Musulmans. En fut-il de même lorsque les Arabes envahirent le Maghreb ?
Il parait difficile d'évaluer à plus d'un millier, sur 9000000 de Musulmans et après plus d'un siècle de présence française, le nombre actuel de convertis ou de descendants de convertis.
En ce qui concerne la christianisation des Musulmans, l'œuvre des Pères Blancs, ordre dont le créateur fut le cardinal Lavigerie, se solde par un échec. L'influence qu'ils exercent est fonction du rôle social dans lequel ils se sont cantonnés, ainsi que les Sœurs Blanches dont le dévouement à l'égard des populations autochtones ne saurait être contesté.
Les nationalistes qui savent à l'occasion faire appel à l'autorité spirituelle du pape, devraient prendre connaissance de l'encyclique « Fidei Donum » de S.S. Pie XII où il est reproché à la France d'avoir circonscrit et entravé l'évangélisation de l'Algérie.
CRITIQUE
L'éducation en français même est très limitée. Le pourcentage des analphabètes s'élève à 90 % et aujourd'hui deux millions d'enfants scolarisables sont privés de toute éducation. Deux enfants sur cent habitants vont à l'école. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, on ne compte qu'un étudiant algérien pour dix européens. A un niveau plus élevé, la proportion est de un Algérien pour douze Européens. L'éducation française en Algérie vise à dépersonnaliser les Algériens à qui l'on enseigne: « Vos ancêtres les Gaulois. »
RÉPONSE
Effectifs, en 1957, dans les différents degrés d'enseignement voir : Documentation générale -- Aspect social -- Enseignement.
Difficultés rencontrées.
Il est exact que près de 2000000 d'enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas encore scolarisés. Il est trop facile cependant de juger les résultats sans évoquer les difficultés rencontrées.
Les premières sont dues à la dispersion de la population. Il est difficile de créer des écoles dans des régions où il y a moins de cinquante enfants dans une aire de 5 km de rayon (et ces régions sont nombreuses sur les Hauts-Plateaux ou dans l'Atlas saharien). Il est difficile de scolariser les enfants de la population nomade (des classes nomades fonctionnent cependant au Hoggar) et d'obliger les instituteurs à vivre sous la tente et à se déplacer avec les tribus. D'autre part, il a fallu de longues années pour que la population musulmane accepte, dans certaines régions, la scolarisation des filles.
Enfin, outre ces difficultés créées par des conditions géographiques ou ethniques, reste à résoudre le problème financier.
Dans la conjoncture financière actuelle, la scolarisation massive de 2000000 d'enfants est pratiqueraient impossible. La construction de 40000 classes réclamerait plus de 100 milliards, le traitement annuel de 40000 instituteurs 24 milliards, si bien que l'ensemble absorberait la presque totalité du budget ordinaire de l'Algérie.
Or, à l'heure actuelle, le sixième du budget ordinaire est consacré à l'enseignement.
Toutes les dépenses supplémentaires devraient donc être prises en charge par la Métropole, qui devrait assurer en outre le logement des maîtres et leur recrutement.
On se demande comment une Algérie indépendante ferait face à ces charges énormes et si l'instruction des jeunes Algériens est vraiment l'une des préoccupations majeures des rebelles. La destruction de près de 300 écoles, la fermeture de 1000 classes pour cause d'insécurité, les grèves scolaires déclenchées en juin, en octobre 1956 et en janvier 1957, montrent que pour le moment l'éducation de la jeunesse est délibérément sacrifiée aux préoccupations politiques des dirigeants nationalistes.
L'Exemple de l'Inde.
L'exemple de l'inde, mérite à ce propos, d'être médité : « L’indifférence relative que la population manifesta à l'égard du problème de l'obligation scolaire, dès que le pays eut obtenu son indépendance, contraste de façon surprenante avec l'énergie qu'il avait mise à attaquer le gouvernement britannique parce que celui-ci n'avait pas rendu l'enseignement primaire gratuit et universel. Au contraire, l'impuissance du gouvernement national à mettre en vigueur l'article 45 de la Constitution (en raison avant tout de difficultés pratiques et financières) ne souleva même pas assez de protestations pour que cette question prit un caractère d'actualité politique. »
(L'obligation scolaire aux Indes - Etude de MM Saiyidan, Naikd, et Ahid Husain, publiée par l'Unesco, 1953)
LA FRANCE, PUISSANCE COLONIALISTE
CRITIQUE
La propagande française, fait beaucoup de bruit autour des réalisations françaises en Algérie. Il faut remarquer que la création de moyens de communication, d'habitations et d'équipement sanitaire, surtout dans les régions à population européenne concentrée sont les compléments de toute exploitation coloniale.
RÉPONSE
Il est évident que les moyens de communication ont été développés dans les régions à forte densité de population qui se trouvent le long de la côte. Mais les Musulmans, qui forment la majorité de la population dans ces régions, en bénéficient au même titre que les Européens. Les travaux d'initiative communale, qui se poursuivent depuis 1947, sont presque exclusivement destinés à améliorer les conditions de vie des populations isolées (viabilité - adduction d'eau - scolarisation). Un gros effort d'électrification rurale a été fait ces dernières années.
L'équipement sanitaire est destiné à tous, sans distinction. Soixante camions sanitaires automobiles parcourent le bled et dispensent des soins spécialement aux populations isolées des centres ruraux. C'est ainsi que les campagnes de vaccination au B.C.G. ont pu toucher plus de 7000000 de personnes hors des grandes villes. (Voir : Documentation générale - Economie : Rôle de la France.)
CRITIQUE
500000 Algériens environ vivent en France, la majorité d'entre eux a été obligée d'émigrer en raison des conditions déplorables de l'économie algérienne.
RÉPONSE
350000 Algériens travaillent actuellement dans des entreprises métropolitaines.
Peut-on reprocher à la France d'avoir pendant de longues années fait régner la paix entre tribus, d'avoir, par les mesures sanitaires dont aucun autre pays d'Orient ne bénéficie actuellement, fait augmenter le taux d'accroissement de la population de l'Algérie ? Car tout le problème est là : les ressources naturelles de l'Algérie sont limitées et sa démographie galopante. La solution qui consiste à limiter les naissances, solution que l'Egypte a songé à adopter, n'a jamais été envisagée pour l'Algérie du fait qu'elle est difficile à concilier avec les principes de la religion islamique.
Ainsi, chaque année, la population de l'Algérie se trouve accrue de 280000 êtres nouveaux qu'il faut nourrir, éduquer, soigner. Cette augmentation entraîne un accroissement de la population masculine active, tel que, selon des estimations fondées, il faudra, au cours des cinq prochaines années, trouver annuellement 70000 emplois nouveaux pour les jeunes gens en âge de travailler.
Le marché du travail algérien ne peut absorber en totalité ce contingent annuel supplémentaire de main-d'œuvre ; donc l'émigration d'une partie importante de 70000 nouveau-venus sur le marché du travail s'avère indispensable. L'Algérie devrait considérer comme sa plus grande chance ce débouché métropolitain qui permet une rentrée de fonds en Algérie voisine de 40 milliards (38 milliards en 1955, dont 6 milliards 861 millions d'allocations familiales).
A une Algérie indépendante, le problème du non-emploi se poserait avec la même acuité et cet important débouché ne serait pas nécessairement ouvert dans des conditions aussi favorables. Aucun des pays du Proche-Orient, tous sous-développés, ne pourrait absorber une main-d'œuvre venue d'Algérie. A l'heure actuelle, les travailleurs algériens en France bénéficient d'une priorité à l'embauche et d'une protection administrative vis-à-vis de la main-d'œuvre étrangère.
L'espoir d'une vie meilleure se situe donc pour l'Algérie sur l'axe Sud-Nord et non sur l'axe Est-Ouest, c'est-à-dire vers la France et non vers l'Egypte et les autres pays arabes.
CRITIQUE
L'Algérie révèle les caractéristiques typiques d'une économie coloniale dépendante de la France.
RÉPONSE
Il faut, sans aucun doute, entendre ici l'expression « économie coloniale » en son sens péjoratif, c'est-à-dire comme un système où le colonisateur se contente de tirer des profits du pays colonisé, sans avoir souci de sa mise en valeur rationnelle, ni des conditions de vie de ses populations.
Cette affirmation s'effondre entièrement devant un examen rapide des relations entre la Métropole et l'Algérie. L'Algérie, loin d'être un placement pour la Métropole, lui coûte beaucoup plus qu'elle ne lui rapporte. La France, en effet, fournit à l'Algérie un puissant concours : elle se charge d'une partie des dépenses qui appartiennent normalement à la puissance publique, sans récupérer de recettes ; elle assure les investissements que ne peut effectuer l'épargne algérienne ; elle accueille sur son territoire une partie de l'excédent de main-d'œuvre algérienne. Le total des dépenses et investissements s'est élevé à 15O milliards pour 1956 (dépenses militaires non comprises).
Si l'on ajoute qu'un tiers des investissements porte sur des investissements sociaux, non générateurs de recettes, il devient flagrant que l'Algérie n'est pas un pays « colonisé ». Cette proportion très importante est difficile à expliquer par des considérations autres que sociales el humanitaires. Elle excède largement et de propos délibéré les possibilités économiques et financières de l'Algérie, pays surpeuplé en plein effort d'équipement. L'Algérie, si elle était autonome et réduite à ses seules ressources, serait obligée, pour mener une politique économique d'un niveau équivalent à celle que la France poursuit dans ce pays, de sacrifier pendant plusieurs années les réalisations sociales à la constitution d'une économie solide.
Quant à l'affirmation selon laquelle la France a tenu l'économie de l'Algérie dans une dépendance étroite et ne lui a permis de développer que les secteurs dont elle pouvait tirer bénéfice, voyons comment elle peut résister à l'examen de quelques faits.
Secteur agricole.
On a souvent reproché à la France d'avoir permis le développement de la culture de la vigne sur 400000 ha (il ne faut pas oublier que les terres à céréales s’étendent sur 6200000 ha). La France produit elle-même quatre fois plus de vin que l'Algérie et n'avait absolument pas besoin de l'appoint algérien. Il est vrai que la culture de la vigne est pratiquée partout par les Européens. 38000 ha sur 400000 appartiennent pourtant à des viticulteurs musulmans. Il faut avant tout se rappeler le fait qu'un hectare de vigne nécessite 110 journées de travail par an (céréales : 15 jours seulement), que par suite la viticulture permet d'occuper une main-d'œuvre nombreuse et de distribuer 30 milliards de salaires par an.
La culture des agrumes est fortement encouragée, soutenue et protégée par la Métropole qui a limité les importations étrangères (beaucoup plus avantageuses), pour permettre l'écoulement de la production algérienne. Des cultures comme les lentilles, le riz et le coton, susceptibles d'employer une main-d'œuvre assez importante, ont été développées ces dernières années.
De plus, la culture du tabac, pratiquée surtout en milieu musulman, a fait l'objet d'encouragements financiers de la part du gouvernement.
Secteur industriel.
Les minerais de fer, dont la France n'avait que faire, ont toujours été exportés, surtout à l'étranger (en 1955 : 90000 tonnes en Métropole, 2217000 tonnes sur la zone sterling) ; les alfas également.
L'industrialisation n'a pas été freinée délibérément par la France, mais par différents obstacles comme le manque d'énergie et l'immensité des distances à parcourir qui augmentent considérablement les prix de revient.
Les récentes réussites de la recherche pétrolière dans le Sud algérien sont susceptibles de changer les données du problème et de permettre l'implantation rapide d'industries de transformation.
Malgré ces difficultés, et bien que l'exploitation pétrolière ne soit entrée dans une phase active, Ies produits industriels jouent un rôle de plus en plus important à l'exportation, alors que l'on enregistre une chute marquée dans les ventes de vin, blé, moutons, alfa. Ce n'est pas sans étonnement que l'on apprendra peut-être que la jeune industrie algérienne fournit à la France d'Outre-Mer des verres, des poteries, des ronds pour béton, des articles de ménage, des fils et câbles, des appareils électriques, des abrasifs, des livres, etc... La Métropole elle-même a acheté en 1955 pour plus de 850 millions de francs de papiers et cartons, et pour 230 millions de fils et câbles électriques. Sur tous les marchés méditerranéens et jusqu'en Amérique du Sud et en Asie, sont apparus des objets manufacturés d'Algérie : papiers, ronds à béton, matériel de cave, électrodes de soudure, superphosphates... Evolution significative, même si les chiffres demeurent modestes, car elle s'accompagne d'une baisse accusée sur les achats de divers produits livrés maintenant par l'industrie locale : chaux et ciments, agglomérés, engrais phosphatés, huiles raffinées, savon, soufre raffiné, sacs, matériel roulant de chemin de fer... Si l'on songe que l'effort d'équipement et la démographie ascendante ont notablement accru la consommation, une conclusion semble s'imposer : l'économie algérienne n'est absolument pas celle d'une colonie.
Les musulmans dans le secteur économique moderne
Au contact de la société européenne s'est créée une société indigène différenciée avec une classe de moyens propriétaires fonciers, une bourgeoisie industrielle et commerçante, un prolétariat ouvrier et plus encore un prolétariat agricole. Lorsque l'on considère par exemple que certaines coopératives comme les Tabacoops comptent une grande majorité d'adhérents musulmans, que plus de la moitié des sociétaires des Caisses de crédit agricole mutuel sont des agriculteurs indigènes, que le nombre des Musulmans vivant de « professions libérales et administratives » est égal à celui des Européens, qu'il est supérieur pour les « Transports », presque le double pour l'ensemble des industries et plus du double pour le commerce, on doit nécessairement en conclure qu'une véritable assimilation s'est produite sur le plan économique.
CRITIQUE
L'industrialisation pourrait être rapide dans la mesure où du fer, du zinc, des phosphates, du charbon et du pétrole pourraient être trouvés dans le pays.
RÉPONSE
Cette phrase pourrait laisser supposer que la France a négligé de rechercher les ressources minières en Algérie ; alors qu'en fait, la recherche minière a été entreprise dès 1830. Si l'on ne peut faire reproche au gouvernement turc de la Régence de n'avoir pas doté l'Algérie de réalisations dont la possibilité n'est apparue qu'au XXème siècle, il faut toutefois constater qu'il ne s'est jamais occupé de l'exploitation, possible alors, des mines existantes et que la France a pris dans ce domaine la relève de Rome. Seuls des vestiges romains, puits et descenderies, ont été retrouvés dans l'important gisement de l'Ouenza au moment de sa mise en valeur. L'exploitation minière se limitait, aux époques arabes et turques, à l'utilisation locale et à.. ciel ouvert de quelques gisements peu importants.
Or, la production moyenne des quelques dernières années s'élève :
pour le fer à 3000000 de tonnes
pour le phosphate 700000 tonnes
pour le charbon 300000 tonnes
c'est-à-dire que dans ce domaine, qui avait été négligé pendant des siècles, la France a tout fait.
Depuis 1946, la création du Bureau de recherches minières a donné une impulsion considérable à ce secteur de l'économie et a surtout étendu la recherche au Sahara. Des gisements nouveaux de fer (Gara-Djebilet) ont été découverts au Sahara occidental et pourront être utilisés par la sidérurgie. Toujours dans la même région, un gisement de manganèse continence à être exploité. Grâce à la découverte de charbon dans ce secteur (Ghorassa, Chebana, Zekaka, Dehab), on envisage la création sur place d'une industrie de ferro-manganèse.
La recherche pétrolière a donné des résultats certains en plusieurs points (voir documentation générale - Economie : Pétrole).
CRITIQUE
La colonisation a fait apparaître un féodalisme agraire reposant sur une politique d'expropriation massive : 11600000 ha de terres appartiennent aux colons français et à I'Etat français. Sur 2400000 ha de terres appartenant à 25795 colons, 1700000 ha proviennent de la colonisation officielle; 72,47% des colons possèdent de grands domaines. Ce sont les agriculteurs européens qui produisent la plus grande partie des exportations et en retirent les bénéfices.
RÉPONSE
La colonisation a mis en valeur ou récupéré des terres jusque-là incultes ou insuffisamment exploitées. Notamment par I'assèchement, l'assainissement des plaines littorales marécageuses, la mise en culture des plaines qui jusqu'en 1830 étaient considérées comme terrains de combat, « Bled el-Baroud », et de ce fait sous-exploitées. d'autre part, Thèmes de : les terres du Sahel et de la Mitidja n’ont pas été confisquées puisque jusqu'en 1856 fonctionnera une commission chargée d'établir Ies droits de propriété dans cette région. Le « séquestre » de 1840 ne fut, en effet, jamais appliqué.
La répartition des terres est la suivante :
Domaine de l'Etat………………..4694214 ha
Communaux……………………...4179050 ha
Domaine public…………………..539 315 ha
Exploitations musulmanes ……..7349166 ha
Exploitations européennes……..2726266 ha
Exploitations européennes.
Sur 22037 exploitations européennes, qui occupent 2726666 ha, on compte :
- 13 017 exploitations, soit 59% de l'ensemble, de 0 à 50 ha,
- 2 635 exploitations de 50 à 100 lia,
- 2 588 exploitations de 1.00 à 200 lia,
- 3 797 exploitations de plus de 200 ha,
soit, pour cette dernière catégorie, 17 de l'ensemble.
La réforme agraire récemment entreprise a déjà prévu la récupération de plusieurs centaines de milliers d'hectares de terrains domaniaux et de. 100 000 hectares provenant de l'expropriation de grands domaines, l'ensemble des terres récupérées devant servir au recasement des petits fellahs.
Les exportations agricoles et leur contrepartie
Terres labourables : 7 000000 d'hectares.
Vignobles : -1011 000 hectares. Terres à céréales : 6 200 00(I hectares.
Exportation des vins d'Algérie : 50 à 60 milliards de francs par an, qui constituent la contrepartie des produits que l'Algérie doit importer pour nourrir et vêtir sa population :
160000 t. de sucre 12,5 milliards
22000 t. de café 7 milliards
3800 t. de blé 1,2 milliard
13500 t. de tissus (colon rayonne) 13,5 milliards
Vignoble : 110 journées de travail par hectare et par an, permet d'employer une main-d'œuvre nombreuse.
Céréaliculture : 15 journées de travail par hectare et par an.
Salaires annuellement distribués au litre de la viticulture : 30 milliards.
CRITIQUE
Le fait que les gouverneurs aient souligné sans cesse l'existence d'un problème économique et social grave en Algérie est, déjà, la condamnation la plus frappante du régime colonial.
RÉPONSE
Faut-il conclure qu'il eût mieux valu qu'ils n'en eussent pas souci ? Ce problème se poserait avec une gravité accrue à une Algérie in-dépendante qui, de plus, n'aurait pas les moyens de le résoudre.
CRITIQUE
Le colonialisme est à la base de la guerre qui a lieu actuellement en Algérie.
RÉPONSE
Une guerre contre le colonialisme devrait logiquement frapper les «colonialistes».
Or, les pertes civiles dues à la rébellion s'établissent comme suit au 1er juin 1957.
7310 tués, dont 6400 Musulmans, dont 154 femmes et 61 enfants,
et 990 Européens, dont 75 femmes et 29 enfants.
95 % des « colonialistes » tués ou mutilés étaient des ouvriers, de petits fonctionnaires (gardes champêtres, cantonniers, gardes forestiers, gardes-barrières, etc...), de petits propriétaires.
Etrange « colonialisme » dont les représentants ne sont traités comme tels que parce qu'ils sont isolés, désarmés, ou qu'ils refusent d'obtempérer aux menaces de leurs « libérateurs
UN GOUVERNEMENT DE MINORITÉ
CRITIQUE
La population de l'Algérie est de 11 millions d'habitants parmi lesquels une minorité étrangère de 850 000 habitants.
RÉPONSE
Population totale de l'Algérie en 1957 : 10 000000 d'habitants, dont 1 000000 non-Musulmans et 9 000000 Musulmans.
Le F.L.N. devrait préciser, à l'usage des membres de l'O.N.U., depuis combien de générations il est nécessaire, selon lui, d'être implanté dans un pays pour y être considéré comme non-étranger. Certains Algériens européens sont installés ici depuis quatre, cinq ou six générations.
CRITIQUE
Pour la France, l'Algérie est le prolongement de la France métropolitaine et constitue des départements français soumis à la souveraineté française.
RÉPONSE
Les nationalistes enfoncent ici une porte ouverte. Le gouvernement actuel ne se donnerait pas tant de mal pour rechercher des solutions à la question algérienne s'il considérait l'Algérie comme un prolongement de la France.
CRITIQUE
L'assimilation de l'Algérie à la France est l'expression d'une décision unilatérale du corps législatif français.
RÉPONSE
La politique de la France a consisté à doter l'Algérie d'institutions inspirées des mêmes principes directeurs que les siennes, mais adaptées aux conditions locales particulières. Cette adaptation n'a pas toujours été facile et, comme toute œuvre humaine, a fait, au cours du siècle écoulé, l'objet de pas mal d'erreurs et de faux pas. La politique d'assimilation qui a été envisagée à certaines époques n'a jamais pu réussir car la France a toujours respecté le statut personnel et les croyances des Musulmans. Elle a été abandonnée. définitivement depuis de nombreuses années (voir Documentation générale : Evolution des institutions).
Entre les récentes réformes qui se conforment plus que jamais à la personnalité algérienne et le lent acheminement des institutions qui ont conduit l'Algérie à son état actuel, il existe seulement une différence de rythme. Il est indéniable que le mouvement d'évolution a été considérablement accéléré ces derniers temps.
Politiquement, le respect du statut personnel des Musulmans en matière de personnes, de succession et de propriété, posé lors de la capitulation d'Alger en 1830 et confirmé par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, a toujours été maintenu. S'il ne reflétait, à l'époque où les droits politiques des Musulmans étaient nuls, qu'une manifestation de l'esprit de générosité de la France vis-à-vis de populations dont les us et coutumes différaient des siens, il a constitué, au fur et à mesure que les droits politiques leur étaient accordés, un avantage qui devient depuis 1914 un véritable privilège.
Une évolution parallèle a affecté l'accession des Musulmans à la fonction publique. Jusqu'en 1866, le Musulman d'Algérie ne peut accéder à aucun poste administratif. A cette date, un décret donne une liste. (qui sera élargie par la suite à deux reprises) des emplois qui lui sont accessibles. En 1919, une loi limitative énumère les fonctions d'autorité (relativement restreintes) qui lui sont interdites.
En 1944, toutes les fonctions administratives lui sont ouvertes. En 1956, une réforme qui a un caractère révolutionnaire, puisqu'elle enfreint en sa faveur le statut de la fonction publique, lui octroie pendant quelques années (et ce pour compenser le handicap de beaucoup d'entre eux) des avantages substantiels qui doivent lui permettre de prendre rapidement sa véritable place dans la gestion des affaires du pays.
En résumé, au niveau des principes, le dessein de la France était de doter l'Algérie d'un système d'institutions analogues à celles de la Métropole. Au niveau d'application de ces principes, le gouvernement français a toujours eu souci de respecter la personnalité algérienne. Aussi est-il facile aux nationalistes, qui veulent ignorer ce double aspect de la politique française, de critiquer les applications au nom des principes, et les principes au nom de leur application.
CRITIQUE
Le peuple algérien n'a jamais été associé, ni directement, ni indirectement à l'établissement des textes et lois.
RÉPONSE
Il suffira ici de rappeler que depuis 1946 l'Algérie était représentée à l'Assemblée nationale par 30 députés, dont 15 musulmans ; au Conseil de la République par 14 conseillers, dont 7 musulmans ; à l'Assemblée de l'Union française par 12 délégués, dont 6 musulmans.
Les événements actuels, qui ont rendu des élections impossibles, ont privé tous les Algériens, européens et musulmans, de leurs représentants à l'Assemblée nationale.
Algérie 1957, ministre de l’Algérie
|
|
JEAN BART, n’était pas qu’une plage
Pieds-Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui 28 N°184 - Avril 2010
|
Jean-Bart est une petite ville côtière d'Alger du nom du corsaire dunkerquois. Cette commune constitue la pointe est de la baie d’Alger.
Histoire
Quelques siècles av. J.-C., les Phéniciens fondent sur cette terre le comptoir punique de Rusguniae (La Pérouse) et, sur I'autre bout de la baie, Icosium l'actuelle Alger.
. De 33 av. J.-C. à 27 av. J.-C., I'empereur romain Auguste s'y installe et en fait une colonie romaine.
. 253 la ville est attaquée par des pirates qui la saccagent.
. Au IVème siècle, les Byzantins y construisent une basilique chrétienne au IVème siècle qui deviendra le siège d'un évêché.
. 1540, Charles-Quint bat en retraite à La Pérouse avant de rembarquer après son échec dans sa tentative de prise d'Alger.
. 1661, construction du fort turc sous le règne d'Ismail Pacha.
. 1892, création du hameau de Jean Bart dépendant de la commune de Aïn-Taya.
. 1897, création du village de pêcheurs de La Pérouse toujours dépendant de la commune de Aïn-Taya.
. 1920, création de la commune de Cap Matifou séparée, de Aïn-Taya. (Elle sera de nouveau rattachée à Aïn-Taya en 1963).
 Jean Bart, Surcouf, La Pérouse, ces villages aux noms évocateurs - créés à l'origine pour accueillir des pécheurs bretons ne semblent pas en avoir retenus beaucoup... Jean Bart, Surcouf, La Pérouse, ces villages aux noms évocateurs - créés à l'origine pour accueillir des pécheurs bretons ne semblent pas en avoir retenus beaucoup...
Jean Bart, hameau de la commune de plein exercice d'Ain Taya qui est à 4km Ouest.
Dans un guide de 1900, on pouvait lire : "Créé en 1892 à 1 km Est du phare de Cap Matifou. Station de pêcheurs français en voie de peuplement sur la route d'Aïn Taya à Alger. Des emplacements sont réservés pour les industriels qui désireraient créer des fabriques de conserves.
La vie d'un village de pêcheurs
Georges Kopp, originaire de Jean Bart, nous livre quelques souvenirs : " Jean Bart était un village peuplé de quelques familles l'hiver, il devait compter une soixantaine d'âmes ; par contre l'été avec l'arrivée des " estivants ", on passait cinq à six cents personnes. Il y avait donc deux saisons, I'hiver, réservé aux pêcheurs et l'été qui durait de Juin à tin Septembre, soit au maximum quatre mois. Pratiquement il fallait compter du 1er Juillet au 15 Septembre, date où commençaient les vents d'ouest amenant le mauvais temps.
Le village était constitué d'une rue centrale large, et bordée de maison, à I'identique ou peu s'en faut entrecoupée au bas. dans son milieu et à la sortie de rue perpendiculaire. Une place spacieuse pour un petit village, servait à installer le bal pour la tète votive, délimitée par le Café Rossi, tenu par une famille de plusieurs enfants, tous pêcheurs.
En face se trouvait l'épicerie Cazanova dont le fils Zozo était un ami, avec qui nous courions le long des falaises, à la recherche des cyclamens, de la salade des champs " la Croustalline " espèce de pissenlit à feuilles plus épaisses et grasses, au moment du passage des petits oiseaux à la chasse aux pièges en nous gardant bien d'être surpris par le garde-champêtre.
En haut du village, se trouvait l'école avec sa cour de récréation et sa salle d'étude prolongée par le préau, et les sanitaires reconnaissables par leur petitesse, construits spécialement pour les enfants ; pour y parvenir, il fallait monter douze marches en ciment, qui nous servaient de sièges, c'est là que nous pouvions nous réunir, discuter, et prendre toutes nos décisions, concernant nos promenades, la chasse, la pêche, ou toute autre considération peuplant notre univers enfantin.
L'église Saint-Pierre de Jean Bart fut construite en 1894.
Et puis, il y avait la mer. Cette Méditerranée, si belle, si calme, et si prompte à se mettre en colère " mare nostrum "
Jean Bart, c'était d'abord la mer, un sentier amélioré au cours des ans, par des escaliers larges et pénibles à monter; étant donné la déclivité, continué par un chemin menant à deux plages, à droite de sable fin, utilisées par des plaisanciers, et les vacanciers, où se trouvaient deux ou trois "pastéras" barques à fond plat, et à une paire de rames.
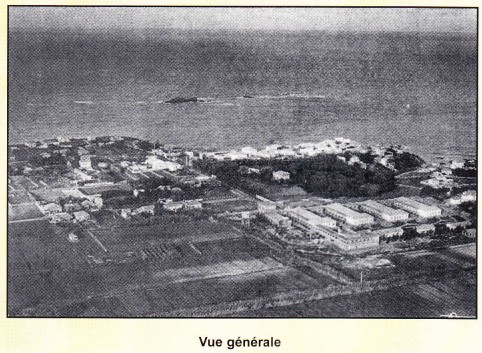
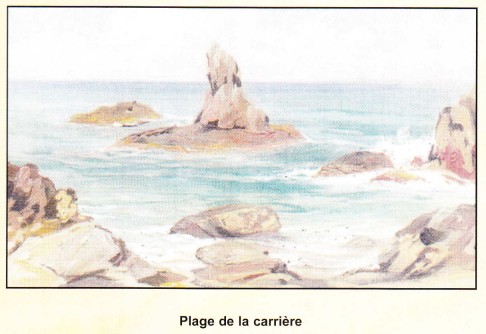 .
En continuant la route, on arrivait au bas de la falaise au port-plage de sable plus gros, où I'on pouvait, à l'aide de treuils tirer les bateaux de pêche au sec. Ces bateaux étaient tous plus ou moins sur le même modèle, plus ou moins longs, à deux ou trois paires de rames ; c'étaient des barques Napolitaines reconnaissables à leurs avant, toutes porteuses d'un phallus stylisé.
Pour les hisser à terre, il fallait être à plusieurs pour tenir le bateau pour éviter son devers d'un côté ou l'autre, et pour tirer sur le câble joint à une poulie solidement ancrée au sol. Et ce de jour et de nuit, car la grande bleue n'a pas de marée perceptible, variant seulement de quelques centimètres, mais la pêche n'a pas d'heure, et les sorties de nuit étaient fréquentes.
La pêche se faisait par filets, soit la bonitière, filet à mailles plus grandes, pour les bonites et autres poissons bleus, et à la saison « le trois mailles » pour les poissons plus petits, la fameuse bouillabaisse ou friture.. du golfe...
Plusieurs catégories de pêcheurs, les professionnels comprenant : ceux qui utilisaient les filets, et ceux qui pêchaient avec les lignes, les "pareilles" et les " palangres" et les lignes de " fond ". Quant aux plaisanciers dont j'ai toujours été, nous pêchions à la "palangrotte" ou à la ligne morte à un seul hameçon ; quelquefois certains d'entre nous, étaient attirés par les "palangres " mais nous avons toujours considéré que ce n'était pas de la pêche, car le poisson se prend seul, et qu'il n'y a plus qu'à le ramasser, mais cela n'engage que moi, n'est-ce pas mon ombre ?
Jean Bart était une réplique de la côte bretonne, un havre entouré de rochers qui défendaient I'entrée de deux " passes ", l'une était plein Est, préservée par trois petits rochers à fleur d'eau, qu'il fallait bien connaître pour ne pas se mettre au sec dessus et crever son bateau, l'autre, "Nord Est" gardée par la "pointe" et par une masse de trois gros rochers hauts et bien visibles, l'un dénommé le Rhinocéros nous servait de plongeoir; la seule difficulté était de pouvoir grimper dessus les pieds nus, en évitant les oursins qui pullulaient, et les aspérités du rocher coupant comme des lames de rasoir.
Chaque fois que le vent était à I'Est, que le " Guergal " soufflait, en réalité un vent de Nord-Est identique au "Mistral " en Provence, et qui durait 3- 6-9 jours, la mer était agitée et contre les rochers se formait de l'écume propice à la pêche au Sar ou autre poisson du même genre. Le père Arlandis, un spécialiste du "roseau", car à cette époque nous n'avions pas à notre disposition les cannes à lancer, les moulinets sophistiqués, et nous nous contentions d'un bon gros roseau choisi parmi tant d'autres et bien nettoyé.
Et ce coin de la pointe était sa place favorite, on le voyait au moment propice, grimper avec tout son attirail, cannes, bidon de "bromitche " pâte constituée de fromage pourri, sardine pilée, pain trempé et sable ; servant à attirer le poisson ainsi que sacoche, contenant les lignes de rechange ; au retour on était sûr de voir dans son panier, oblades, sars, mulets.
Les falaises mesuraient en gros six, dix, douze mètres de haut juste au-dessus du port, dominait "La Smala" grande bâtisse, genre un peu caserne, construite par des amis de mes parents, la famille Todd, famille très nombreuse comprenant enfants, nièces, neveux, cousins, la maison occupait le haut du cap préservant le port, face à l'île Sandja, située à un demi mille en mer, c'était la construction la plus avancée, et paraissant être la proue d'un immense navire.
Port de pêche à la pointe du Cap Matifou ; fut créé en 1892, les plages, ses falaises la pêche, la plongée sous-marine attirent irrésistiblement les Algérois vers ces lieux où plusieurs maisons blanches et coquettes solidement construites derrière chacune d'elles un petit jardin où des légumes de toutes sortes abondent, une jolie fontaine en face de l'école, des rues, une grande place. Jean Bart devint très vite une station balnéaire très fréquentée. En effet, Jean-Bart connaissait un régime climatique plus agréable que celui d'Alger. Le vent d'Est nous tenait compagnie.
C'était notre baromètre : il chassait la pluie, et le mauvais temps.
Jean-Bart, c'était I'entente entre tous, chrétiens, arabes, juifs, c'était la joie de vivre. Je me souviens des premiers bals, I'après-midi, le dimanche et les jours fériés chez Madame Emile (Sensenbrenner).
Les concours de boules au jeu national et à la pétanque, les fêtes annuelles au mois d'août, qui duraient trois jours pendant lesquels toutes sortes de manifestations s'y déroulaient : courses aux sacs, à la nage, la place était toute illuminée et décorée. Il y avait des manèges et des baraques de vaisselle : jeu des anneaux et le mât de cocagne en plein centre de la place auquel étaient suspendus toute sorte d'objets qu'il fallait décrocher. Un orchestre faisait tournoyer les couples, les après-midi et les soirées jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Et le vent d'Est était toujours de la partie et cela se terminait par un feu d'artifice.
Pour moi, que Jean-Bart a vu naître, il y a plus de 60 ans et que hélas j'ai dû quitter, je ne pourrai jamais oublier tout cela. Madame Planet, mon unique institutrice, l'église où j'ai été baptisé, le facteur qui portait les bonnes et les mauvaises nouvelles. Monsieur Marcel LAGET qui fut unique facteur pendant toute sa carrière.
En face de l'école, il y avait une fontaine, où I'eau était toujours très fraîche, il y avait des mûriers qui longeaient l'école, cela faisait notre joie l'été lorsque les fruits étaient bien mûrs.
Ainsi se termine les souvenirs de notre vie passée en Algérie, dans ce coin charmant de Jean-Bart où le mot amitié avait encore un sens, où la ségrégation était inconnue, le racisme inexistant.. et puis vint l'horreur, la guerre avec son masque hideux, les exactions, les viols, les assassinats qui obligèrent à partir en délaissant malgré nous ceux qui avaient aimé la "France" et I'on payé de leur liberté et de leur vie.
Merci à Georges Kopp pour ses souvenirs
|
|
lN MEMORIAM Roger DEGUELDRE
[1925-1962]
Par Secours de France
ACEP-ENSEMBLE N° 291
|
|
Un témoignage historique, inédit, émouvant
Le lieutenant Roger Degueldre, avant d’être fusillé au Fort d'Ivry le 6 juillet 1962, n'avait voulu requérir devant les hommes qu'un seul témoignage au cours de son procès : celui du colonel Hervé de Blignières, qui avait été son chef en Indochine, puis dans la clandestinité de l’OAS Métro.
La Cour Militaire de Justice n'aurait eu aucun mal à faire comparaître sous bonne escorte cet unique témoin de la défense, le colonel de Blignières se trouvant alors en prison...
Mais le générai De Gaulle intervint immédiatement en personne pour interdire celte déposition.
Secours de France publie ici l’intégralité du témoignage que le colonel de Blignières adresse alors aussitôt par écrit au général présidant la Cour Militaire de Justice, témoignage qui sur ordre de I’Elysée ne sera pas lu ni versé aux minutes du procès.
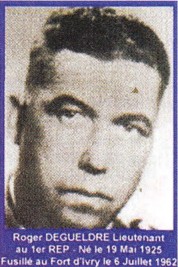 C'est un document historique, totalement inédit, particulièrement émouvant et précieux pour tous ceux qui, comme nous, s'attachent à rétablir la vérité sur le combat de ces hommes exceptionnels qui ont tout sacrifié à I’idée qu'ils se faisaient de la France, et de la parole donnée. C'est un document historique, totalement inédit, particulièrement émouvant et précieux pour tous ceux qui, comme nous, s'attachent à rétablir la vérité sur le combat de ces hommes exceptionnels qui ont tout sacrifié à I’idée qu'ils se faisaient de la France, et de la parole donnée.
Mon Général : à I'heure où le Lieutenant Roger Degueldre est appelé à comparaître devant la Cour de Justice Militaire, j’ai l'honneur de solliciter de votre pouvoir discrétionnaire l'autorisation d'apporter mon témoignage en faveur de mon ancien subordonné.
Je tiens à le faire à un double titre : d'abord parce que j'ai contracté envers lui une dette personnelle de reconnaissance du fait que, voici douze ans, en Indochine, il m'a sauvé deux fois la vie dans la même journée ; ensuite parce que, comme officier de Légion, j'ai le devoir de rendre l'hommage qu'elle mérite à l'exceptionnelle carrière qui l'a conduit si rapidement de simple Légionnaire au grade de Lieutenant à titre étranger.
Je connais Roger Degueldre depuis l'été 1948, où il servait déjà comme maréchal-des-logis chef dans mon escadron du Premier Etranger de Cavalerie.
Pendant plus de deux ans, je l'ai eu sous mes ordres directs en Indochine.
Je l'y ai retrouvé à mon deuxième séjour, alors qu'il servait au Bataillon Etranger de Parachutistes. En prenant en 1958 le commandement du 1er REC en Algérie, fort de la réputation du Sous-Lieutenant Degueldre dans toute la Légion, j’ai cherché à le récupérer pour son régiment d'origine, en arguant d'une blessure au genou qui lui rendait pénible le saut en parachute. Bref, je n'ai cessé de le suivre jusqu’à la fin de 1960 où j'ai quitté l’Algérie.
Il avait tout arraché au feu si, pour un Légionnaire, la carrière de Degueldre est fulgurante, ses titres de gloire ne sont pas moins exceptionnels. Ses grades successifs, comme ses innombrables citations, sa Médaille Militaire et sa Légion d'Honneur, il les a tous arrachés au feu - ce qui, même pour un soldat de carrière, n'est malheureusement pas si commun...
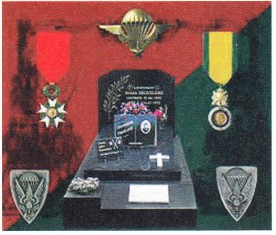 Depuis quelques temps, une campagne d'intoxication de l'opinion publique tend à minimiser, sinon ridiculiser, les décorations accrochées aux poitrines de ceux qui n'ont cessé de se battre hors d'une métropole qui voulait tout ignorer des sacrifices de l'armée. Devant de hautes personnalités militaires, il serait malvenu de ma part d'insister sur le prix du sang versé par nos soldats de métier, notamment les Légionnaires. Mais, concernant les exploits de Degueldre, je tiens au moins à préciser l'un d'eux, dont j'ai été à la fois le témoin et le bénéficiaire. Depuis quelques temps, une campagne d'intoxication de l'opinion publique tend à minimiser, sinon ridiculiser, les décorations accrochées aux poitrines de ceux qui n'ont cessé de se battre hors d'une métropole qui voulait tout ignorer des sacrifices de l'armée. Devant de hautes personnalités militaires, il serait malvenu de ma part d'insister sur le prix du sang versé par nos soldats de métier, notamment les Légionnaires. Mais, concernant les exploits de Degueldre, je tiens au moins à préciser l'un d'eux, dont j'ai été à la fois le témoin et le bénéficiaire.
Le 21 janvier 1950, dès les premières minutes d'une reconnaissance sur un poste récemment pris par le Viet Minh, le maréchal des logis chef Degueldre perdait son officier et 9 des 24 Légionnaires que comportait son peloton amphibie. Seul, sans aucun soutien, il faisait face à une compagnie ennemie.
Non seulement il permettait à tout I'Escadron d'intervenir une heure plus tard, mais entre-temps, fixant un adversaire dix fois supérieur en nombre, il récupérait ses morts, ses blessés, et tout l'armement perdu.
A I'heure de I'assaut, après trois heures d'un combat acharné, il était toujours là avec sa poignée de Légionnaires, et devait encore ramasser sur le terrain son Capitaine (moi-même) et un autre officier, fauchés quelques instants avant la conquête de la position Viet Minh.
Quinze ans de lutte et de don de soi. Le détail des faits n'apporterait rien de plus, puisque ce résumé prouve que Degueldre faisait déjà preuve, non seulement d'un courage physique et d'un sang-froid extraordinaires, mais aussi de dons de commandement qui n'ont cessé par la suite, bien avant l'heure, de lui valoir ses responsabilités d'officier. Son comportement au combat a toujours été de la même veine, et je doute que tous ces beaux esprits qui, à son sujet, évoquent allègrement le sens de l'Honneur et du devoir, aient une notion bien nette de ce que ces mots signifient de "don de soi" pour un homme qui a donné l'assaut pendant quinze ans dans la jungle et la rizière, dans les djebels et au cœur des oueds.
Un homme de son intelligence et de son ouverture d’esprit ne s'impose pas cette lutte permanente s'il n'a la foi en la valeur de son combat. Il me semble que la personnalité du Lieutenant Degueldre se caractérise surtout par une volonté de fer et une générosité naturelle au service d'un idéal à la mesure de son équilibre physique et moral, comme de son culte de l'Honneur.
Dans le cadre des missions d'après guerre de l'Armée Française, dans le moule de la discipline de la Légion Etrangère, dans le respect de l'éthique que ce corps d'élite a su proposer à ses hommes, la forte personnalité de Degueldre a pu trouver son épanouissement. Conformément aux traditions de cette Arme, je ne m'aventurerais pas à décrire le "jardin secret de son âme", mais je sais ce qu'il a été comme soldat et je connais les objectifs de ses combats.
Sur le plan professionnel, je dirai simplement que parmi les sous-officiers placés sous mes ordres en Indochine, il était le meilleur et de beaucoup, montrant déjà la classe et la maturité qui devaient lui valoir quelques années plus tard son galon d'officier dans les unités de parachutistes.
Il y a deux ans encore, plusieurs unités se le disputaient comme un des meilleurs de sa génération : en seize ans de Légion, Degueldre, dont les qualités de baroudeur s'étaient affirmées de façon éclatante, n'est jamais apparu comme une sortie d'aventurier. Bien au contraire : son sens de la discipline la plus stricte et sa conscience professionnelle le rangeaient dans la catégorie la plus classique et la plus solide de nos cadres. Sa finesse, sa sensibilité et aussi son doigté dans le commandement I’éloignaient de cette caricature brutale et simpliste qu'une certaine littérature se plaît à trouver sous le képi blanc,
Mais Degueldre est aussi un passionné pour qui la compromission, la demi-lâcheté envers soi-même et I'attentisme dans I'action apparaissent comme autant de crimes contre l'Honneur militaire. Je ne doute pas qu il n'ait été fortement impressionné par tous les aspects de cette guerre qu'il n'a cessé de mener outremer aux points les plus dangereux.
Comment Degueldre aurait-il pu oublier ?
Il me paraît impossible qu en 1961, il ait oublié les drapeaux rouges à faucille et marteau qu'il glanait des 1949 avec ses hommes dans les marais de la Plaine des Joncs ; impossible aussi qu'il ait effacé de son regard la marée humaine de ces Tonkinois qui, en 1954, s'accrochaient à nos barreaux déjà pleins de soldats abandonnant au Viet Minh le delta du Fleuve Rouge ; impossible enfin qu'au cœur d'Alger, voici un an, il n'ait pas revécu "sa" bataille de 1957 pour délivrer la capitale algérienne de la terreur FLN ; Qu’il n'ait pas songé aux centaines de morts de "son" régiment dans ses victoires de Guelma ; qu'il n'ait pas rêvé à l'allégresse pacifique et chargée d'espérance des journées de fraternisation de mai 1958, dont il était un peu l'auteur...
On ne gagne pas trois batailles sans foi chevillée au corps, et Degueldre, avec le 1er REP, avait gagné aux frontières, il avait gagné à Alger, il avait gagné la paix du Forum.
La raison d'Etat peut s'autoriser de motifs supérieurs pour tout détruire. Rien ne permet de tuer l'âme d'un soldat !
Par une suite de maladresses de commandement qu'il ne m'appartient pas d'exposer, dans un contexte général d'abandons inscrits sur le terrain, on a voulu détruire cette âme en Roger Degueldre, en brisant mieux que I’épée qu'il n'avait cessé de tenir pour la défense de son drapeau. Car, que peut-il bien rester dans I'âme d'un soldat dont on renie la foi en la valeur de son combat et l'espérance en la valeur de son sacrifice mille fois renouvelé ?
L'univers légionnaire ne vit que de Foi, d'Espérance et d'Honneur. En détruisant ces trois vertus, il ne reste plus rien, rien surtout pour un idéaliste comme Roger Degueldre. Parce que je le connais, parce que je le sens, parce que je le sais..,
Au nom des 10.000 Légionnaires qui, pendant les six ans de campagne de Roger Degueldre en Extrême-Orient, sont tombés en Indochine pour l'Honneur, simplement pour l'Honneur de l'Armée Française parce qu'ils ne se sont tout de même pas battus pour que le drapeau rouge du Viet Minh flotte un jour sur la citadelle du 5ème Etranger d'Infanterie...
 Au nom des 2.000 Légionnaires qui, pendant les six ans de campagne de Roger Degueldre en Algérie, ont été tués sur le sol algérien, encore pour l'Honneur de nos armes - parce qu'ils ne se sont tout de même pas battus pour que le drapeau vert et blanc du FLN flotte un jour sur le quartier Vienot de Sidi-Bel-Abbès... Au nom des 2.000 Légionnaires qui, pendant les six ans de campagne de Roger Degueldre en Algérie, ont été tués sur le sol algérien, encore pour l'Honneur de nos armes - parce qu'ils ne se sont tout de même pas battus pour que le drapeau vert et blanc du FLN flotte un jour sur le quartier Vienot de Sidi-Bel-Abbès...
Au nom de tous ces Légionnaires morts au champ d'Honneur de la France parce qu'ils ont cru comme Degueldre que, sous les couleurs françaises, on ne pouvait se renier, que derrière des officiers français on ne pouvait abandonner des tombes, que sous l'uniforme français on ne pouvait renoncer sans combat.
Au nom de tous ces étrangers qui ont donné leur cœur, leur force et leur sang à la France, parce qu'un Degueldre le leur demandait au sein d'une Légion Etrangère née avec l’Algérie Française et qui meurt avec elle.
Je vous conjure de croire, mon Général, parce que je le connais, parce que le sens, parce que je le sais, parce que toute sa vie de Légionnaire le proclame, que le Lieutenant Roger Degueldre, en se battant jusqu'au bout, n'a voulu suivre que le chemin de l'Honneur.
Colonel Hervé de Blignières,
20 Juin 1962, Prison de la Santé
Mais qui est le témoin qui va écrire au général KépiKapote : Charles DEGAULLE, nommé général de division à titre temporaire el dégradé par le gouvernement de Paul Raynaud pour ne pas avoir rejoint son poste, en France occupée, après une mission politique à Londres.
Il convient de rappeler de surcroît, que ce colonel de plume avait été nommé Secrétaire d'Etat à la guerre et qu'à ce titre il avait envisagé avec le Président du Conseil de présenter la capitulation de le France à l'Allemagne.
Le Maréchal Philippe Pétain et le Général Weygand, pressentis pour accomplir cette forfaiture imposèrent à ce gouvernement en déroute de négocier un armistice qu'ils obtinrent.
Le Colonel Hervé Le Barbier de Blignières (Hennebont, 1914 - Mordelles, 1989), ou encore Hervé de Blignières, est un officier français chef d'état-major de I'OAS en métropole.
II naît en 1914, dans une famille qui comptera 16 enfants. Hervé de Blignières est sorti de Saint-Cyr en 1937, promotion Maréchal Lyautey. Il a combattu en Belgique en 1940 à la tête de 80 cavaliers du 31ème Dragon. Fait prisonnier par les Allemands, il tenta sept fois de s'échapper durant ses cinq années de captivité.
Il a été libéré en 1945. Il a été par la suite affecté à I'Ecole militaire de cavalerie de Saumur. En 1948, il entre à la Légion étrangère.
Capitaine, envoyé en Indochine, il commande le 2ème escadron du 1er régiment étranger de cavalerie qui combat en Cochinchine, il quitte I'Indochine en novembre 1950 avec trois citations à l'ordre de I'armée.
En 1953, il sort premier de sa promotion à l'École supérieure de guerre.
Commandant en 1954, il se porte volontaire pour un nouveau séjour en Indochine ; il est chargé de former les officiers vietnamiens devant assurer la relève des officiers français.
Rentré en France en 1956, il participe à la réforme des études à l'École supérieure de Guerre.
Promu lieutenant-colonel en mars 1958, il participe aux préparatifs des événements du mois de mai en Algérie.
En août 1958, il prend le commandement du 1er régiment étranger de cavalerie chargé de la pacification du Constantinois.
En 1960-1961, il est chef d’état-major de l'OAS en France. Arrêté en septembre 1961, condamné en septembre 1963 à six ans de détention criminelle, il est libéré fin décembre 1965.
Il fut le président de l'Association pour la sauvegarde des familles et enfants disparus enlevés par le FLN en Algérie.
Il échappe en 1970 à une tentative d'enlèvement probablement commanditée par des voyous en quête du « trésor de l'OAS ». Retiré dans ses terres en Bretagne, il meurt à Mordelles (Ille et Vilaine) en 1989,
Il est notamment le père de sept enfants parmi lesquels Hugues de Blignières (dit Keraly), Olivier Le Barbier de Blignières et Arnaud de Blignières.
NB: comment ce langage de soldat et de chef de guerre aurait-il pu émouvoir le général képikapote qui n'a connu pour bataille que sa reddition à Verdun, après 15 heures de "ligne", la mascarade de Montcornet et les actions microphoniques avant d'assouvir la haine qu'il n'a cessé de nourrir à l'encontre des seigneurs de la guerre.
|
|
| DOS D’ÂNE
De Jacques Grieu
| |
Mes douleurs dans le dos me font boiter bien bas
Et rire les fâcheux qui eux, courent à bon pas.
Ils se gaussent dans mon dos ? Mes fesses les regardent !
Ils l’auront dans le dos et devront prendre garde.
Je hais tous ces lourdauds, les renvoies dos à dos,
Et leur tourne le dos, sans faire de cadeaux.
Sur mes reins fatigués s’inscrivent mes fardeaux
Le poids des jours passés, mes épreuves et mes maux.
Ils ploient sans se briser, parfois s’arquent en douleurs
Mais soutiennent tous mes pas, mes élans, mes malheurs
Dos voûté par le temps, tu portes encore mon âme
Jusqu’au jour où l’échine aura perdu sa flamme...
Si bonne soit sa vue, on ne peut voir son dos ;
C’est vrai pour les dos droits. Et les quasimodos !
Mon médecin me l’a dit, (et j’en ai froid au dos),
Que peut-être j’aurais, une « sous-libi-dos » ( ?)
Sans me le mettre à dos, j’en ris, certes un peu jaune.
Mais en serai remis avec quelques hormones…
Le « do » de « do-ré-mi » n’est autre que le « ut »,
Dont la solmisation les oreilles percutent.
Mon savoir en solfège est tout aussi restreint,
Que le nombre d’accords sur le dos de ma main.
Tout juste si je sais dans un grand concerto,
Reconnaître « piano » du rythme « allegretto ».
Mon dos est mon pilier, un pilier silencieux ;
Et sur cette colonne, je tiens comme je peux.
Portant le poids des ans, des rêves et des soucis,
Il me soutient encor, même quand je l’oublie.
Chacun de ses vertèbres est pour moi une note
Conférant à l’orchestre des airs qu’il se chuchote.
Avec mon vieux tacot, les dos d’âne sont plaies
Mais j’aime son confort, mieux qu’à dos de mulet.
Jamais son vieux moteur n’est tombé en rideau,
Même sous trombe d’eau. C’est là tout son credo !
C’est l’heure du dodo ; dormons comme un ado !
Je vais rêver, c’est sûr, de belles torpédos…
Jacques Grieu
|
|
|
ARMEE FRANÇAISE.
EXPÉDITION D’AFRIQUE.
CORRESPONDANCE
GAZETTE DE France, juin et juillet 1830, Gallica
|
Lettre adressée à S. Exe. Le ministre de la marine et des colonies,
par M. l'amiral baron Duperré.
Vaisseau de Provence, baie de Sidi-Ferruch, le 22 juin 1830.
Monseigneur,
Depuis ma lettre du 19 de ce mois, dans laquelle j'ai eu l'honneur de vous rendre compte du succès remporté par I’armée expéditionnaire sur l’ennemi, nos troupes occupent les positions dont on s'est emparé à deux petites lieues de la presqu'île, et à moitié à peu prés du chemin de Torre-Chica à Alger. Elle n'attend, pour se porter en avant, que des secours en chevaux et subsistances qui doivent lui arriver par les deux dernières divisions du convoi. Elles sont parties le 18, et sont aujourd'hui à toute vue. Mais, depuis huit jours, les vents d'ouest rognent à contre-saison, et des courants violents les empêchent d’approcher. La division du contre-amiral de Rosamel, de concert avec la division du blocus du port d'Alger, forme, à quelques lieues au large, une ligne de croiseurs qui protège les transports, les empêche de s’affaler sur la côte et facilite leur arrivage.
Je fais évacuer aujourd'hui sur l'hôpital de Mahon, par quatre corvettes de charge, les malades et blessés de l'armée, au nombre de 358. L’armée navale n’en a pas. Nos marins ont cependant un service bien pénible pour le déchargement et la mise à terre de tout le matériel de l'armée ; mais ils le remplissent avec un grand zèle. Il n'y a pas jusqu'aux équipages des bateaux de flottille, dont je n’aie également à me louer. Le retard de l'arrivée de notre dernier convoi me contrarie ; mais son déchargement sera pressé avec activité.
Le temps continue à être assez beau dans la baie, mais la houle est très-forte. Le vent au large a été très-frais de l'Ouest, et la mer très grosse. Nous ne nous en sommes pas ressentis. Fort heureusement le bateau à vapeur le Sphinx, expédié pour France, le 14, avec nos premières nouvelles, est en vue.
Agréez, etc.
Le vice-amiral, commandant en chef l’armée navale, Duperré.
*************************************
Lettre adressée à S. Exe. le ministre de la marine et des colonies,
par M. l'amiral baron Duperré.
Vaisseau de Provence, baie de Sidi-Ferruch, le 23 juin 1830.
Monseigneur,
Dans mon premier rapport du 14 de ce mois, fait à la baie, le jour même de mon débarquement, après mes premières opérations et celles de l'armée expéditionnaire, J'avais l'honneur d'informer V. Exe. que je lui transmettais les détails des mouvements de la flotte confiée à mon commandement, depuis son départ de la baie de Palma (Majorque) et que je lui ferais connaître ceux que les chances heureuses de la guerre ont mis en position de donner des preuves de dévouement, dont chaque commandant, officier, sous-officier et marin sous mes ordres était animé, dans la belle cause qu'ils avaient à soutenir.
Après être parvenu à rallier dans la baie de Palma, les bâtiments de la réserve et de deux divisions du convoi dont l'une avait été dispersée le surlendemain de mon départ de Toulon, par un coup de vent N.-O., après avoir réuni surtout la plus grande partie de la flottille, qui avait les dix premiers jours de vivres de l'armée et qui était indispensable au débarquement, j'ai réorganisé la flotte qui a rallié l'armée qui attendait sous voiles en dehors de la baie, et j'ai fait route, le 10 de ce mois, vers les côtes d'Alger.
Le 11 au soir, le vent était frais de l'Est à l’E.-S.-E. La mer était assez belle ; je m'estimais à 62 milles de terre. Je dirigeai et modérai la vitesse de la flotte de manière à ce qu'elle se trouvât le lendemain, au jour, à 12 mille de la côte. Effectivement, le 12 à la pointe du jour, on en eut connaissance à cette distance. J'avais été, un instant auparavant, rallié par le commandant de la division du blocus avec la frégate la Syrène. Le vent soufflait bon frais et la mer devenait houleuse.
Elle pouvait l'être moins sous la terre et surtout dans la baie désignée pour le débarquement. Mais la force du vent ne permettait pas de conduire à un mouillage très-resserre et à peu-près inconnu, une flotte aussi nombreuse, et d’être maître de ses moyens d'attaque. Repoussé une seconde fois, je me trouvais encore en position, en reprenant le large, de conserver la flotte et la flottille ralliée, (quoique cette dernière souffrit beaucoup) pour y revenir une troisième fois. Dans la soirée, la force du vent diminua, la mer s’embellit, la réserve, le convoi et la flottille s’étaient maintenues au vent. A neuf heures du soir, m’estimant à 40 milles de terre, la flotte revira sur elle et manœuvra pour s’en trouver, au jour, à 12 milles.
Le 13, à la pointe du jour, j'étais en vue et au vent des montagnes d'Alger. Je suis bientôt rallié par la division du blocus, à laquelle j'en avais fait le signal. Je conserve la frégate la Syrène, commandée par M. Massieu de Clerval, la frégate La Bellone, capitaine Galtois, et les bricks l'Action et la Radine, capitaines Hamelin et Guindet. Le vent était frais, mais la mer était assez belle. Le moment me parait favorable. J'ordonne à l'armée la formation de la ligne de bataille, et je continue ma route sous petites voiles pour la faciliter. La Syrène, suivit de la Bellone, en prend la tête. La réserve, le convoi et la flottille se maintiennent au vent, conformément aux Instructions que j'ai données, pour n’arriver qu'à la suite de l'armée. A 10 heures, l'armée laisse arriver et défile en ligne en vue des forts et batteries. M. le contre-amiral de Rosamel, commandant en second, avait pris son poste avec le Trident dans la ligne, et avait laissé le commandement et la conduite de la l'escadre à M. le capitaine de vaisseau Cuvillier.
Le vaisseau le Breslaw, capitaine Maillard de Liscourt, prend poste en avant de la Provence, vaisseau amiral. Je fais le signal à l’armée que je me dirige sur la baie de Sidi-Ferruch, dans l'Ouest de Torre-Chica, et que chaque capitaine doit pour l'attaque et le débarquement, se conformer aux Instructions et au plan N°1, délivré à chacun d'eux. Je charge le brick l'Alerte, capitaine Andréa de Néréiat, d'aller sonder la baie de l'Est, et les bricks le Dragon, capitaine Leblanc, et la Badine, capitaine Guindet, d'aller sonder la baie de l'Ouest. Ces trois officiers remplissent cette mission en hommes du métier, avec habileté et courage.
L'armée passe à une encablure de la pointe du petit port et se dirige sur Torre-Chica. Arrive par son travers, je suis fort étonné de n'y pas trouver les moyens de défense qui m'avaient été annoncés. J'ordonne à M. l'amiral de Rosamel, sur le Trident, et la Guerrière, capitaine de Rabaudy, que j'avais chargés de l'attaque extérieure, de suivre l'armée. Après avoir doublé les roches saillantes de la presqu’île, la Syrène et la Bellone entrent et défient sous voiles dans la baie. A onze heures et demie, le vaisseau le Breslaw prend sou poste avec habileté et exactitude rigoureuse : il s'embosse par quatre brasses et demie, à demi-portée de canon d'un fort en pierres percé de dix embrasures. Le capitaine Villaret prend poste immédiatement derrière lui avec le vaisseau la Provence qui est suivi de la Pallas, capitaine Forsans. Les frégates la Didon, capitaine Villeneuve de Bargemont, et l’Iphigénie, capitaine Christy-Palière, prennent poste embossé parallèlement à la presqu’île. A notre grand étonnement, nous trouvons le fort désarmé, et la presqu’île abandonnée sans moyen de défense. L'ennemi les avait fait porter sur les hauteurs voisines et commandant la plage, dans le double but de les défendre et de s'opposer au débarquement. Les dispositions d'attaque se trouvent alors sans effet. Je me borne à faire occuper la baie par la flotte qui, à cinq heures, y avait pris son mouillage.
L’ennemi, de ses nouvelles batteries, a tiré quelques coups de canon et lancé quelques bombes sur les vaisseaux avancés. La position élevée et sa distance rendaient la riposte aux coups de canon sans effet. Je préférai m'occuper des dispositions du débarquement. J'envoyais, néanmoins les bateaux vapeur le Nageur, capitaine Louvrier, et le Sphinx, capitaine Sarlat, pour approcher la plage d'aussi prés que possible et inquiéter l'ennemi par leur feu. Ils réussirent, car la batterie la plus rapprochée, dans laquelle était un mortier, fut évacuée. Un matelot, le nommé Jacquin (Etienne), de la 24ème compagnie permanente, 2ème division a reçu d'un éclat de bombe, une blessure grave à la jambe, qui le mettra dans l’impossibilité de continuer ses services.
La soirée était trop avancée pour opérer le débarquement ; mais, ainsi que j'ai eu I’honneur d'en rendre compte à V. Exe dans mon premier rapport, à la pointe du jour, 10000 hommes avec 8 pièces d’artillerie montées et prêtes à être mises en batterie ont été débarqués sous le feu de l'ennemi. Peu de temps après, ils ont été suivis de 10000 autres, et dans la matinée, toute l'armée a été mise à terre.
Le premier débarquement était commandé par M. le capitaine de frégate Salvy, du vaisseau amiral. Il y a fait preuve de courage et de discernement. Toutes les embarcations qui ont suivi étaient montées par un officier ou, un élève de l’armée. Je ne saurais trop louer le zèle enthousiaste de chacun d’eux. Les briks, l'Action, capitaine Hamelin, et la Badine, capitaine Guindet, ainsi que la corvette la Bayonnaise, capitaine Ferrin, prirent position dans la baie, et canonnèrent à revers avec avantage les batteries ennemies. Dans un des bateaux de la Surveillante, le nommé Guillevin François-Marie, matelot de première classe, a eu la cuisse emporté par un boulet de canon qui atteignit également M. le lieutenant de vaisseau Dupont et le nomme Duguin (Alexis), matelot de deuxième classe, qui eu furent quittes, l'un et l'autre, pour une forte contusion.
En sautant à terre les premiers, deux marins, emportés par leur courage, s’élancent ensemble dans le fort et y arborent le pavillon du Roi. Ce sont les nommés, Sous-chef de la grande hune de la frégate la Thétis, et le nomme Brunon ( François ), matelot de première classe de la Surveillante.
L'ennemi ne nous a pas mis dans le cas de multiplier cet acte de courage et de dévouement dont chacun était animé ; mais je ne dois pas laisser ignorer à V. Exe. tout ce que le Roi devait attendre des dispositions prises par tous les commandants de ses vaisseaux et des officiers et marin, sous leurs ordres.
Je ne saurais trop me louer de la coopération franche et toute dévouée de M. le contre-amiral Rosamel, commandant en second l'armée, de M. le capitaine de vaisseau Cuvillier, commandant la deuxième escadre ; de M. le baron Hugon, qui s'est distingué d'une manière toute particulière par l'ordre admirable établi dans l’organisation d’un immense convoi, qu'il a ensuite conduit avec toute l’habileté d'un officier de mer consomme ; enfin, du Capitaine de vaisseau Lemoine, chargé du commandement et de la conduite de la réserve, et de tous les capitaines de l’armée.
Je saisirai avec empressement cette occasion, dans laquelle M. le capitaine de vaisseau Massieu a déployé le zèle éclairé et le dévouement absolu qui le distinguent, pour rappeler ses honorables services et ses titres acquis aux bontés du Roi.
J’ai pu davantage apprécier dans toutes les circonstances d'organisation, d'armement et de navigation, Ies services importants et plus rapprochés rendus par tous les officiers qui étaient près de moi. Je ne puis donc m’empêcher de citer honorablement ceux de M. le contre amiral Maltet, major-général de M. de Villaret, mon capitaine de pavillon ; de M. Remquet, major de l'armée, et de MM. Roy et Fontbonne, sous-aides-majors.
M. Lemarié, lieutenant de vaisseau, premier adjudant du commandant Massieu, qui avait fait, tout récemment, un travail d’exploration et de sondes des deux baies à l'Est et à l'Ouest de Torre-Chica, se trouvait détaché près de moi. Les renseignements qu'il m'a fourni n’ont pas peu contribué à l'heureux résultat que nous avons obtenu.
J’ai retrouvé dans M. Remquet, major de l’escadre, ce zèle éclairé et ce dévouement absolu, dont, depuis vingt-trois ans et dans tous les commandements que j'ai exercés, soit dans les mers d'Europe, soit dans les mers de l’Inde et d’Amérique, il n’a cessé. prés de moi, de donner des preuves. Il dirigeait le bombardement de Cadix en 1823 ; il devait commander la flottille de débarquement dans le plan d'attaque arrêté, et que les dispositions de l'ennemi et les localités ont rendu inutile.
Les deux sous-aides-majors de l'armée, MM. Roy et Fontbonne, lieutenant de vaisseau, servent également depuis nombre d'années auprès de moi. Leur zèle, leur activité, leur dévouement ne se sont jamais ralentis. Le poste qu'ils occupent leur fournit journellement et à chaque instant l’occasion d'en donner de nouvelles preuves.
Je n'ai pas eu moins à me louer dans les détails nombreux et le service actif de la majorité générale, de MM. de Villeblanche, Henry, Pernaut, lieutenant de vaisseau, et de Sercey, enseigne de vaisseau.
Comme j’ai eu l'honneur de vous le dire, Monseigneur, dans mon rapport, chacun a fait son devoir, et il m'est impossible de relater ici tous les titres acquis à la bienveillance de S. M.
Agréez, etc.
Le vice-amiral, commandant en chef l’armée navale, Duperré.
*************************************
Lettre adressée à S. Exe. le ministre de la marine et des colonies,
par M. l'amiral Duperré.
Vaisseau de Provence, baie de Sidi-Ferruch, le 26 juin 1830.
Monseigneur,
Divers engagements ont eu lieu avec l’ennemi, dans les journées d’avant-hier et d’hier, 24 et 25. l’armée s’est portée en avant.
Je vous annonçais dans une lettre du 23, que les deux dernières divisions du convoi se trouvaient retardées par des vents d’ouest. Le vent a passé à l'est avant-hier au soir, et les deux divisions sont arrivées hier matin. La plus grande partie des chevaux restant a été mise à terre dans la journée, ainsi que divers articles du matériel du génie. Cette arrivée qui termine toutes les expéditions faites par la marine est fort heureuse ; car dés au soir à sept heures, le vent, quoique frais de la partie de l’est, a, par une révolution extraordinaire et instantanée, sauté à l’ouest. Pendant trois heures, il a soufflé avec force, et la mer, comme de coutume, est devenue très-grosse. Ce matin le temps et beau, mais le vent continu de l'ouest et ouest-nord-ouest, et la mer est très houleuse. Je craignais des avaries pour les bâtiments du convoi qui était à peine amarrés : il n’y en a pas ou du moins elles sont fort légères. Ce mauvais temps ralentira un peu le déchargement, mais ce retard ne peut porter que sur des approvisionnements et vivres qui seront qui seront débarqués avant qu’on en éprouve le besoin. Les officiers et marins de l’armée mettent dans ces pénibles travaux un zèle extraordinaire et bien louable
J'ai livré à l’armée 60,000 kilogrammes de biscuit que le général en chef m'a demandé. Nous éprouverons bientôt le besoin de vivres. L'armée expéditionnaire a séjourner un mois à bord des bâtiments. Sa consommation par le grand nombre de passagers, a été plus que doublée. J’ai demandé au préfet de Toulon de faire préparer deux mois de vivres qui seront expédiés par les divers bâtiments que je détache sur Toulon. Mais c'est surtout sur le biscuit que la consommation a porté. Il faudrait tout biscuit et point de farine. Je vous pris d'en donner l'ordre. Nous ne trouvons nul moyen de remplacer notre eau. J'en ai aussi demandé. Quelques transports pourraient nous en apporter. Je les renvoie tous à Toulon après leur déchargement.
Mes paquets sont expédiés par le brick la Capricieuse.
Agréez, etc.
Le vice-amiral, commandant en chef l’armée navale, Duperré.
*************************************
Le comte de Bourmont à S. Exc. Le président du conseil.
Au camp de Sidi-Ferruch, 22 juin 1830.
Prince,
Depuis le combat du 19 Juin, l’ennemi ne montre que quelques détachements épars. Il parait certain que la plupart des Arabes se sont éloignés, que les Turcs restent enfermés dans les murs d'Alger, et qu'une vive fermentation s'est manifestée parmi eux. Dans cet état de choses, je n'aurais pas hésité à porter l'armée en avant, si les chevaux de l’artillerie de siège et ceux de I'administration eussent été débarqués. Les bâtiments qui les transportent devaient partir le 15 de la baie de Palma.
Des vents du sud-ouest les y ont retenus jusqu'au 18. Depuis lors, le calme a été presque constant, et ils ne sont point encore en vue. J'ai pensé que l’investissement ne devait se faire que lorsque l’on aurait acquit la certitude que les travaux du siège ne seraient pas interrompus par le manque de munitions, et que les subsistances seraient assurées pour trente jours.
Malgré le retard inattendu que je viens d'indiquer, le transport de l'équipage de siège a commencé, peut-être suffira t-il de faire débarquer à Sidi-Ferruch le nombre de bouches à feu et la quantité de munitions nécessaires pour l'attaque du château de l’empereur. On a lieu de croire qu'après la prise de ce fort, et même auparavant, l'ennemi, pris à revers, serait forcé d’abandonner les batteries qui se trouvent à l’est d'Alger, et que le reste de l'équipage de siège pourrait être débarqué à peu de distance de cette place. On rendrai ainsi beaucoup plus rapide le transport du matériel de siège, depuis le point de débarquement jusqu'au camp occupé par l'armée.
Les troupes, depuis le 19 n'ont pas changé de position. Staouéli et Sidi-Khalif, dont les cartes indiquent l'emplacement, ne peuvent être comparés aux lieux habités de l’Europe, on n’y trouve point de constructions. II est vraisemblable qu'attirés par les fontaines qu’y s'y rencontrent et par la bonne qualité de leurs eaux, les Arabes y établissent fréquemment leurs tentes, et que c’est là ce qui les a fait signaler par les voyageurs et les géographes. On avait supposé d'abord, d’après I’assertion de plusieurs personnes qui ont résidé longtemps à Alger, que c’était à Staouéli que nous avions forcé le camps de l’ennemi, mais la comparaison des distances et la vue de quelques maisons qui paraissent comprises dans la zone de jardins qui entourent Alger, firent naître des doutes à cet égard. Des Arabes prisonniers furent interrogés, et il parait démontré maintenant que le nom de Sidi-Khalif est celui du terrain où l’armée a vaincu, et doit servir à désigner le combat du 19. Ainsi, la position qu'occupent maintenant les divisions Berthezène et Loverdo, divise en deux parties égales la distance de Sidi-Ferruch à Alger
A partir du camp, les broussailles cessent. On trouve mais en petit nombre, des figuiers, des mûriers et des oliviers. Le sol est presque partout couvert de palmiers nains. Il est inculte, mais nature justifie tout ce que dit l’histoire ancienne de sa fertilité. A une petite lieue de SidiKhalif, et du côté d'Alger, le pays est riant et bien cultivé. L'armée trouvera beaucoup de fruits et de légumes. J’ai reçu les rapports de MM. Les lieutenants-généraux Berthezène et Loverdo, et de M. le maréchal-de-camp Lahitte.
Les pertes faites le 19 sont plus considérables qu'on ne l'avait supposé. Le nombre des morts est de 44 dans la première division, de 15 dans la seconde. Celui des blesses est de 344 dans la première division, de 119 dans la seconde, de 10 dans l'artillerie. Tous les blessés l'ont été par la mousqueterie. Dés le commencement de l'affaire, nos batteries ont fait taire celles de I'ennemi. On doit ce résultat à l'habileté avec laquelle M le général Lahitte les a dirigé, à la bravoure des canonniers et à la justesse remarquable de leur tir. Toute l'armée leur rend ce témoignage.
Le lieutenant Delamarre qui commandait deux pièces de huit sur le front de la brigade Clouet, a fait éprouver aux Turcs une perte considérable ; Quatre coups à mitraille ont décidé leur fuite. Le général Clouet cite le lieutenant Delamarre comme ayant contribué puissamment aux succès qua obtenu la brigade.
M. le général Loverdo ne donne pas moins d’éloges au capitaine Lelièvre qui commandait sur la droite la batterie d’obusiers de montagne. Les mulets destinés au service de cette batterie n’étaient point encore arrivés ; l’ardeur des canonniers y a supplée ; ils ont porté les munitions et traîné les pièces à la bricole.
Le lieutenant Vernier, qui depuis le 15 juin était attaché à la division Berthezène, a marché constamment avec ses obusiers de 24 sur la ligne, et même en avant des tirailleurs.
M. le lieutenant-général Berthezène cite avec éloge MM. les colonels d'infanterie Feuchère, Horric et Monnier ; M. le colonel d'état-major, marquis de Brossard ; Tremoux, chef de bataillon au 37ème de ligne ; Augis, chirurgien-major ; et de la Fare, capitaine dans le même régiment ; Biré Drogue, officiers du 20ème de ligne ; Survicy, sous-lieutenant au 14ème de ligne.
Hans, soldat du 21ème léger ; Rousselin, voltigeur du 37ème, refusèrent, quoique blessés, de quitter le champ de bataille.
M. le lieutenant général Loverdo recommande à la bienveillance du gouvernement M. Jacob, colonel, chef d’état-major de la 2ème division Aupick, chef de bataillon d’état-major ; Perrot et Riban, capit. Du même corps ; MM. Ies colonels d’infanterie Magnan, Léridan et Maugin ; M. Boullé, lieutenant du 6ème régiment de ligne ; M. Blanchard, capitaine de voltigeurs dans le même régiment ; Delacroix, capitaine des voltigeurs du 49ème ; Lévêque, lieutenant des voltigeurs du 15ème de ligne ; Darricau, sous-lieutenant du 48ème ; Duchâtellier, capitaine dans le 21ème ; Laraguae, lieutenant du 29ème..
Je crois devoir signaler à V. Exc. les heureux résultats obtenus par l'administration ; les fours en tôle on été établis en vingt-quatre heures, et dés le 16 on a fait du pain.
M. l'intendant en chef avait pensé que dans un pays où l'on trouverait peu d’habitations, il fallait être en mesure d’établir des hôpitaux mobiles. Des hangars couverts de toiles imperméables mettent à l'abri les malades et les blessés. L’air y circule facilement. Tous les blessés m’ont témoigné leur satisfaction sur la propreté qui y règne, et sur les soins qu’ils reçoivent.
Les nouvelles voitures à deux roues conviennent parfaitement dans le terrain que nos convois auront à traverser. Je ne puis donner trop d’éloges au zèle des fonctionnaires de l'intendance, et à l'activité infatigable de leur chef.
J'ai l’honneur d’adresser à V. Exc., le plan de la presqu’île et des ouvrages qui la ferment. Ce travail a été exécuté sous la direction du capitaine Filhon, par les ingénieurs géographes attachés à l'armée et par quelques officiers d’état-major.
J'ai l'honneur d’être, etc…
Comte de Bourmont.
Au camp de Sidi-Khalif, 25 juin 1830.
J’ai eu l’honneur de vous rendre compte, dans ma dernière dépêche, des motifs qui m'avaient empêché de porter l'armée en avant du camp de Sidi-Khalif. Notre immobilité releva les espérances de l’ennemi. Le 24, à la pointe du jour, Ies Turcs et les Arabes se présentèrent en embrassant un front très étendu et avec non moins d’ordre encore que le 19. Toutes les dispositions étaient prises pour que la première attaque leur fit perdre deux lieues de terrain ; elles furent exécutés avec une grande précision. La division Berthezène et la première brigade de la division Loverdo marchèrent avec une batterie d’artillerie de campagne.
Aussitôt que nos bataillons d'infanterie disposés en colonnes eurent passé dans la plaine qui s’étend en avant du camp, l'ennemi prit la fuite sur tous les points. Les troupes françaises traversèrent cette plaine avec une grande rapidité. A 6 mille mètres du camp le pays change d'aspect, les mouvements de terrain deviennent plus prononcés et on se trouve sur le groupe de hauteur qu’occupent Alger et les jardins ; on y voit de nombreuses habitations. Les vignes, Ies haies et ses arbres fruitiers dont le sol est couvert, rappellent les contrées les plus fertiles et les mieux cultivées de l’Europe.
On devait supposer que les Turcs se défendraient encore avec vigueur derrière les nombreux obstacles que leur offrait le terrain ; mais battus et découragés, ils ne s’arrêtèrent nulle part. Je cru devoir en profiter pour traverser rapidement ce pays de chicane, et bientôt les troupes françaises atteignirent la limite qui le sépare d'un espace découvert. Elles prirent position. Un ravin les séparait de l’ennemi, qui s’était enfin arrêté sur la crête des hauteurs situées du côté opposé à celui que nous occupions. L'artillerie avait surmonté avec la rapidité ordinaire toutes les difficultés du terrain ; elle se mit en batterie, et quelque obus lancés avec une grande justesse, dispersèrent les groupes qui se présentaient encore.
Peut-être les Turcs craignirent-ils alors d'être refoulés dans la place, dont nous n’étions plus séparés que par un intervalle de 4 ou 6 mille mètres. Un magasin à poudre avait été établi sur la pente des hauteurs dont ils occupaient la crète. Ils le firent sauter, la détonation fut violente. Des nuages d'une fumée épaisse qui s’élevaient à plus de cent mètres, et qui réfléchissaient les rayons du soleil, présentèrent à l'armée un magnifique spectacle. Gudin se trouvait là ; il saisit ses crayons et ses calques. Cette explosion ne produisit aucun accident
Deux escadrons de chasseurs avaient suivi le mouvement de l'infanterie ; Mais la fuite précipitée de l'ennemi et la nature du terrain ne leur permirent pas de charger.
L'ennemie n’avait point de canon. Peut-être avait-il reconnu qu'en amener c’était nous les livrer.
Le nombre des hommes mis hors de combat a été peu considérable. Un seul officier a été blessé dangereusement, c'est le second des quatre fils qui m’ont suivi en Afrique. J’ai, l'espoir qu'il vivra pour continuer de servir avec dévouement le Roi et la patrie.
On a pris, le jour du combat, plus de 4000 bœufs ; ainsi, les approvisionnements, en viande, sont assurés pour 8 ou 10 jours.
Pendant que l'armée combattait, les vents d’ouest, qui retenaient au large le convoi parti le 18 de la baie de Palma, avait cessé de souffler.
Une brise d'est le poussait vers le mouillage, qu'il atteignait pendant la nuit dernière. Aujourd'hui, le débarquement a commencé. Il s’exécute sans obstacle. Depuis le 14, la communication libre entre l'armée de terre et l'armée de mer ; elle n'a pas même été interrompue le jour du violent orage dont j'ai rendue compte à V.Exc.
Aujourd’hui le tiraillement a continué. Les Turcs se sont présentés en grand nombre ; Ies Arabes étaient beaucoup plus disséminés que les jours précédents. Leur objet parait être maintenant moins de combattre que d'attaquer des hommes isolés et de piller des équipages.
Les dispositions sont prises pour attaquer l'ennemi demain à la pointe du jour.
J’ai l’honneur d'être, etc… Le comte de Bourmont.
===================
Alger, 10 juillet 1830.
CORRESPONDANCE.
Envoyé par M. J.L. Ventura
«Dans les premiers jours de la campagne, la 5ème division d’Escars dont je faisais partie, fut désignée pour former la réserve ; n’ayant par conséquent aucun détail intéressant à vous donner sur nos succès, j’avais cessé toute correspondance. Ces travaux de tranchée qui nous occupaient pour former le camp de Sidi-el-Ferruch, ce débarquement auquel nous aidions pendant que le reste de l’armée était devant l’ennemi ; plus tard cette inaction à laquelle nous avons été condamnés, tout nous faisait craindre que la division d’Escars ne pût avoir part aux dangers et à la gloire du reste de l’armée. Mais après l’affaire du 24 aux avant-postes de Staouéli, comme les régiments d’avant-garde commençaient à être fatigués, et que l’on voulait rafraîchir les troupes qui depuis 15 jours étaient sans cesse sur pieds, une partie de la 5ème division reçut l’ordre d’aller relever les avant-postes et de s’y maintenir sans avancer.
Là, nous devions attendre l’arrivée de l’artillerie de siège, sans laquelle nous ne pouvions nous aventurer près des forts et de la ville.
Pendant trois jours nous conservâmes nos positions, en soutenant continuellement un feu de tirailleurs qui nous incommodait beaucoup. Les Maures ont des fusils très longs qui portent loin, et en général ils ajustent à merveille ; aussi perdîmes-nous du monde, et pendant ce peu de temps nous eûmes plus de 600 hommes hors de combat, dont plusieurs officiers. Quatre n’ont pu survivre à leurs blessures. Nos soldats, dont la plus grande partie n’avait pas vu le feu, montrèrent un courage et un sang-froid admirable. Sitôt qu’une compagnie avait souffert, et qu’elle manquait de cartouches, elle était remplacée par une mire dans un ordre parlait et cela sous le feu des tirailleurs ennemis et de plusieurs pièces d’artillerie. Enfin le 28 au soir l’artillerie de siège qui était débarquée la veille à Sidi-Ferruch, arriva au camp, et le lendemain 29 la division d’Escars, soutenue sur la droite par une partie de la division Loverdo, se porta en avant.
On enleva la position à la baïonnette, les Maures qui résistèrent furent tués et précipités dans les ravins, les autres prirent la fuite et se retirèrent sur le bord de la mer.
Nous continuâmes notre route, en traversant des ravins profonds, en gravissant des montagnes escarpées, où nous eûmes à souffrir tout ce qu’on peut imaginer de la chaleur et de la fatigue dans des chemins affreux, où les hommes et les chevaux risquaient à chaque instant de périr ; enfin après plus de quatre heures de la marche la plus pénible, nous nous trouvâmes sur les hauteurs qui dominent la ville, et nous aperçûmes Alger. Les rapports officiels vous ont déjà appris le reste.
Rien de plus singulier que le spectacle de cette population composée de Maures, d’Arabes, de Turcs, de Juifs, examinant ses vainqueurs avec cette impassibilité mahométane qui se résigne à tout, parce que telle est la volonté du prophète. L’armée traversa la ville avec tranquillité, les boutiques étaient fermées, mais les habitants étaient tous hors de leurs maisons.
Rien n’est changé dans la police de la ville ; le blé qui se vendait au marché au compte du dey a été vendu avant-hier au compte du gouvernement français. Les juifs continuent à payer leur capitation. Un interprète est nommé lieutenant de police, des patrouilles parcourent la ville, pour maintenir le bon ordre ; les boutiques et les cafés ouverts comme de coutume se remplissent de soldats et d’officiers français. L’établissement de la marine, un des plus beaux que l’on puisse voir, renferme plus de cent pièces de canons de siège, presque toutes espagnoles, des munitions en abondance, et tout cela rangé et préparé avec un ordre admirable que l’on ne pouvait attendre des Turcs. Ces derniers sont désarmés peu à peu, et bientôt on les renverra dans leur patrie. Les Arabes, qui rôdaient encore sur le bord de la mer, pour venir de là inquiéter nos parcs de vivres et nos transports, ont été repoussé» jusqu’au-delà du cap Matifou. Enfin, des sommations ont été envoyées aux beys de Constantine, de Bugie, de Titterie et d’Oran, pour les obliger à reconnaître la suzeraineté du roi de France.
Hier, un envoyé du dey de Tunis est venu complimenter le général en chef. On l’a fait promener dans tous les endroits de la ville qu’occupaient nos troupes ; il ne pouvait revenir du petit nombre de nos soldats ; car, dans son pays, des populations entières sont sous les armes, et quelques régiments lui semblaient bien peu de chose pour une pareille conquête.
Il y a quelques jours que le consul de Danemark se présenta à la Cassaba, (casbah) à l’audience du dey, pour lui offrir les tributs d’usage ; Hussein-Dey refusa de les recevoir, et lui dit avec son assurance habituelle : «Garde, garde consul, je n’ai pas le temps de régler celle affaire là dans ce moment, nous en parlerons quand je me serai de ces chiens de français. » Il paraît, d’après cela, que nous gagnons en considération auprès du dey, car il y a quelque temps qu’il nous appelait des poules, et qu’il disait en riant dans sa barbe : « Lasciate, lasciate venire das gallinas franceses. »
Traduction du supplément du Journal
de Majorque du vendredi
9 juillet 1830.
PRISE D’ALGER ET DE SON DEY.
Alger et son dey sont au pouvoir des Français!!! Honneur et gloire aux armes de Charles X, chef des Bourbons, souverain que respectent et chérissent à tant de litres, les antres souverains du monde, monarque que ses peuples aiment à l’égal d’un père ! Charles X, à qui la France doit aujourd’hui ses prospérités ! Honneur à ses armes ! Alger et son dey sont au pouvoir des Français.
Ce qu’aucune nation n’a pu faire, la France vient de l’achever ! Honneur à vous, généraux habiles, soldats intrépides, braves marins, la France et l’Europe se rappelleront éternellement vos glorieux travaux
Plus d’esclavage! Nations européennes, le France vous affranchit de ces honteux tributs qu’un odieux pirate imposait à votre faiblesse. Plus d’esclavage ! le commerce, libre dorénavant de toutes entraves, verra renaître une prospérité que ses sacrifices lui ont tant méritée ; honneur à vous, la postérité vous a décerné une nouvelle couronne, la reconnaissance des peuples contemporains !
Le 4 de ce mois, la ville d’Alger, battue depuis quarante-huit heures par le feu des vaisseaux commandes par l’amiral Duperré, pendant que les batteries du fort de l’Empereur ( occupées par les Français qui s’en étaient emparés la veille ), détruisaient par des milliers de boulets le palais du dey et les maisons de la ville, une députation des principaux de la population se présenta au général de Bourmont, en lui demandant à capituler, ce qui lui fut refusé, ce général, ne voulant pas consentir à traiter avec d’autres qu’avec le dey en personne ; ce à quoi la députation répondit qu’on l’enverrait aussitôt au général français, ou qu’on lui apporterait sa tête, une suspension d’armes avait été accordée jusqu’au 5, le feu cessa de part et d’autre jusqu’à la fin du jour, 4.
Mais, le 5 même, le dey s’étant présente en personne, et remis à la discrétion du général, on signa une capitulation en vertu de laquelle le dey resta prisonnier, et 6,000 hommes de troupes françaises entrèrent dans la ville de midi à deux heures. Le général Bourmont établit son quartier-général dans le palais même du dey, pendant que celui-ci était conduit à une maison particulière, où il est gardé par une nombreuse escorte
Tel est le résultat de cette grande entreprise, dirigée avec tant d'habileté, et amenée à une si heureuse fin en l’espace de vingt-deux jours.
Vive le Roi !
Par ordre supérieur :
Mahon, imprimerie du journal, etc.
E. de Genoude.
Propriétaire unique de l'Etoile Gazette de France.
|
|
GEORGES ROUET
Pieds-Noirs d'Hier et d'Aujourd’hui N°212 - Juillet/Août 2013
|
|
LE THEO ALGEROIS LE TALENT A L’ETAT PUR
Le Pieds-Noirs naissait avec la bosse, du sport comme d'autres avec la bosse, des mathématiques. Il hésitait longtemps entre les différentes disciplines qui s'offraient à lui.
À la rue, il pratiquait naturellement la course à pied et le football puis, l'été venu, en profitant des plaisirs de la plage, il imitait sans le savoir les Nakache, Boiteux et consorts.
Plus tard, il optait pour le sport qui correspondait le mieux à ses aptitudes ou bien pour celui qui attirait le plus grand nombre de ses amis.
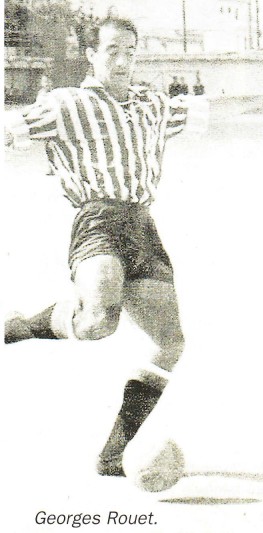 Georges Rouet se dirigea dès l'adolescence vers la natation. Georges Rouet se dirigea dès l'adolescence vers la natation.
Bien sûr, il continua à s'amuser avec ses copains dans des matches de football inter-quartier mais, pour lui, le doute n'existait pas. Il était et resterait nageur. Il faut dire que Georges évoluait dans l'élément liquide comme... un poisson dans l'eau.
Une nonchalance naturelle lui permettait même de nager sans se préoccuper d'une technique encombrante lorsque se profilait la ligne d'arrivée. Privilégié par la présence de la Méditerranée toute proche, Georges, qui est né à Alger le 19 mars 1931, signa à la M.S.J.A. (Marine Sportive Jeunesse Algéroise).
L'entraîneur Antoine Bossa décela, dès les premières brasses de ce grand garçon, la graine d'un futur champion. Durant sept ans, Georges Rouet cumula un nombre incalculable de titres et de trophées. La liste serait trop longue à énumérer mais il détient 11 titres de champion d'Alger, 3 titres de champion d'Afrique du Nord (dont celui du 100m dos toutes catégories en 1947, alors qu'il était cadet) et un titre de vice-champion de France du 100m dos disputé aux Tourelles à Paris. Bien sûr, pendant ce temps, Georges Rouet continue à taquiner la balle et lorsqu'en 1957, il signe à I'Association Sportive Saint-Eugène, il a... vingt ans.
Terminer une carrière de nageur de haut niveau à vingt ans est un acte courant, mais débuter une carrière de footballeur de haut niveau relève, à cet âge, de I'exploit.
Car prétendre gagner une place de titulaire dans un club aussi huppé que l'ASSE est une gageure lorsque l'on est un néophyte en matière de football.
Pourtant Georges Rouet est entré au club par la petite porte mais un talent à I'état pur comme le sien n'échappe pas à un oeil exercé.
Evariste Garcia, I'entraîneur de I'ASSE a deux yeux. Et Georges le séduit comme il séduit le staff technique. Tant et si bien qu'il se retrouve sur le tuf du stade municipal de Saint-Eugène avec sur le dos la tunique «rouge et blanc, au milieu des Boubekeur, Oliver, Beringuer, Aboulker, Valenza, Berah, Alarcon, Brouel, Boret, Rivas.
La décontraction naturelle de Rouet, la classe de Boubekeur, l'efficacité de Beringuer, le souffle de Valenza et le punch d'Alarcon et de Boret donnent le titre de champion d'Alger à l'ASSE 1951-52. Et voilà, Rouet nanti d'un titre envié de footballeur pour sa première année dans cette activité sportive.
À ce propos, il me revient en mémoire, l'interdiction faite aux footballeurs de pratiquer la natation car elle contrariait Ies muscles utilisés par les amateurs de ballon rond. Fausse affirmation ou bien Georges Rouet était l'exception qui confirme la règle ?
Toujours est-il que la seconde carrière de I'apprenti - football leur commençai sous les meilleurs auspices.
Avec, en prime, le titre de Vice-Champion d'Afrique du Nord, battu en finale du Challenge Louis Rivet par I'US. Maroc et un titre de champion d'AFN militaire avec le 27ème Escadron du Train.
Après quatre ans passés à I'ASSE où il fait admirer sa formidable technique de pur gaucher mais où, également, certains lui reprochent sa relative lenteur, il signe une licence B à l'ASPTT en compagnie de ses amis Marcel Alarcon et Roland Rivas.
Lenteur relative car à I'instar d'un autre gaucher au gabarit impressionnant, le monégasque Theo, Georges Rouet était un faux lent.
En effet, pour juger de la lenteur d'un joueur, il faut regarder avant tout le ballon et la vitesse avec laquelle le joueur présumé lent transmet le cuir. Car porter le ballon à toute vitesse ralentira toujours plus I'action de jeu qu'une passe instantanée de vingt, trente voire quarante mètres. Michel Platini l'a démontré de la plus incontestable des façons. Georges Rouet était un joueur qui voyait loin, juste et vite le partenaire démarqué et, plutôt que de lui porter le ballon dans les pieds, le lui transmettait par une longue passe.
De retour à l'ASSE, le numéro dix des rouges et blancs va participer activement à la bonne tenue de son équipe jusqu'à l'époque où le football français étend le championnat de France amateur à l'Algérie.
Après une première année mi-figue mi-raisin remportée par le SCBA, Georges et ses coéquipiers Bouchet, Betis, Madelon, Chelpi, Xuereb, Serrano, Guitoun, Perez, Meziani, Pappalardo Vincent, Buades, Sar, Faye, Pappalardo Sauveur enlèvent la deuxième édition du CFA (1960-61-). La 3ème édition sera interrompue pour cause... d'indépendance et Georges Rouet cadre au Crédit Agricole Mutuel d'Alger sera muté à Draguignan.
Il évoluera au Sporting Club de Draguignan jusqu'à l'âge de... quarante ans!
Georges Rouet, le talent à l'état pur a perdu quelques cheveux mais pour tous ceux qui I'ont vu évoluer sur le terrain des retrouvailles des anciens de Bab-El-Oued à AIx-en-Provence, le Saint Eugénols a gardé son magique pied gauche.
H.Z.
La Mémoire du Football
D'Afrique du Nord
|
|
PHOTOS DE BÔNE
Envois divers
|
|
| VERS A SOI, SOI-DISANT
De Jacques Grieu
|
Il n’est meilleur ami que son petit soi-même ;
Charité ordonnée, commence quand on s’aime.
Qui ne vit que pour soi est bien mauvais apôtre,
Mais se trompe soi-même avant de tromper l’autre.
« Honni soit qui y pense » est devise incomplète,
Et peut tout signifier pour un bon exégète ;
Dévôts ou pudibonds à part soi, se le disent,
Rêvant de jarretières ou d’autres paillardises …
C’est à l'ombre de soi, en voyage intérieur
Que des traits de génie parfois éclosent en fleur.
Savoir creuser en soi, en extraire le meilleur
Et se mettre en émoi est un art salvateur.
Qu’on soit blanc, qu’on soit noir, il faut qu’on soit un homme ;
Tout cela va de soi. Et jaune, c’est tout comme.
Que l’ombre soit tordue, peu chaut si l’homme est droit,
Qu’il soit pauvre quidam ou soit un très grand roi.
La « route de la soie », vieux chemin de la Chine,
Est porte d’épopée aux voies très clandestines.
Soie fermée, soie ouverte est sort de toute porte !
Soi-disant pure soie, sa légende transporte.
Pouvoir parler de soi est le plaisir suprême.
Il y faut l’empathie : surtout envers soi-même.
Dans la science de soi, tous nos savoirs s’émoussent.
On vit chacun pour soi, pourtant ! Et Dieu pour tous !
Se trop copier soi-même est des plus dangereux,
Et revenir à soi est un jeu pernicieux.
Mourir est l’occasion de parler de soi-même.
Et l’infatué de soi y voit plaisir suprême.
Dans les cas difficiles, il faut « pendre sur soi ».
Soit ! Mais prendre … prendre quoi ? Est-ce question de... poids ?
On ne croit pas le vrai mais ce qu’on veut qu’il soit :
La nature a voulu que ce soit notre loi.
Jacques Grieu
|
| |
DE LA CRÉATION D'ÉCOLES
Gallica : Revue d’orient, 1854-2 ; Pages de 462-465
|
AGRICOLES ET INDUSTRIELLES
POUR LES ARABES
Le gouvernement comprenant sa mission civilisatrice vis-à-vis des Arabes, a fait tous ses efforts pour étendre l'enseignement en Algérie ; ainsi, le décret du 30 novembre 1850, considérant l'instruction publique des indigènes comme un des auxiliaires les plus puissants pour les amener à nous, a institué une école supérieure musulmane dans chacune des trois provinces.
Cette utile institution, appelée à relever la position intellectuelle des Arabes, ne s'adresse malheureusement qu'à un petit nombre d'individus qui, quoique recevant une instruction supérieure, n'en restent pas moins fanatiques ; elle nous fournira, il est vrai, des magistrats, des muphtis, des cadis, des adouls plus instruits que ceux que nous employons aujourd'hui, mais ce ne sont que des savants, c'est-à-dire une classe très-peu nombreuse de la société arabe.
Ce qu'il faudrait, à notre avis, ce serait une institution qui, tout en combattant le fanatisme et en détruisant l'ignorance chez les Arabes, les amenât â bénéficier immédiatement de notre civilisation, les initier de suite à nos mœurs et leur fit adopter nos besoins.
Cette tâche qui, au premier abord, parait ne devoir être que l'œuvre du temps, nous semble plus facile que l'on ne croit.
Nous allons essayer de développer notre pensée. Nous serons assez récompensé si elle peut servir de jalon à une idée meilleure
Pour faire tourner au profit de la domination française l'instruction publique musulmane et l'étendre à un grand nombre d'individus, il faudrait créer, dans chacune des trois provinces, une vaste école agricole dans laquelle les jeunes indigènes apprendraient et les cultures nouvelles, et à perfectionner celles déjà connues parmi eux ; il serait annexé au même établissement une école de métiers où l'on enseignerait aux indigènes la confection des objets les plus usuels.
Voici d'après quelles bases nous comprenons la réalisation de ce projet
Nous supposons que les bâtiments nécessaires â l'institution soient édifiés dans l'un des grands domaines appartenant à l'État, à proximité d'une des villes du centre, telles que Constantine, Médéah, Tlemcen, il faudrait que les terres affectées à cet établissement ne soient pas d'une étendue moindre de 2,000 à 3,000 hectares.
Cette école serait sous la direction d'un Français qui pourrait être en même temps professeur ; il aurait sous ses ordres tous les professeurs et maîtres ouvriers français et arabes.
L'instruction serait divisée en deux parties : instruction agricole, instruction industrielle.
L'instruction agricole comprendrait : l'agriculture proprement dite, l'élève des bestiaux et des chevaux, l'étude de l'industrie séricole.
L'instruction industrielle embrasserait les états manuels suivants
Charpenterie, menuiserie, ébénisterie, forge et charronnage, serrurerie, sellerie et broderie, tissage, etc.
Le personnel serait composé de la manière suivante
Européens. — Un directeur, un maître ouvrier charpentier, un maître ouvrier ébéniste et tourneur, un maître ouvrier forgeron et charron, un mitre ouvrier serrurier, un maître ouvrier tisserand, deux bouviers, deux jardiniers en chef.
INDIGENES. -- Un thaleb ou professeur, un menuisier, un sellier brodeur, un portier, huit hommes de peine.
Le thaleb serait chargé de l'instruction religieuse. On devra choisir, autant que possible, un homme dont la réputation de sainteté soit assez répandue dans le pays pour que sa présence seule attire les indigènes.
Le recrutement des élèves se ferait d'après un mode que le gouvernement choisirait et qui serait conforme à l'état politique du pays. Les élèves y seraient reçus à l'âge de quatorze ans ; la durée des études serait de quatre années ; le renouvellement des élèves se ferait donc par quart. Chaque tribu devra fournir, par élève, 60 fr. à titre de première mise, plus une somme mensuelle de 21 fr. 50 c. pour l'entretien et la nourriture de l'élève ; soit pour les quatre années. 1032 F
La première mise de 60 F
La dépense totale est de 1092 F par élève pour les quatre années.
Cette contribution diminuerait annuellement en proportion des produits de la ferme, et il arriverait une époque où l’école ne serait plus à charge aux tribus ; les professeurs et maîtres ouvriers seraient payés sur les produits de l'établissement.
Supposons que la propriété ait une étendue de 2000 hectares dont la moitié seulement serait cultivée chaque année jusqu'à ce que le nombre des bestiaux et des bêtes de somme fût assez considérable pour fumer les terres et ne plus en laisser en jachères ; évaluons le produit net d'un hectare ; tous frais prélevés, à la somme minime de 40 F pour les premières années ; nous aurons comme produit des 7,000 hectares la somme de 40,000 F, qui sera plus que suffisante pour payer les professeurs et les maîtres ouvriers et pour faire face aux dépenses qu'exigeront les réparations à faire dans l'année â l'établissement et au matériel. Une direction intelligente ne tardera pas à augmenter les produits en améliorant la propriété. Les indigènes n'auront nulle répugnance à conduire leurs enfants dans un établissement créé en pays arabe, et dont le personnel sera en partie composé de musulmans.
Tout en conservant leurs coutumes religieuses, leur nourriture et tous les usages consacrés dans la religion musulmane, les élèves auront des dortoirs installés à l'instar des nôtres ; leur nourriture, apprêtée par un cuisinier arabe, leur sera servie dans un réfectoire où les élèves mangeront assis à la manière des Européens et contracteront des habitudes de propreté qu'ils conserveront.
Tous ces détails et une foule d'autres que nous négligeons pourront paraître puéril; quoi qu'il en soit, notre conviction est que des indigènes élevés pendant une période de quatre années dans les conditions que nous venons d'indiquer sommairement ne sauraient retourner à leur point de départ et formeraient cette génération de transition qui doit rapprocher de nous les Arabes. Rentrant dans leurs tribus, ils propageraient ce qu'ils auraient appris à notre école, et finiraient à la longue à changer en partie les mœurs de la famille indigène par les innovations que les besoins que nous leur aurons créés les forceraient à y introduire.
La plus grande difficulté à vaincre pour l’adoption d'un projet est sans contredit la réalisation des capitaux nécessaires à son exécution ; c'est la pierre angulaire contre laquelle viennent se briser les cerveaux créateurs ; c'est le plus grand obstacle à vaincre. L'institution dont nous proposons l’édification est tout arabe, tout â l'avantage des indigènes ; par elle, ils se moraliseront, c'est l'échelle qui doit graduellement les élever jusqu'à nous. L'institution étant tout au profit des populations indigènes, il n'y a nul inconvénient à leur en faire subir les dépenses, dépenses insignifiantes lorsque la répartition en sera faite entre ; toutes les tribus d'une division.
Médéah.
FLORIAT PHARAON,
Interprète militaire.
|
|
MINISTRE de l’ALGERIE 1987
(Envoyé par M. C. Fretat) pages 134 à 149
|
LA "RÉPRESSION" COLONIALISTE
CRITIQUE
La lutte du peuple algérien a été marquée, dans la période récente, par une répression sanglante et continuelle. En 1945, 45 000 Algériens furent tués par les troupes françaises dans la région de Constantine. En 1946, M. Pinkney Tuck., ambassadeur des Etats-Unis au Caire, déclara à Azzam Pasha, secrétaire général de la ligue arabe, que les rapports du State Department évaluaient les victimes à un chiffre bien supérieur à 40000.
RÉPONSE
Extraits du rapport de la commission chargée d'une enquête administrative sur les événements du 8 mai 1945 dans la région de Sétif et de Constantine.
Ce dont le F.L.N. ne parle pas.
Rappel succinct des faits motivant l'enquête. « A Sétif, le 8 mai, alors que la population s'apprêtait à fêter la fin des hostilités, de sanglants incidents se déroulaient : 29 Européens étaient massacrés. Des émeutes éclataient par la suite dans le département de Constantine, prenant le caractère d'un véritable soulèvement.
« Au total, 103 Européens ont été assassinés, plusieurs femmes, dont une de 81 ans, ont été violées. Les cadavres, dans la plupart des cas, ont été affreusement mutilés, les parties sexuelles coupées et placées dans la bouche, les seins des femmes arrachés et les émeutiers s'acharnaient sur Ies cadavres pour les larder de coups de couteaux. »
La « répression ».
« Les troupes, pendant l'action contre les émeutiers, ont pu tuer 500 à 600 indigènes.
A Sétif, il est impossible de connaître le chiffre des Musulmans tombés du fait de la police ou de la gendarmerie, certains disent 20, d'autres 40.
« La commission peut faire part d'une motion généralisée dans les milieux musulmans, qui prétendent que les Européens de Guelma ont exercé des représailles sanglantes et des vengeances personnelles en arrêtant et exécutant sans discernement, alors que les combats avaient cessé, 500 ou 700 jeunes gens. »
Donc, d'après les estimations de l'époque, c'est au minimum 1020 et au maximum 1310 Musulmans qui auraient été tués à cette occasion.
Il paraît opportun de rappeler que cette commission d'enquête était composée d'un président fort connu pour ses idées progressistes, et de deux membres dont un musulman honorable et un avocat général à la Cour d'Appel d'Alger.
CRITIQUE
Des Algériens furent abattus à Deschmya, en 1948, et en France même, lors des manifestations algériennes 1952-53 (6 travailleurs furent abattus à Paris le 1er mai 1953).
RÉPONSE
Le F.L.N. oublie de donner la version complète de ce qui s'est passé à Deschmya en 1948. Voici un extrait d'un article paru dans « Le Parisien Libéré » du 6 avril 1948.
« 1 500 manifestants rassemblés sous le signe du M.T.L.D. sont venus faire le siège du bureau de vote de Deschmya, un petit douar situé à 15 km d'Aumale. Devant ce coup de force, les autorités locales firent appel à des gardes mobiles, dont la voiture fut attaquée et lapidée sur la route.
« Les gardes tentèrent d'effrayer seulement les manifestants fanatisés par des meneurs. Mais, trois gardes ayant été blessés, les autres firent alors usage de leurs armes. Une rafale dispersa les manifestants qui abandonnèrent sept morts et quelques blessés. Les gardes purent alors remplir leur mission : faire évacuer les bureaux de vote et rétablir l'ordre. »
Evénements du 1er mai 1953
A Paris, des milliers de manifestants algériens ont pu défiler, et il n'y a pas eu un incident. Voici le compte rendu qu'en faisait, le 2 mai 1953, « Alger Républicain », journal d'obédience communiste :
« Défilé du 1er mai sous la pluie à Paris. Mais quel défilé ! Pendant cinq heures d'horloge, une foule dense, joyeuse, enthousiaste, la foule unique du Paris des travailleurs, a traversé son vieux faubourg Saint-Antoine sur le trajet traditionnel de la Place de la Bastille à la Place de la Nation.
« Mais brusquement, un événement assez extraordinaire se produisait qui fit dresser l'oreille à la foule massée sur la Place de la Bastille. Un brouhaha intense, scandé par des milliers de poitrines, venait du faubourg Saint-Antoine et s'amplifiait de seconde en seconde. Les applaudissements crépitèrent lorsque la foule comprit de quoi il s'agissait en voyant apparaître le premier groupe de travailleurs algériens portant une grande photographie de M. Messali Hadj. Défilant par rang de vingt-cinq ou trente, serrés en une masse compacte, les Algériens ont fait une impression ineffaçable. Leur cortège n'en finissait plus. Devant la tribune où les dirigeants des organisations françaises s'étaient levés et rendaient leur salut à leurs camarades algériens, les cris : « Libérez Messali et tous les détenus politiques ! » se répercutaient au loin et faisaient tressaillir ce vieux quartier parisien témoin de tant de combats pour la liberté.
« Combien étaient-ils au juste ? Il serait difficile de le dire exactement. Mais il y en avait certainement plus de 30 000. Leurs mots d’ordre témoignaient d'une haute conscience politique. Sur une banderole, on lisait : « Peuple de France, en défendant nos libertés, tu défends les tiennes.» Et sur d'autres : « Libération des détenus politiques français. »
« A bas les racistes semeurs de haine. » Ainsi, ces ardents patriotes algériens ont montré par leur présence et leurs mots d’ordre qu’ils ne confondaient pas le peuple français avec ses dirigeants. Et les parisiens leur ont bien rendu ce geste bouleversant en leur réservant sur les trottoirs, aux fenêtres et aux balcons un accueil inoubliable. Tout le long du parcours, des cris fusaient : « vivent les Algériens ! » Et l’on s’écrasait pour les voir passer et les applaudir..
Les seuls incidents ont eu lieu à Valenciennes et Anzin ; en voici le récit par la « Dépêche Quotidienne » du 2 mai 1953 :
« Dans l'ensemble, le calme a régné, à l'exception d'Anzin et de Valenciennes.
« Le premier choc s'est produit au départ du cortège sur la place d'Anzin même. Des manifestants nord-africains, au nombre de 350, avaient arboré, à l'appel du M.T.L.D., le drapeau de l'Algérie libre et déployé leurs banderoles lorsque les C.R.S. reçurent l'ordre de s'en emparer. Une très vive échauffourée, qui dura dix minutes, se produisit. Quelques minutes plus tard, une seconde bagarre éclatait, au pont Jacob, le service d'ordre ayant tenté à nouveau de s'emparer d'un drapeau.
« Cinquante arrestations ont été opérées. Les bagarres, bien que courtes, ont été violentes.
« II a été fait usage de matraques et de gaz lacrymogène, du côté du service d'ordre, et de briques et gourdins, par les manifestants.
Dispersés à deux reprises, ceux-ci ont ensuite pu se regrouper après le meeting, la dislocation a eu lieu, et en fin de matinée le calme était totalement revenu à Anzin et Valenciennes. On signale trente blessés chez les manifestants et une vingtaine parmi les C.R.S. et la police. »
CRITIQUE
Les mesures répressives contre la résistance algérienne ont pris des aspects alarmants, la responsabilité collective étant appliquée systématiquement à la population algérienne civile.
RÉPONSE
Melouza, ce village d'Algérie hier encore inconnu et où tous les hommes à partir de quinze ans, soit 302 personnes, furent exécutés et mutilés par le F.L.N., parce qu'ils recherchaient la protection française, a révélé au monde que la « résistance algérienne », elle, appliquait systématiquement le principe de la responsabilité collective.
Ce massacre a montré, avec quelle cruelle évidence, que la rébellion algérienne n'est en fait qu'un mouvement totalitaire en particulier dans ses moyens, puisque le F.L.N. ne recule pas devant les méthodes les plus inhumaines, à savoir l'extermination massive de ceux qui contre-viennent à ses desseins.
Le nom de Melouza prend rang aujourd'hui, sur la liste des crimes collectifs, parmi ces autres noms comme Oradour, Lidice ou Budapest, qui sont devenus symboles des actes les plus inhumains et les plus honteux. L'indignation de l'opinion mondiale a été unanime ; le but et les méthodes du F.L.N. ont fait l'objet d'une condamnation formelle.
Or, Melouza constitue seulement un «cas limite», par son ampleur, et les méthodes qui y ont été utilisées par le F.L.N., sont employées systématiquement par les rebelles depuis 1954.
CRITIQUE
La France mène une politique d'oppression. La liberté d'expression n'existe pas. La presse nationaliste est fréquemment l'objet de saisies et les éditeurs sont souvent condamnés à des peines de prison ou à des amendes exorbitantes.
RÉPONSE
L'article 57 du statut de 1917 est ainsi conçu :
« La langue arabe constituant une des langues de l'Union française, les mêmes dispositions s'appliquent à la langue française et à la langue arabe en ce qui concerne le régime de la presse et des publications officielles ou privées en Algérie. »
La liberté de la presse s'applique donc en Algérie en période normale aux revues et périodiques rédigés dans les deux langues et l'opinion musulmane a pu librement s'exprimer tant qu'elle n'a pas pris un ton excessif et qu'elle n'a pas sel ci à lancer de véritables appels au meurtre et à l'insurrection.
LES " RÉFUGÉS " ALGÉRIENS EN TUNISIE
CRITIQUE
« 200.000 réfugiés algériens ont cherché asile sur le territoire de la Régence, afin de fuir les « atrocités » de la « répression colonialiste ».
REPONSE
Décompte des prétendus 200.000 réfugiés algériens.
La propagande du F.L.N., conjointement à celle de la Tunisie (qui reste cependant moins outrancière, puisque M. Bourguiba, dans ses déclarations, donne le chiffre de 150.000, fait grand état des prétendus «200.000 réfugiés algériens».
Dans ce chiffre de « 200.000 », exagérément gonflé par la rébellion pour les besoins de sa cause, figurent déjà :
- 100.000 Français musulmans d'Algérie résidant en Tunisie avant la rébellion (courrant d'émigration normal), dont près de 50.000 dans l'agglomération de Tunis;
- environ 2.000 « bourgeois aisés » d'Algérie, venus chercher une relative « tranquillité » sur le territoire de la Régence ;
- plusieurs milliers de travailleurs venus volontairement, certains d’entre eux étant ensuite partis en France, laissant leurs familles en Tunisie ;
- environ 10.000 rebelles appartenant à I'organisation permanente du F.L.N. et aux bandes de I'A.L.N. installées en territoire tunisien ;
- enfin, de 6.000 à 10.û00 « réfugiés », pour la plupart dispersés dans la zone frontalière où ils nomadisent (environ 1.000 d'entre eux sont à Tunis). Beaucoup de ces réfugiés sont des familles de rebelle : Ies autres; des habitants de douars frontaliers, emmenés par les hors-la-loi.
Buts de cette campagne.
En fait, cette campagne, chaque jour mieux orchestrée, a un double objectif
- le premier, politique, consiste à essayer, par. ce moyen. de saisir l'O.N.U. de cet aspect particulier de la « question algérienne », internationalisant ainsi le problème.;
- le second, plus terre à terre, cherche à obtenir de I'organisation internationale s'occupant des réfugiés et personnes déplacées, des avantages comparables à ceux que cet organisme a consentis à l'Autriche après les dramatiques événements de Hongrie.
Par ailleurs, dans le cadre de cette politique, le gouvernement tunisien aurait décidé d'éliminer la plus grande partie des Algériens des emplois qu'ils occupent actuellement en Tunisie, en particulier dans les mines de Gafsa. Les places rendues vacantes seraient distribuées à des Tunisiens sans emploi, et les «chômeurs » algériens, devenus «réfugiés» sans subsides, seraient alors pris en charge par l'Organisme international d'Aide aux Réfugiés.
En Algérie, conformément à cette politique, (les bandes de l'A.L.N. qui opèrent de part et d'autre de la frontière algéro-tunisienne, tentent par tous les moyens, et le plus souvent par la violence, de transférer en Tunisie le maximum de population rurale frontalière.
Une enquête de gendarmerie menée ces dernières semaines, avec simplicité et conscience, sur plus de 100 kilomètres de zone frontalière, aux limites Nord-Est du département de Bône, éclaire tout particulièrement cet aspect du problème.
Elle fait apparaître :
L 'effort de propagande du F.L.N.
Les habitants d'urne mechta située it proximité de la frontière tunisienne, et sans défense contre les incursions des hors-la-loi venant de Tunisie, ont déclaré :
« Au cours de leurs fréquentes visites dans notre mechta, les hors-la-loi ont rassemblé les hommes, les mains en l'air, et se sont emparé des maigres sommes d'argent trouvées sur les habitants. Ils ont ensuite obligé les femmes à leur préparer un repas. Par exemple, fin Mai, un chef de groupe du nom de Si Abdel Madjid, chef de groupes hors-la-loi, a tenu un discours dans lequel il demandait aux habitants de partir en Tunisie où des camps étaient préparés pour les accueillir et où ils connaîtraient enfin la tranquillité. »
Dans la même nuit, les hors-la-loi tenaient des propos identiques aux habitants d'autres mechtas situées plus au nord.
Quelques jours après, le dénommé N..., habitant de la première mechta, et deux de ses fils, se rendaient en Tunisie pour y constater les conditions de vie des réfugiés, et sous l'emprise de la peur et de la menace, une partie des habitants a commencé à déménager.
Le 1er juin 1937, sur le chemin de l'exode, ces « futurs réfugiés » ont rencontré N... et ses deux fils. Après un bref conciliabule au cours duquel le sort offert par le Gouvernement tunisien a été discuté, tout le monde, d'un commun accord, a décidé de rejoindre la « mechta » et de ne pas aller en Tunisie, où les conditions de vie étaient plus difficiles qu'en Algérie.
Aujourd'hui, ces populations ont réclamé la protection de la troupe pour pouvoir dormir la nuit sans angoisse et travailler le jour en sécurité.
La vie dans les zones de repli de Tunisie.
Plusieurs familles d'un douar ont rejoint la Tunisie sous la pression des rebelles ; certaines ont pu tromper la vigilance des hors-la-loi et retourner en Algérie se placer sous la protection de l'Armée au camp de..., et ont déclaré :
« Dès notre arrivée en Tunisie, les autorités tunisiennes nous ont retiré nos cartes d'identité et remis en échange un papier attestant notre qualité de « réfugié».
La vie dans les zones de repli est difficile.
« Les produits de première nécessité sont hors de prix (une galette d'une livre coûte 100 francs). II n'y a pas de pain, car il n'y a plus de boulanger. Les chefs de familles n'ont aucune ressource, si ce n'est celle de vendre à bas prix le bétail qu'ils ont réussi à emmener.
« D'autre part, les autorités tunisiennes interdisent la circulation et se désintéressent complètement des conditions de vie des réfugiés. Par ailleurs, ces derniers sont exploités par les hors-la-loi qui réquisitionnent les hommes et les mulets pour leurs transports. »
« La population tunisienne est, d'autre part, hostile. Elle considère les réfugiés algériens comme des intrus venus partager leurs ressources déjà maigres. Avec bonne conscience, elle leur vend cher les produits de première nécessité.
« La plupart de ces « réfugiés » ont été obligés, pour vivre, de vendre en Tunisie tout ce qu'ils avaient emporté, et ils se trouvent actuellement sans ressource, abandonnés à l'arbitraire d'une administration F.L.N. et à la merci d'une charité hypothétique. »
Le F.L.N., très au courant des sentiments profonds qui animent ces réfugiés, leur interdit le retour en terre natale, un réseau de guetteurs mis en place le long de la frontière ayant pour mission d'intercepter tout Algérien qui essaierait de regagner son pays.
En dépit de cette surveillance, de nombreux réfugiés ont réussi à rentrer, et plusieurs ont fait à la Gendarmerie des déclarations faisant ressortir que les efforts de propagande déployés par les pays arabes favorables à la rébellion ont de moins en moins prise sur les fellahs, lassés par ailleurs des exactions et des servitudes que leur imposent les hors-la-loi.
Procès - verbaux de gendarmerie.
Déclaration de M. Saïd ben Ali, âgé de 17 ans : « J'ai rejoint le territoire tunisien, avec toute ma famille ainsi que les habitants de la mechta..., aux environs du 5 septembre 1956.
« Avec ma famille, nous avons rejoint le lieu « T... » dans le cheïkhat « M... » en territoire tunisien. Quand nous sommes arrivés à l'endroit qui nous était assigné, nous avons construit un « gourbi ». Cet emplacement nous avait été prêté par un ami de mon père.
« Mon père, retraité de l'Armée française, avait réussi à faire transférer son carnet de pension à « G... » (Tunisie). Nous n'avions comme ressources que la pension de mon père, payée par la France.
« Nous étions sans travail, et les Tunisiens ne pouvaient nous en donner. La vie était très chère : 25 francs le kilo de sel, et 75 francs le kilo de semoule.
« Lorsque nous avions quitté le douar M..., nous avions emmené cinq vaches et un mulet avec nous.
« Assez souvent, pendant notre séjour en Tunisie, les fellagha algériens venaient prendre le mulet de mon père pour transporter leur ravitaillement. Les autorités tunisiennes se désintéressaient entièrement de nous, et nous étions à la merci des fellagha algériens.
« Pour subvenir à nos besoins, mon père ,a été obligé de vendre deux vaches au marché de « O... ».
« Au bout de six mois, la misère aidant, les Tunisiens considérant notre présence comme inopportune, nous avons décidé, d'un commun accord avec les gens de notre mechta, de rejoindre le douar M... et de nous remettre sous la protection de la France.
J'ai rejoint le douar M..., avec toute ma famille, vers la fin avril 1957, et nous avons réoccupé la mechta « I..».
« Au cours de ce déménagement, et alors que je me rendais à la mechta «I... », en Tunisie avec le mulet de mon père, les fellagha algériens m'ont arrêté à « 0... », m'ont pris une gargoulette de petit-lait, et m'ont menacé de m'égorger.
« En revenant au douar « M... »; j'ai quitté ma famille et me suis rendu à x... où je me suis placé sous la protection de l'Armée, obéissant à mon père.
« Je ne puis vous dire si l'exode vers la Tunisie a été le fait d'une propagande tunisienne ou F.L.N. : trop ,jeune, je n'étais pas admis aux réunions des hommes.»
Déclaration de B... Amara, né présumé en 1890 au douar M..., département de Bône :
« Le 20 mai 1956, j'ai rejoint la Tunisie avec toute ma famille et mes biens. Je me suis réfugié au douar M..., mechta M..., chez mon beau-frère G... J'avais trois vaches et une mule. Durant mon séjour en Tunisie, je n'ai pas trouvé de travail et je n'ai pas eu de terres à cultiver. Pour subvenir aux besoins de ma famille, j'ai été obligé de vendre deux vaches sur trois, et les Tunisiens nous obligeaient à payer comptant les marchandises que nous prenions. Malgré l'appui de mon cousin qui était « taleb » (instituteur arabe) de la mechta, nous étions très malheureux. Les Tunisiens nous exploitaient, et l'on sentait qu'ils cherchaient à nous dépouiller de tout ce que l'on avait, pour nous obliger à partir. Devant l'intransigeance des Tunisiens, et après avoir su que les autorités françaises nous accueilleraient bien à notre retour, j'ai décidé de rejoindre ma mechta, au douar M..., avec ma famille. Cela fait deux mois et demi que je suis rentré.
« Je tiens à vous dire qu'après cette expérience, je préfère mourir en Algérie plutôt que de retourner en Tunisie.
« Les gens qui vous diront que la vie en Tunisie est facile et agréable sont des menteurs, et s'ils le disent, c'est qu'ils ne peuvent pas revenir à leur mechta d'origine, car ils sont trop compromis avec les hors-la-loi.
« Tous ceux qui étaient dans le même cas que moi étaient très malheureux et ne demandaient qu'à revenir en Algérie.»
1er août 1957. Une convergence de renseignements très sérieux confirme que, dans le département de Bône, on note un mouvement de retour de réfugiés », de Tunisie. Plusieurs familles de différents douars frontaliers ont regagné leurs mechtas et se sont présentées aux autorités locales.
Ces Musulmans déclarent que, non seulement les autorités tunisiennes ne leur ont apporté aucun secours, mais encore que la population leur a pris le peu qu'ils avaient emmené avec eux.
Certains étaient épuisés, et tombaient d'inanition à leur arrivée.
INDÉPENDANCE
ET UNITÉ DE LA RÉBELLION
CRITIQUE
Les mouvements nationaux algériens (Armée de la Libération et Front de Libération Nationale) mènent la guerre contre la France et sont indépendants de toute attache avec les partis politiques.
RÉPONSE
Si l'on veut dire par-là que le F.L.N. n'a pas de liens avec l'autre parti nationaliste algérien (M.N.A.), cette affirmation est exacte. Non seulement le F,L.N. et le M.N.A. n'ont aucune attache, mais les luttes qui les opposent sont maintenant trop connues pour qu'il soit besoin de les exposer ici. Si le M.N.A. a déposé lui aussi auprès du Secrétaire des Nations Unies un mémoire où il expose les revendications des nationalistes algériens (sans faire allusion au F.L.N.), c'est bien qu'il estime lui aussi représenter les mouvements nationaux.
Par contre, la collusion avec le parti communiste ne fait plus aucun doute. Elle est prouvée par un certain nombre de faits :
1°) Dès le début. de la rébellion, le P.C. s'est élevé contre la répression du terrorisme par voie de presse et par des tracts.
2°) Le 12 novembre 1954, Paul Caballero, secrétaire du P,C,A., prend contact avec les rebelles de l'Aurès.
3°) Le 17 juin 1955, à Oran, Roland Ibanez, secrétaire régional du P.C.A., déclare en présence de représentants de l'U.D.M.A. et de l'ex-M.T.L.D. : « ... Je suis autorisé aujourd'hui, pour la première fois, à vous annoncer que notre parti est représenté dans les Aurès et qu'il y a engagé des groupes armés... »
1°) Après sa dissolution, le 12 septembre 1955, l'activité du P.C.A. continue : le 6 avril 1956, l'aspirant communiste Maillot détourne un camion d'armes. Ces armes ont été partiellement retrouvées, au cours d'opérations contre les rebelles.
5°) Le 7 juin 1956, Maillot et un autre communiste, André Laban, sont abattus au cours d'un engagement alors qu'ils combattaient avec des rebelles dans la région de l'Ouarsenis.
6°) Le P.C.A. a organisé des maquis lui appartenant en propre. Ils sont chargés d'effectuer des destructions aux endroits où F.L.N. et M.N.A. ne peuvent accéder. Le fonctionnement des maquis laissait supposer l'existence dans les villes de réseaux de complicité. Ces réseaux ont été découverts à Alger (hôpital de Mustapha), à Oran, à Constantine et à Blida (mai 1957).
7°) Les bombes qui ont explosé à Alger au Milk-Bar et à la Cafétéria, au début d'octobre 1956, avaient été fabriquées et déposées avec la complicité des communistes.
8°) Sur les trois bombes qui ont explosé à Alger le 12 novembre 1956 et ont fait au total 36 victimes, dont la plupart blessées très grièvement, deux ont la même origine que celles de la Cafétéria et du MilkBar.
9°) Le 11 novembre 1956, un communiste, Yveton, était arrêté au moulent où il déposait une bombe à retardement à l'usine à gaz d'Alger-Hamma. Au cours de son interrogatoire, il a donné les noms de deux autres communistes qui seraient les auteurs de l'incendie des Bouchonneries d'Hussein-Dey, qui a eu lieu au début novembre 1956.
CRITIQUE
Le F.L.N. et l'Armée de Libération Nationale se sont acquis le soutien unanime du peuple algérien dans leur résistance à l'agression colonialiste.
RÉPONSE
Le soutien unanime du peuple algérien que revendique la rébellion signifierait l'acceptation totale et spontanée des directives, du versement de «l'impôt », de l'engagement dans l’«Armée de Libération» et de la non-coopération avec les Européens.
Or, les consignes du F.L.N., telles que l'interdiction de fumer, le boycottage de certains commerçants, les mots d'ordre de grève, ou l'obligation de payer l'impôt à la rébellion, n'ont jamais été spontanément suivis par la population musulmane puisque les rebelles durent avoir recours aux exécutions et mutilations ; de plus, sur sept victimes du terrorisme, six sont musulmanes. Les nombreux tracts diffusés pat le F.L.N., ou trouvés sur certaines victimes témoignent clairement que le F.L.N., faute de pouvoir persuader, doit recourir à la menace et à la contrainte : « Le F.L.N. ordonne sous peine de mort... », ou « ... a été exécuté pour ne pas avoir suivi les instructions... »
Unanime derrière la rébellion, la population musulmane aurait fait de celle-ci un mouvement de masse. Or, rien de tel n'a jamais été constaté ; au contraire, les méthodes totalitaires du F.L.N. doivent s'exercer constamment envers une population qu'il ne peut convaincre : les 302 victimes de Melouza refusaient de se soumettre, les 38 victimes de Wagram avaient désobéi à la consigne du F.L.N. qui leur interdisait de travailler chez les « colonialistes » et de bénéficier de la reforme agraire.
Si la population était vraiment désireuse de refuser toute coopération avec les Européens, assisterait-on à des ralliements chaque jour plus nombreux (2) ? Aurait-on pu faire des distributions d'armes et constituer des groupes d'auto-défense (2) ? Aurait-on pu procéder à la mise en place de délégations spéciales dans les communes et de commissions administratives dans les départements, ces organismes comprenant environ 80 % de délégués musulmans ? Aurait-on pu voir 3.852 Français Musulmans intégrés dans la Fonction publique, au bénéfice de la réforme du 17 mars 1956 ? 250 Français Musulmans viendraient-ils tous les mois s'engager volontairement dans l'Armée ?
Ainsi la rébellion algérienne n'est en aucune façon un mouvement national, suivi et animé par tout le peuple algérien, mais bien une entreprise totalitaire, puisque le F.L.N. entend, par les méthodes les plus inhumaines, éliminer toute opposition, toute contradiction, et punir toute désobéissance à ses consignes dictatoriales, au mépris des principes démocratiques dont il se réclame devant le tribunal du monde civilisé.
(1) Redditions : 1956 : 147 redditions (à peu prés toutes sans armes) ;
1957 (7 mois) : 310 redditions dont 106 avec armes,
Villages ralliés du 1er janvier au 1er juillet 1957 : 139.
(2) Du 1er janvier au 1er juillet 1957, 176 villages ont organisé leur autodéfense (effectifs totaux des harkas : 10.725).
CRITIQUE
L'attitude d'anti-collaborationisme politique et économique adoptée par le peuple algérien n'a pas tardé à être suivie d'un anti-collaborationisme administratif. Les fonctionnaires, même ceux qui traditionnellement n'étaient que des hommes de paille du régime colonial, démissionnaient en nombre de plus en plus grand.
RÉPONSE
Non seulement les fonctionnaires musulmans n'ont pas démissionné, mais la réforme concernant l'accession des Musulmans à la fonction publique est sans conteste celle dont l'application a été la plus fructueuse.
Tous les détails sur cette réforme sont donnés dans la partie Pacification - Réformes - Réformes sociales : Accession des Musulmans à la fonction publique
Algérie 1957, cabinet du ministre de l’Algérie
|
|
PHOTOS DE BÔNE
Envois divers
|
|
LES ÉTAPES DU GRAND GÂCHIS
Les oubliés du 19 mars
Alain VINCENOT
|
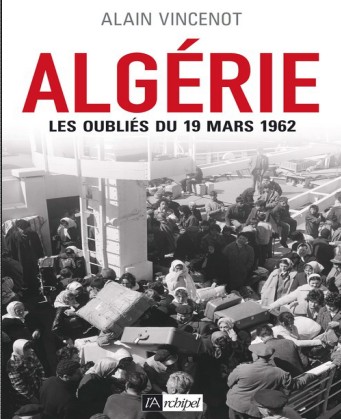
Première partie
« Les mondes dépourvus de mémoire sont condamnés à être des mondes sans avenir. »
Samuel Pisar, Le Sang de l’espoir
« Le diable en France était un diable aimable, plein de manières. Ce que sa nature avait de diabolique se manifestait seulement dans l’indifférence courtoise dont il faisait preuve face aux souffrances des autres, dans son je-m’enfoutisme et sa lenteur administrative. »
Lion Feuchtwanger,
IL Y AVAIT EU L’ESPOIR
Les réticences ne se justifiaient pas. Toutes les garanties bordaient les accords d’Évian signés le 18 mars 1962.
« Les Français bénéficieront des même droits et libertés démocratiques que les Algériens. Ils pourront aller et venir librement entre l’Algérie et les autres pays. Ils exerceront les droits “civils”, c’est-à-dire qu’ils pourront effectuer, comme des nationaux, tous les actes juridiques nécessaires dans la vie privée : acheter, louer, passer des contrats de toute sorte. Ils pourront, notamment, exercer toutes les professions, bénéficier de la Sécurité sociale, etc. La jouissance des droits patrimoniaux est garantie contre toute mesure arbitraire ou discriminatoire. Les particularismes seront respectés sur le plan culturel, juridique et religieux : emploi de la langue française, liberté de l’enseignement, sections françaises dans l’enseignement public, statut personnel… »
Sur une affiche du gouvernement – un garçonnet européen tenant par l’épaule une fillette arabe, ils se regardent en riant – ce message annonciateur de lendemains radieux : « Pour nos enfants, la paix en Algérie ». Les accords d’Évian devaient, assurait le général de Gaulle, permettre à « deux peuples de marcher, main dans la main, sur la route de la civilisation » : que du papier!
Plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants allaient être chassés d’une terre que, depuis des générations, ils avaient travaillée, enrichie, façonnée de prairies, de champs, de vignes et de vergers, qu’ils avaient hérissée de bourgades et de villes, une terre dont ils avaient peuplé les cimetières et qu’ils croyaient être un pan inaliénable de leur patrie, la France, qu’à l’école, ils avaient appris à vénérer. Après les Numides, les Phéniciens, les Vandales, les Romains, les Byzantins, les Arabes et les Ottomans, leurs aïeux, poussés par la misère, une condamnation à l’exil ou des chambardements politiques, étaient venus de toute l’Europe, beaucoup ne tardant pas à succomber aux épidémies, aux travaux harassants, à la malnutrition, au manque de soins et aux bandes armées arabes. À leurs descendants, ils avaient transmis en héritage leur ardeur au travail et l’idéal républicain de Jules Ferry, le père de l’école « publique, gratuite et obligatoire », qui, le 28 juillet 1885, à la Chambre des députés, avait vanté les mérites de l’expansion coloniale : « Je soutiens que les nations européennes s’acquittent avec largeur, avec grandeur et honnêteté, de leur devoir supérieur de civilisation. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Ces devoirs ont été méconnus dans les siècles précédents. Et certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l’esclavage dans l’Amérique centrale, ils n’accomplissaient pas leur devoir d’hommes de race supérieure…»
Les pieds-noirs se pensaient chez eux dans ces départements français, sur l’autre rive de la Méditerranée. En 1958, après des années de tergiversations politiciennes et d’instabilité gouvernementale en métropole, d’attentats du FLN et d’incertitudes sur l’avenir qui minaient la population et l’armée en Algérie, beaucoup ont cru en la parole du général de Gaulle. Durant la Deuxième Guerre mondiale, n’avait-il pas refusé de s’incliner devant la barbarie et sauvé l’honneur de la France piétinée par l’Occupant nazi et ses collaborateurs vichyssois ?
Le 20 janvier 1946, lassé des chicaneries parlementaires, l’homme de l’Appel du 18 juin avait démissionné avec fracas de la présidence du Conseil, « je fous le camp », persuadé que ses compatriotes ne tarderaient pas à le rappeler. Pendant douze ans, ils allaient l’abandonner dans sa retraite de Colombey-les-deux-Églises. Son retour s’est effectué en plusieurs étapes, sur fond d’énième crise de la IVème République qui s’embourbait. Des relents de coup d’État.
Le 15 avril 1958, le gouvernement de Félix Gaillard, socialiste de la SFIO, mis en minorité au parlement, vient de tomber. Le 9 mai, le président de la République, René Coty, charge Pierre Pflimlin, un démocrate-chrétien du MRP, habitué des maroquins ministériels, de former un nouveau gouvernement, le vingt-troisième de la IVème République, en douze ans.
Ce même jour, le général Raoul Salan, commandant en chef interarmées en Algérie, adresse au général Paul Ély, chef d’état-major des armées, un télégramme à remettre au président Coty :
« L’armée en Algérie est troublée par le sentiment de sa responsabilité à l’égard des hommes qui combattent et qui risquent un sacrifice inutile si la représentation nationale n’est pas décidée à maintenir l’Algérie française, comme le préambule de la loi-cadre le stipule, à l’égard de la population française de l’intérieur qui se sent abandonnée et des Français musulmans qui, chaque jour plus nombreux, ont redonné leur confiance à la France, assurés de nos promesses réitérées de ne jamais les abandonner. L’Armée française, d’une façon unanime, sentirait comme un outrage l’abandon de ce patrimoine national. On ne saurait préjuger de sa réaction de désespoir. Je vous demande de bien vouloir appeler l’attention du président de la République sur notre angoisse que seul un mouvement fermement décidé à maintenir notre drapeau en Algérie peut effacer. »
Toujours le 9 mai, à Tunis, un communiqué du FLN annonce que trois appelés du contingent, le sergent Robert Richomme, les soldats René Decourteix et Jacques Feuillebois, enlevés par des fellaghas le 1er novembre 1956 à la frontière, près de La Calle, ont été fusillés, après un simulacre de procès, le 25 avril, en Tunisie. Officielle depuis sa récente accession à l’indépendance, la neutralité de ce pays voisin ne pèse guère face à la solidarité arabo-musulmane.
Le 11 mai, Alain de Sérigny(1), directeur de L’Écho d’Alger, signe dans Dimanche matin, le supplément dominical du quotidien, un éditorial sous le titre : « Parlez, mais parlez vite, mon général ». Pétainiste pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce pied-noir d’adoption, né à Nantes, rallie l’ancien chef de la France libre :
« En Algérie, ce n’est un secret pour personne que L’Écho d’Alger, dont j’assume la direction depuis 1941, a pris, dès cette époque, une position très nette en faveur de la politique suivie en Afrique du Nord par le maréchal Pétain et conduite par un chef prestigieux, le général Weygand.
Aujourd’hui, mon général, la situation de l’Algérie et, partant, de la France, est positivement dramatique. Ce n’est pas le plan militaire qui nous inquiète, c’est ce qu’on appelle communément, le “front intérieur” qui nous angoisse.
À cor et à cris, l’Algérie tout entière, privée de sa représentation légale à l’Assemblée nationale, supplie en vain le parlement de faire taire ses querelles intestines pour la formation d’un gouvernement de salut public, seul capable de sauver du désastre dix millions de Français qui, aux yeux de certains, commettent sans doute un crime en voulant rester français.
Dans leur détresse, vers qui se tourneraient ces Français sinon vers l’homme qui s’est tenu rigoureusement à l’écart de ces luttes misérables et qui incarne l’attachement à la seule cause de la patrie ?
Je n’ignore pas, mon général, qu’à plusieurs de vos amis qui s’étonnaient de votre silence vous avez répondu fort à propos : “À quoi bon parler si l’on ne peut pas agir ?” Aujourd’hui, me tournant vers vous, je m’écrie : Je vous en conjure, parlez, parlez vite, mon général, vos paroles seront une action. »
Le 13 mai, Pierre Lagaillarde, avocat, officier parachutiste de réserve et président de l’Association générale des étudiants d’Algérie (AGEA), le général Salan et son adjoint, le général Edmond Jouhaud, un pied-noir, ainsi que plusieurs chefs militaires, dont l’amiral Philippe Auboyneau, qui commande les forces maritimes en Algérie, soutenus par le général Jacques Massu, ancien combattant de la France libre, Compagnon de la Libération, et sa 10ème division parachutiste, appellent les Algérois à se joindre à eux, square Laferrière, devant le monument aux morts d’Alger, que domine le Gouvernement général, dans un hommage aux trois appelés exécutés en Tunisie par le FLN. Depuis le 11 novembre 1928, date de son inauguration, Le Grand Pavois, œuvre du sculpteur Paul Landowski, symbolise la fraternité franco-algérienne dans les combats de la Grande Guerre(2). Grève générale. Magasins fermés. Des flots denses, pieds-noirs, Arabes, convergent vers le square Laferrière. Alger la blanche éclate de lumière sous le soleil. Drapeaux et banderoles colorent de bleu-blanc-rouge la foule, de plus en plus compacte, d’où s’élèvent La Marseillaise, Le Chant des Africains(3) et ce slogan scandé en cinq notes :
« Al-gé-rie fran-çaise ! Al-gé-rie fran-çaise ! »
Même allégresse à Oran. José Castano a douze ans. Il racontera : « Pour la première fois, une race neuve prend conscience d’elle-même. Ce n’est pas une voix isolée qui crie et qui chante sa joie au hasard de l’inspiration. C’est tout un chœur de jeunes volontés qui s’accordent dans un même rythme, qui se sont groupées avec intention et qui savent parfaitement ce qu’elles veulent : une Algérie unie, une Algérie fraternelle, une Algérie en paix. “Arrachez vos voiles !”, ordonna une femme musulmane à un petit groupe de jeunes filles, vous êtes libres. Les haïks tombent un à un … »(4)
Conduits par Pierre Lagaillarde, en tenue « léopard », des manifestants s’emparent du Gouvernement général et constituent un Comité de salut public. Présidé par le général Massu et composé de militaires et de civils, dont des gaullistes très actifs, il exige que soit créé, à Paris, un gouvernement de salut public, « seul capable de conserver l’Algérie partie intégrante de la métropole ».
Dans la nuit, Pierre Pflimlin reçoit l’investiture de l’Assemblée nationale. Les partisans de l’Algérie française se méfient de lui. Ils lui reprochent de vouloir négocier avec le FLN, par l’entremise du Maroc et de la Tunisie.
Le 14, au petit matin, le général Massu « supplie le général de Gaulle de bien vouloir rompre le silence en vue de la constitution d’un gouvernement de salut public qui seul peut sauver l’Algérie de l’abandon ».
Manchette en première page de L’Écho d’Alger : « Journée et nuit d’insurrection patriotique ».
Le 15, déclaration du général de Gaulle :
« La dégradation de l’État entraîne infailliblement l’éloignement des peuples associés, le trouble de l’armée au combat, la dislocation nationale, la perte de l’indépendance. Depuis douze ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime des partis, est engagée dans ce processus désastreux.
Naguère, le pays, dans ses profondeurs, m’a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu’à son salut. Aujourd’hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu’il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. »
À la Une de France Soir, ce jeudi 15 mai :
« Investi, l’autre nuit par 274 voix contre 129, après le coup de force du général Massu à Alger, Pflimlin : “J’ai chargé le général Salan de maintenir l’ordre à Alger. Il assume cette mission depuis mercredi matin.” »
Le 16, à 12 heures, du balcon du Gouvernement général, le général Salan lance à des milliers d’Algérois, toutes communautés confondues, massés sur le Forum :
« Tout d’abord, sachez que je suis des vôtres, puisque mon fils est enterré au cimetière du Clos-Salembier. Je ne saurais jamais l’oublier puisqu’il est sur cette terre qui est la vôtre. Depuis dix-huit mois, je fais la guerre aux fellaghas. Je la continue et nous la gagnerons.
Ce que vous venez de faire, en montrant à la France votre détermination de rester Français par tous les moyens, prouvera au monde entier que, partout et toujours, l’Algérie sauvera la France.
Tous les musulmans nous suivent. Avant-hier, à Biskra, 7 000 musulmans sont allés porter des gerbes au Monument aux Morts pour honorer la mémoire de nos trois fusillés en territoire tunisien.
Mes amis, l’action qui a été menée ici a ramené près de nous tous les musulmans de ce pays. Maintenant, pour nous, le seul terme, avec tous ici, c’est la victoire avec cette armée que vous n’avez cessé de soutenir, que vous aimez et qui vous aime. Avec les généraux qui m’entourent, le général Jouhaud, le général Allard, le général Massu qui, ici, vous a préservés des fellaghas, nous gagnerons parce que nous l’avons mérité et que là est la voie sacrée pour la grandeur de la France. Mes amis, je crie : “Vive la France ! Vive l’Algérie française !… Et vive De Gaulle !” »
Le 19, conférence de presse au palais d’Orsay, à Paris : le général de Gaulle se pose en recours.
« Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l’Algérie peut conduire à une crise extrêmement grave. Mais aussi ce peut être le début d’une espèce de résurrection. Voilà pourquoi le moment m’a semblé venu où il pourrait m’être possible d’être utile, encore une fois, directement à la France. »
Et cette phrase : « Croit-on qu’à soixante-sept ans, je vais commencer une carrière de dictateur ? »
Le 21, un titre à la une de La Dépêche Quotidienne d’Algérie : « Salan à de Gaulle : “Vos paroles ont fait naître une immense espérance de grandeur et d’unité nationale.” »
Le 27, communiqué du général de Gaulle :
« J’ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l’établissement d’un gouvernement républicain capable d’assurer l’unité et l’indépendance du pays. Je compte que ce processus va se poursuivre et que le Pays fera voir, par son calme et sa dignité, qu’il souhaite le voir aboutir. Dans ces conditions, toute action, de quelque côté qu’elle vienne, qui met en cause l’ordre public, risque d’avoir de graves conséquences. Tout en faisant la part des circonstances, je ne saurais l’approuver. J’attends des forces terrestres, navales et aériennes, présentes en Algérie, qu’elles demeurent exemplaires, sous les ordres de leurs chefs : le général Salan, l’amiral Auboyneau, le général Jouhaud. À ces chefs, j’exprime la confiance et mon intention de prendre incessamment contact avec eux. »
Le 29, un message du président Coty est lu au parlement :« Nous voici maintenant au bord de la guerre civile. Après s’être, depuis quarante ans, tant battus contre l’ennemi, les Français vont-ils, demain, se battre contre les Français ? De part et d’autre, des hommes ont la conviction profonde de servir la Patrie, que, parmi les uns comme parmi les autres, beaucoup ont défendue au prix de si durs sacrifices. De part et d’autre, on semble s’apprêter au combat fratricide. Sommes-nous une nation où la force pourrait primer le droit ? Quels que soient les vainqueurs provisoires, que resterait-il, après une lutte inexpiable, que resterait-il de notre France ? […].
Dans le péril de la Patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, celui qui, aux années les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la reconquête de la liberté et qui, ayant ainsi réalisé autour de lui l’unanimité nationale, refusa la dictature pour rétablir la République. »
Le 30, en couverture du Courrier de la colère, fondé en novembre 1957 par Michel Debré, sénateur d’Indre-et-Loire et partisan de l’Algérie française, une photo du général de Gaulle et un éditorial titré « Unité et Union » :
« Il jaillit comme une condamnation des folles politiques qui ont gaspillé l’héritage ancien et les chances nouvelles. Il jaillit comme une condamnation d’un État impuissant, inapte à assurer l’avenir de la liberté et l’honneur des citoyens. Il jaillit comme une condamnation des hommes, des quelques hommes qui, contre toute bonne foi, s’entêtent, depuis des mois, à maintenir un régime inconsistant, source principale de nos malheurs.
Mais il jaillit aussi, ce cri, comme un espoir. Qui peut douter désormais dans le monde de la volonté de l’Algérie de demeurer française ? Qui peut douter désormais de la foi patriotique non seulement de l’armée du peuple, mais également du peuple qui se retrouve dans son armée ? La France est en train de faire une révolution, qui est la révolution de l’honneur outragé contre le mensonge et la honte, la révolution de la nation jeune qui veut grandir contre un système qui l’étouffe jusqu’à la mort… » Dans le numéro du 2 décembre 1957 de son « hebdomadaire politique paraissant le jeudi », Michel Debré écrivait :
« Le seul problème, pour ceux qui entendent séparer l’Algérie de la France, est d’imaginer le système juridique ou la politique qui mettra hors de la légalité les défenseurs de l’Algérie française. Tant que la loi en Algérie est la loi française, le combat pour l’Algérie française est le combat légal ; l’insurrection pour l’Algérie française est l’insurrection légitime. »
Le 1er juin, le général de Gaulle prononce son discours d’investiture à l’Assemblée nationale :
« La dégradation de l’État qui va se précipitant. L’unité française immédiatement menacée. L’Algérie plongée dans la tempête des épreuves et des émotions. La Corse subissant une fiévreuse contagion. Dans la métropole, des mouvements en sens opposé renforçant d’heure en heure leur passion et leur action. L’armée, longuement éprouvée par des tâches sanglantes et méritoires, mais scandalisée par la carence des pouvoirs. Notre position internationale battue en brèche jusqu’au sein même de nos alliances. Telle est la situation du pays. En ce temps même où tant de chances, à tant d’égards, s’offrent à la France, elle se trouve menacée de dislocation, et, peut-être, de guerre civile.
C’est dans ces conditions que je me suis proposé pour tenter de conduire une fois de plus au salut le pays, l’État, la République et que, désigné par le chef de l’État, je me trouve amené à demander à l’Assemblée nationale de m’investir pour un lourd devoir. De ce devoir il faut les moyens.
Le Gouvernement, si vous voulez l’investir, vous proposera de les lui attribuer aussitôt. Il vous demandera les pleins pouvoirs, afin d’être en mesure d’agir dans les conditions d’efficacité, de rapidité, de responsabilité que les circonstances exigent. Il vous les demandera pour une durée de six mois, espérant, qu’au terme de cette période l’ordre rétabli dans l’État, l’espoir retrouvé en Algérie, l’union refaite dans la nation permettront aux pouvoirs publics de reprendre le cours normal de leur fonctionnement… »
Le nouveau président du Conseil obtient 329 voix contre 224.
S’ouvre alors le temps de l’allégresse, de la sérénité, de l’espoir en l’avenir. Un mirage, que le général de Gaulle, à peine installé à l’hôtel Matignon, entretient savamment lors d’un voyage de trois jours en Algérie.
Le 4 juin, Alger l’accueille dans une explosion de joie. Des nuées de papillons de papier multicolores saluent le passage de sa voiture. À ses côtés : le général Salan. Dans la soirée, une marée humaine envahit le Forum devant le Gouvernement général, où il doit prendre la parole. Elle crie : « Al-gé-rie fran-çaise ! Al-gé-rie fran-çaise ! », « Vive Salan ! »,
« Vive de Gaulle ! », « Soustelle avec nous ! » En février 1956, des dizaines de milliers d’Algérois avaient hurlé leur désarroi, lorsque le président du Conseil, Guy Mollet, avait « limogé » Jacques Soustelle, gouverneur général d’Algérie, qu’ils estimaient. Du balcon de l’imposante bâtisse, le général de Gaulle lance :
« Je vous ai compris ! Je sais ce qui s’est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c’est celle de la rénovation et de la fraternité […]. Eh bien ! de tout cela, je prends acte au nom de la France et je déclare, qu’à partir d’aujourd’hui, la France considère que, dans toute l’Algérie, il n’y a qu’une seule catégorie d’habitants : il n’y a que des Français à part entière, des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu’il faut ouvrir des voies qui, jusqu’à présent, étaient fermées devant beaucoup. Cela signifie qu’il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. Cela signifie qu’il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. Cela veut dire qu’il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d’en avoir une… »
Le lendemain, à Bône :
« Voilà ce que l’on n’a jamais vu ! Voilà une flamme immense qui sort de toutes ces âmes ! Rénovation ! Fraternité ! Voilà ce que Bône à son tour crie aujourd’hui à la France […]. Que ceux-là qui ont mené, par désespoir, avec courage, un combat cruel et fratricide reviennent prendre part à notre fraternité, la porte leur est ouverte […]. Venez à la France, elle, ne vous faillira pas. J’en suis sûr, aujourd’hui plus que jamais… »
Et à Constantine :
« On ne fait rien de grand sans grand mouvement des âmes et des esprits […]. Ce grand mouvement, l’Algérie l’a suscité […]. Qui peut le faire, l’organiser, sinon la France ? […]. Dans trois mois, les dix millions de Français qui vivent en Algérie doivent participer avec la France tout entière à l’immense référendum qui décidera de son destin… »
Le 6 juin, dans la matinée, à Oran :
« La France est ici ! Elle est ici pour toujours. Elle est ici en vous, hommes et femmes d’Algérie de toutes communautés, catégories et confessions. Elle est ici dans son armée qui accomplit une tâche magnifique de sécurité, et avec une ténacité qui restera à jamais gravée dans notre histoire.
Elle est ici en ma personne qu’elle a mandatée pour la conduire.
Si vous saviez comme j’en ressens l’honneur et la responsabilité […].
Vive Oran, ville que j’aime et que je salue, bonne, chère grande ville française. Vive la République ! Vive la France ! »
Auparavant, rue d’Arzew, la DS19 noire du président du Conseil, qui roulait vers le centre, est passée devant le cinéma Le Rialto. Sur la façade, en grosses lettres : Les Carottes sont cuites, film de Robert Vernay, avec Jeanne Sourza, Raymond Souplex, Pauline Carton et Jackie Sardou. Programmation prémonitoire.
L’après-midi, à Mostaganem :
« Il est parti de cette terre magnifique d’Algérie un mouvement exemplaire de rénovation et de fraternité. Il s’est élevé de cette terre éprouvée et meurtrie un souffle admirable qui, par-dessus la mer, est venu passer sur la France entière pour lui rappeler quelle était sa vocation ici et ailleurs.
C’est grâce à cela que la France a renoncé à un système qui ne convenait ni à sa vocation, ni à son devoir, ni à sa grandeur. C’est à cause de cela, c’est d’abord à cause de vous qu’elle m’a mandaté pour renouveler ses institutions et pour l’entraîner, corps et âme, non plus vers les abîmes où elle courait, mais vers les sommets du monde […].
Il n’y a plus ici, je le proclame en son nom et je vous en donne ma parole, que des Français à part entière, des compatriotes, des concitoyens, des frères qui marchent désormais dans la vie en se tenant par la main […].
À ceux, en particulier, qui, par désespoir, ont cru devoir ouvrir le combat, je demande de revenir parmi les leurs, de prendre part librement, comme les autres, à l’expression de tous ceux qui sont ici. Je leur garantis qu’ils peuvent le faire sans risque, honorablement.
Mostaganem, merci ! Merci du fond du cœur, c’est-à-dire du cœur d’un homme qui sait qu’il porte une des plus lourdes responsabilités de l’Histoire. Merci, merci, d’avoir témoigné pour moi, en même temps que pour la France. Vive Mostaganem ! Vive l’Algérie ! Vive la République ! Vive la France ! »
Tel un écho, retentit le slogan : « Al-gé-rie-fran-çaise ! Al-gé-rie-fran-çaise ! » Le général de Gaulle reprend le micro : « Vive l’Algérie française ! »
Ce 6 juin, ordre du jour adressé « aux Forces terrestres, navales et aériennes d’Algérie » :
« Officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs, Pendant les trois magnifiques journées que j’ai passées en Algérie, je vous ai vus sous les armes et je sais l’œuvre que, sous les ordres de vos chefs, vous accomplissez avec un courage et une discipline exemplaires, pour garder l’Algérie à la France et pour la garder française. La confiance que la population manifeste à l’Armée, et dont j’ai eu tant de preuves, me donne la certitude que vos efforts au sein du pays seront récompensés par un grand succès national.
La France ici va gagner sa partie, celle de la paix, de l’unité et de la fraternité. »
Ce même 6 juin, le général de Gaulle dicte une lettre destinée au général Salan. Il le nomme délégué général du gouvernement et commandant en chef des forces en Algérie :
« Il vous appartient de maintenir, et, éventuellement, de rétablir l’exercice de l’autorité régulière. Tous ceux des membres du personnel administratif que vous ne jugerez pas à propos d’employer dans les circonstances présentes seront remis par vous sans délais à la disposition de leurs départements ministériels respectifs. Par contre, vous m’adresserez toutes demandes nécessaires pour le recomplètement des cadres administratifs.
Les Comités qui se sont spontanément constitués dans les circonstances récentes ne sauraient évidemment empiéter en aucun cas sur les attributions des autorités régulières. Par contre, ils peuvent s’employer sous votre contrôle à une œuvre d’unité de l’opinion publique et tout particulièrement aux contacts à établir entre les différentes communautés algériennes . »(5)
Le 7 juin, à La Sénia, l’aéroport oranais, au pied de la Caravelle qui doit s’envoler pour Paris, le général de Gaulle serre, « tout ému », la main du général Jouhaud : « Jouhaud, on ne va pas partir d’ici tout de même ? » Réponse : « Mais il n’en a jamais été question . »(6)
Des discours annonciateurs d’une nouvelle ère. Apparemment. Oubliés les cauchemars qui duraient depuis des années.
Oubliées les émeutes de Sétif et de Petite Kabylie, en mai 1945, les vociférations « N’katlou ennessera ! » (« Mort aux Européens ! »), « Djihad ! Djihad ! », « Tuons les infidèles ! Tuons les chrétiens ! Tuons les juifs ! », les femmes violées, éventrées, les hommes émasculés, les enfants égorgés, les fermes, les maisons forestières incendiées, à Kherrata, Amouchas, Chevreul, Périgotville, El Ouricia et Sillègue, ainsi que la répression brutale ordonnée par le général de Gaulle, alors chef du gouvernement provisoire. Bilan de quatorze jours de folie meurtrière : 102 morts et 110 blessés parmi les Européens. Chez les Arabes, entre 1165 morts, chiffre des autorités françaises, et 45 000, chiffre de la propagande algérienne.
Le Parti communiste français, qui participe alors au gouvernement provisoire, exige que soient prises « toutes les mesures nécessaires pour réprimer les agissements d’une minorité d’agitateurs ». Le 11 mai, Étienne Fajon, porte-parole du groupe communiste, s’exclame, à la tribune de l’Assemblée nationale : « Les tueries de Guelma et de Sétif sont la manifestation d’un complot fasciste qui a trouvé des agents dans les milieux nationalistes. » Le lendemain, le bureau politique du PCF publie un communiqué : « Il faut tout de suite châtier impitoyablement et rapidement les organisateurs de la révolte et les hommes de main qui ont dirigé l’émeute. » Le texte inspire un tract, distribué en Algérie, dans lequel le PCF demande de « passer par les armes les instigateurs de la révolte et les hommes de main qui ont dirigé l’émeute. Il ne s’agit pas de vengeance, ni de représailles. Il s’agit de mesures de justice. Il s’agit de mesures de sécurité pour le pays ».
Oubliée la Toussaint Rouge, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954. Trois bombes à Alger, des lignes téléphoniques coupées et des entrepôts de liège incendiés à Tizi Ouzou, la préfecture, la caserne et des dépôts d’armes mitraillés à Batna, la gendarmerie de Tigzirt attaquée, ainsi que les casernes de Boufarik, de Khenchela et de Biskra… Sept morts. Et, à l’aube, un barrage sur la RN31, étroite et sinueuse, qui relie Biskra à Arris, dans les gorges de Tighanimine. Une dizaine d’individus armés. L’un d’eux monte dans un vieil autobus Berliet GLC, qui a pilé net. « Nous sommes l’armée de libération nationale ! Que personne ne bouge ! » Puis, il ordonne à trois voyageurs de descendre : un notable musulman en gandoura, le caïd du douar M’chounèche, Hadj Sadok, ancien capitaine de l’armée française, et un jeune couple, Guy et Jeannine Monnerot, vingt-trois et vingt et un ans, des instituteurs limougeauds, en Algérie depuis moins d’un mois. Ils ont été affectés à Tifelfel, une mechta isolée entre Arris et Batna. Rafale de mitraillette. Seule Jeannine Monnerot, grièvement blessée à la hanche, va survivre. Dans la journée, au Caire, La Voix des Arabes, radio d’État égyptienne créée l’année précédente par Gamal Abdel Nasser, diffuse un communiqué triomphant : « La lutte grandiose pour la liberté, l’arabisme et l’islam a commencé en Algérie », tandis qu’une proclamation du FLN revendique « l’indépendance nationale par la restauration d’un État algérien souverain démocratique et social dans le cadre des principes islamiques ». Avec la promesse de respecter « toutes les libertés fondamentales sans distinction de races et de confessions(7) ».
Oubliées, les hordes encadrées par le FLN qui, en août 1955, armées de couteaux, de haches, de faux, de serpes, de pioches, de pelles, de gourdins et de carabines, ont déferlé sur une trentaine de villes et de villages du Constantinois. À Constantine, des grenades explosent, Abbas Allouah, neveu de Ferhat Abbas, hostile au FLN, est exécuté dans sa pharmacie. À Aïn-Abid, les émeutiers s’acharnent à coups de pelles et de pioches sur le conducteur d’une voiture et ses trois passagers. Dans une maison, ils anéantissent une famille entière : le père qu’ils amputent à la hache des bras et des jambes, sa femme qu’ils éventrent, un bébé de quatre jours, un enfant de dix ans et une grand-mère de soixante-treize ans. À 3 kilomètres de Philippeville, à El Halia, où est exploitée une mine de pyrite, ils reçoivent le renfort de mineurs arabes qui les guident vers les maisons de pieds-noirs. Dans l’une, ils tuent le mari, la femme, leurs deux filles, dont l’une est paralysée, et un bébé, qu’ils éclatent contre un mur. Dans une autre, ils s’en prennent à une mère, son garçonnet dans les bras. À la cantine de la mine, ils martyrisent à mort un ouvrier avec des piques de fourchettes(8).
Oubliée l’année 1956, marquée par un emballement du terrorisme. Un fermier européen empalé et rôti vivant, près de Lavigerie ; un ancien combattant arabe ligoté à un poteau, la chair arrachée avec des tenailles, près de Miliana ; deux familles égorgées, près de Palestro ; trois adolescents d’Aïn Beida, Jean-Paul Morio, quinze ans, Jean Almeras, quatorze ans, et Gilbert Bouquet, quinze ans, enlevés alors qu’ils se baladaient à vélo, égorgés et jetés au fond d’un puits ; six goumiers égorgés, près de Saint-Pierre-et-Paul(9) …
Oubliée la sauvagerie de Sakamody, le 25 février 1956. Dans la matinée, au col des Deux-Bassins, des individus, affublés d’uniformes militaires volés, dressent un barrage. Ils arrêtent un car de la SATAC (Société algérienne des transports automobiles en commun), une Simca Aronde, une Peugeot 403 et un camion. Les passagers du car sont arabes, ils les relâchent. Sauf un : il est sous-officier de l’armée française. Ils l’abattent. Dans la Simca Aronde : une famille de quatre touristes bretons et un de leurs amis parisiens. Avant d’égorger le mari ainsi que son ami parisien, les fellaghas violent sous ses yeux sa femme, sa belle-mère et sa fillette de sept ans, puis leur tranchent le cou. Également égorgés, les occupant de la Peugeot 403 : un architecte d’Alger et son assistant arabe.
Dans le camion, un petit patron pied-noir et ses quatre ouvriers arabes. Ces derniers supplient : « C’est un bon patron ! C’est un bon patron ! Épargnez-le ! » Une balle dans la tête : « Voilà pour les bons patrons(10) ! »
Le 22 janvier, Albert Camus avait organisé une réunion dans la grande salle du Cercle du Progrès, au deuxième étage d’un immeuble Second Empire situé en bas de la Casbah, place du Gouvernement, en face de la Grande Mosquée. « En dehors de toute politique », il avait lancé un appel à la « trêve civile ». Sa priorité : épargner les femmes, les enfants, les vieillards…
« De quoi s’agit-il ? D’obtenir que le mouvement arabe et les autorités françaises, sans avoir à entrer en contact, ni à s’engager à rien d’autre, déclarent, simultanément, que, pendant toute la durée des troubles, la population civile sera, en toute occasion, respectée et protégée. Pourquoi cette mesure ? La première raison, sur laquelle je n’insisterai pas beaucoup, est, je l’ai dit, de simple humanité. Quelles que soient les origines anciennes et profondes de la tragédie algérienne, un fait demeure : aucune cause ne justifie la mort de l’innocent (11)… »
Oubliée l’embuscade, le 18 mai 1956, dans les gorges de Palestro, qui relient la plaine de la Mitidja au flanc méridional du Djurdjura. Une section d’appelés et de rappelés du contingent, appartenant au 9ème régiment d’infanterie coloniale (RIC), 2ème bataillon, 6ème compagnie, part, à 7 h 30, de son lieu de stationnement pour une mission de reconnaissance. N’étant pas de retour à l’heure prévue, midi, des goumiers et des éléments du 9 RIC entreprennent des recherches.
Commandée par l’aspirant Hervé Artur, un sursitaire qui préparait une agrégation de philosophie, la section a été anéantie. Le lendemain, sont découverts 17 corps dévêtus, mutilés, égorgés, yeux crevés, écorchés. Deux autres cadavres sont retrouvés les jours suivants ainsi qu’un rescapé, blessé, dans une grotte. Deux disparus, le caporal-chef Louis Aurousseau, vingt-quatre ans, et le soldat de deuxième classe Raymond Serreau, vingt et un ans.
On suspectera les fusils automatiques utilisés par les fellaghas de provenir d’un camion transportant armes et munitions détourné, le 4 avril, par un aspirant pied-noir déserteur, membre du Parti communiste algérien (PCA), Henri Maillot, vingt-huit ans.
Dans son édition du 20 mai, L’Écho d’Alger va annoncer, en Une, ce « tragique guet-apens ». À côté, une autre information : « Dans la banlieue de Philippeville, dix-sept musulmans, dont six femmes et sept enfants, assassinés par les rebelles. »
La mère de Louis Aurousseau, qui habite Maurecourt, en Seine-et-Oise, recevra du Front de libération nationale une lettre manuscrite, datée du 21 mai, lui annonçant, avec cynisme, la mort de son fils :
« Madame,
Votre fils est tué. C’est pénible. Il est tombé dans une embuscade à Beni Amram (Alger) […]. Une section composée de jeunes. C’est pénible. La guerre surtout quand elle est sale, sanglante, douteuse, comme celle d’Algérie. Pénible quand on sait qu’un époux ou un fils est tombé pour une cause injuste, pour une poignée de requins.
Madame, joignez votre voix, votre effort, votre indignation à celle des autres épouses et mères. Dites et fort ce que vous pensez d’une guerre colonialiste. »
En guise de signature, un cachet rond, dessiné à la main, et représentant un croissant surmonté d’une étoile à six branches.
Le mois suivant, le FLN diffusera un tract dactylographié, en caractères majuscules et intitulé « Zabana et Ferradj seront vengés ».
Ahmed Zabana avait attaqué, le 4 novembre 1954, avec trois autres hommes, une maison de gardes forestiers à l’est d’Oran, et avait tué le responsable d’une balle dans la tête. Abdelkader Ferradj Ben Moussa avait participé, le 25 février 1956, à l’embuscade de Sakamody.
Le texte du tract sous-entend que les deux Français sont encore en vie :
« La main criminelle de la France vient de frapper un nouveau coup. Les frères Zabana et Ferradj détenus à la prison civile de Barberousse ont été guillotinés au petit matin du 19 juin 1956.
Après les massacres collectifs de nos populations civiles par l’aviation et l’artillerie françaises, après les exécutions sommaires de milliers de nos fellahs, voici que l’on s’acharne lâchement sur nos prisonniers. D’autant que les soldats de l’Armée de libération nationale traitent humainement les militaires français tombés entre leurs mains.
Puisque les Français ne comprennent que le langage de la force, l’ALN va changer de méthode. Nous répondrons au crime par le crime et à la violence par la violence. Le sang de Zabana et de Ferradj, de tous les Algériens morts pour l’Algérie sera vengé.
D’ores et déjà, les soldats Aurousseau et Serreau faits prisonniers à la suite de l’embuscade de Beni-Amrane et que nous nous apprêtions à libérer seront exécutés. Les civils français seront attaqués par nos groupes armés dans les villes et dans les campagnes. Pour un prisonnier algérien guillotiné, l’ALN exécutera 100 civils français… »
Oublié ce dimanche maudit du 30 septembre 1956, à Alger. Dernier jour des vacances scolaires. Rue Michelet, deux clientes arabes élégamment vêtues à l’européenne s’éloignent de La Cafétéria, un bar d’étudiants en face des facultés. Déflagration. Samia Lakhdari, robe bleu ciel, accompagnée de sa mère, a laissé une bombe, de la taille de deux kilos de sucre, derrière elles. Vingt minutes plus tard, une autre jeune fille, Zohra Drif, pantalon et pull moulant, paye sa consommation et sort du Milk Bar, une adresse de la rue d’Isly, à l’angle de la place Bugeaud, réputée pour ses glaces aux fruits confits recouverts de Chantilly. Sous sa table : un sac. La salle est bondée. Des familles revenant de la plage. Le carnage. Un troisième engin, apporté par une troisième jeune fille, Djamila Bouhired, robe légère en tissu imprimé, dans le hall de l’agence Air France, au rez-de-chaussée de l’immeuble Maurétania, au carrefour de l’Agha, n’a pas fonctionné. Des décombres de La Cafétéria et du Milk Bar, les secours dégagent trois morts, cinquante-neuf blessés, dont certains très grièvement, leur état nécessitant des amputations.
Nicole Guiraud a perdu un bras. Elle avait six ans. Elle rentrait d’une promenade avec son père, boulevard du Front-de-mer, quand il lui a proposé une glace au Milk Bar. Aucune table n’étant libre, ils se sont approchés du comptoir, où Raymond Guiraud a commandé un cornet que Nicole dégusterait en marchant. Il s’apprêtait à régler la note à la caisse… Nicole confiera : « Les objets fracassés volaient de tous les côtés. Le souffle fut si puissant qu’il me projeta hors de la salle […]. Des gens me piétinaient sans me voir. J’essayais de me relever, appelant “Papa ! Papa !” Je ne savais pas où il était. Le nuage opaque de fumée et de poussière jaunâtre ne me permettait de discerner que des ombres et la détonation m’avait rendue presque sourde. Les cris couvraient ma voix.
J’ai remarqué que ma robe, en tissu écossais, était imbibée de sang.
Enfin, mon père ! Il me souleva dans ses bras. Touché à la jambe, il tenait difficilement debout. Un soldat du contingent se précipita et, utilisant sa cravate, noua un garrot autour de mon bras gauche. » Sur le trajet de l’hôpital Mustapha, Nicole sombre dans un demi-coma. « Je jouais avec les doigts de ma main inerte comme avec ceux d’une poupée. Je ne souffrais pas. Sous le choc, j’étais trop sonnée pour la douleur. Mais je sentais que j’allais mourir, victime d’une de ces bombes dont parlaient les adultes(12). »
Oublié l’assassinat, le 28 décembre 1956, d’Amédée Froger, maire de Boufarik, dans la plaine de la Mitidja, entre Alger et Blida. Trois balles de 7.65, près de son domicile algérois. Son tueur, membre du FLN, Ali Amar, alias « Ali la Pointe », sera tué, dans la soirée de 8 octobre 1957, par des parachutistes du 1er REP venus l’arrêter. Il se terrait dans une cache du 5, rue des Abdérames, en haut de la Casbah.
Le 5 mai 1930, dans le cadre des commémorations du centenaire du débarquement français à Sidi-Ferruch(13), Amédée Froger avait dévoilé, à l’intersection des routes de Blida et de Koléa, un gigantesque monument, de 45 mètres de long et 9 de haut, « à la gloire de la colonisation française ». Dans son discours, il avait évoqué les prémices de la bourgade : « Alentour, c’était le marécage avec sa vase épaisse et ses eaux dormantes… C’était la solitude morne et impressionnante, c’était la brousse qui cachait le pillard, c’était la fièvre, c’était la nuit, c’était la mort. Au milieu de ce chaos, les Français vinrent construire le camp d’Erlon. » Et l’édile de saluer le courage de ces pionniers : « Dès lors, partout, du Levant au couchant, du nord au sud, la lutte fut entreprise, âpre et sévère. Pendant vingt ans, sans relâche, il fallut assainir, cultiver et construire. La mort devant tant d’audace réclamait sans cesse son tribut. Les régiments étaient décimés, les colons disparaissaient, mais de nouveaux arrivants venaient à chaque moment prendre la pioche de ceux qui tombaient. »
Dans Le Premier Homme(14), Albert Camus rendra hommage à ces « braves gens », « qui vivaient et avaient vécu sur cette terre sans laisser de trace sinon sur les dalles usées et verdies des petits cimetières de la colonisation » :
« Des foules entières étaient venues ici depuis plus d’un siècle, avaient labouré, creusé des sillons, de plus en plus profonds en certains endroits, en certains autres de plus en plus tremblés jusqu’à ce qu’une terre légère les recouvre et la région retournait alors aux végétations sauvages, et ils avaient procréé puis disparu. Et ainsi de leurs fils. Et les fils et les petits-fils de ceux-ci s’étaient trouvés sur cette terre comme lui-même s’y était trouvé, sans passé, sans morale, sans leçon, sans religion mais heureux de l’être et de l’être dans la lumière, angoissés devant la nuit et la mort. Toutes ces générations, tous ces hommes venus de tant de pays différents, sous ce ciel admirable où montait déjà l’annonce du crépuscule, avaient disparu sans laisser de traces, refermés sur eux-mêmes. »
Oubliée cette autre année de barbarie : 1957. À Alger.
3 janvier, à 18 h 30, une bombe dans un trolleybus reliant Hydra à la Grande Poste. Deux morts.
24 janvier, rue Michelet. L’Otomatic, un autre bar du quartier des facultés, où les étudiants refont le monde. Après avoir commandé des jus de fruits, Danièle Minne, militante communiste, duffle-coat gris clair, et Zahia Kerfallah, emmitouflée dans un manteau sur lequel tombent ses cheveux teints en blond, se dirigent vers les toilettes pour dames.
Danielle Minne grimpe sur la cuvette des WC et pose sur le réservoir de la chasse d’eau une petite boîte, pas plus grande qu’un paquet de cigarettes. Zahia Kerfallah, dont c’est la première « mission », fait le guet en se recoiffant dans la glace d’un lavabo. Elles ressortent tranquillement.
À 17 h 25, le chaos. À 17 h 26, sur le trottoir d’en face, à La Cafétéria, déjà cible d’un attentat le 30 septembre, une autre petite boîte explose. Elle a été glissée sous une des banquettes en moleskine par une troisième jeune fille, Zoubida Fadila. Une quatrième, Djamila Bouazza, longs cheveux noirs et grands yeux marron, a discrètement « oublié » l’engin miniaturisé qui lui a été confié sous un guéridon du Coq Hardi, à l’angle de la rue Charles-Péguy et de la rue Monge. À 17 h 28, la brasserie et sa terrasse ornée de plantes vertes ne sont plus que cris de douleur. En trois minutes : cinq morts et trente-deux blessés.
10 février. Au stade d’El Biar, un match de foot oppose le SCUEB (Sporting-Club Union d’El Biar) au RUA (Racing universitaire d’Alger).
Au stade du Ruisseau, autre rencontre entre le Gallia d’Alger et le Stade Guyotvillois. Deux machines infernales dans les tribunes. Onze morts, dont trois enfants, et cinquante blessés.
3 juin, 18 heures 30, à la sortie des bureaux. Trois bombes dans des lampadaires, à proximité d’arrêts de bus, près de la Grande Poste, de la gare de l’Agha et rue Hoche. Dix morts, dont trois enfants, et quatre-vingt-douze blessés. Trente-trois amputations.
9 juin, dimanche de Pentecôte. Dancing du Casino, sur la Corniche, à une dizaine de kilomètres à l’ouest d’Alger, près de Pointe-Pescade. La décoration est sobre : murs bleu foncé piquetés d’étoiles et baies vitrées ouvrant sur la mer. Sur la piste, des couples qui tentent d’oublier la guerre. Vers 19 heures, tout bascule. Un jeune plongeur arabe a dissimulé une bombe de 2 kilos sous la scène, où se produit un groupe de jazz dirigé par Lucien Serror, dit « Lucky Starway ». Éventré, il meurt sur le coup. Sa chanteuse a les pieds arrachés, le danseur, Paul Pérez, les jambes sectionnées. La piste est ravagée. Huit morts, quatre-vingt-un blessés, dont dix seront amputés.
Oubliée la tragédie de Melouza, le 28 mai 1957. 350 hommes du FLN s’emparent de ce douar des plateaux, à la lisière du Constantinois et de la Kabylie. À la hache, à la pioche et au couteau, ils massacrent plus de 300 villageois qui soutiendraient le MNA (Mouvement national algérien) se réclamant de Messali Hadj(15), rival du FLN.
Un tract du MNA(16) va dénoncer ce « crime cynique » commis par « des fauves assassins du FLN » :
« Peuple algérien ! Ne te méprends pas, ces hypocrites qui prétendent lutter pour toi ne sont en fait que des voleurs et des meurtriers sanglants, depuis le début de notre révolution, ils n’ont fait que piller et perpétrer partout dans notre pays des crimes qui pour être moins connus n’en sont pas moins aussi abominables que ce dernier forfait. »
Suivent des exemples : un homme de M’sila a eu la langue tranchée. Un autre, de Béni Yalla, a été énucléé et les bras coupés. À un troisième, ses bourreaux ont défoncé la tête avec un coin de fer chauffé à blanc… Odieux jusque dans le mensonge, FLN attribue la responsabilité de cet Oradour-sur-Glane algérien à l’armée française :
« Un drame affreux vient d’ensanglanter la terre algérienne déjà si éprouvée par les crimes sans nom d’un colonialisme aux abois. Toute la population mâle du douar de Melouza a été sauvagement assassinée. Si ce carnage s’inscrit normalement dans la longue liste des crimes collectifs organisés avec préméditation et exécutés froidement par l’armée française dite de “pacification”, il dépasse de beaucoup tout ce que tout esprit saint peut imaginer… »
Le sang, les hurlements de douleurs, les larmes… Du passé. En juin 1958, les paroles du général de Gaulle semblent guérir toutes les plaies. L’année précédente, en neuf mois, les 10 000 parachutistes du général Massu, à qui le président du Conseil, Guy Mollet, avait confié, le 7 janvier, les pleins pouvoirs civils et militaires, ont démantelé les filières terroristes du FLN à Alger, au prix de méthodes, arrestations massives, tortures, généralisation des fouilles et des perquisitions, qui ont soulevé des protestations. La ville est pacifiée, militairement dans les rues et, politiquement dans les cœurs. Aucune tentative d’attentat lors des grands rassemblements sur le Forum en mai et juin 1958.
Quatre ans plus tard…
Alain VINCENOT
(Livre en vente à la FNAC, Amazone, Babelio)
1. Né à Nantes le 18 février 1912, Alain Le Moyne de Sérigny, dit Alain de Sérigny, est arrivé dès son plus jeune âge en Alger, où son père, directeur à la Compagnie transatlantique, avait été nommé.
Plus tard, il dira : « J’aime cette terre comme la mienne. Et aussi cette population, qui mérite l’Oscar du patriotisme et à qui on inflige un martyre incessant. »
2. Le pavois, sur lequel reposait un homme, européen ou arabe, était porté par deux cavaliers, un Européen et un Arabe, tandis qu’au dos, deux femmes, symbolisant les deux communautés, s’appuyaient l’une contre l’autre, pleurant leurs fils morts pour la France. En 1978, à l’occasion d’une rencontre de pays africains à Alger, le gouvernement algérien fera recouvrir Le Grand Pavois d’un coffrage de ciment.
3. Fait prisonnier par les Allemands en 1940, le père du Chant des Africains, le capitaine Félix Boyer, fils d’un chef d’orchestre du Casino de la Jetée, à Nice, avait été libéré en 1941 en tant qu’ancien combattant de 1914-1918. Ayant regagné Alger, il fut chargé d’organiser la musique militaire des troupes d’Afrique du Nord. Reprenant les paroles d’une marche de 1915 de la Division marocaine, Les Marocains, il créa, en 1943, Les Africains, chant de guerre de l’armée d’Afrique qu’il dédia au général Joseph Goislard de Monsabert, futur Compagnon de la Libération. Pendant la guerre d’Algérie, pieds-noirs et partisans de l’Algérie française en firent leur hymne. Après 1962, le considérant comme « séditieux », le général de Gaulle bannit Le Chant des Africains des musiques et fanfares militaires françaises. En janvier 1967, il refusa même qu’il fût joué aux obsèques du maréchal Alphonse Juin, pied-noir, héros de la campagne d’Italie en 1944. Il fallut attendre août 1969, le général de Gaulle ayant démissionné le soir même de sa défaite au référendum du 27 avril, pour que l’interdiction fût levée par Henri Duvillard, ministre des Anciens combattants et Victimes de guerres.
4. José Castano, Les Larmes de la passion, Société héraultaise d’édition, 1982.
5. Six mois plus tard, le 12 décembre, le général de Gaulle éloignera d’Algérie le général Salan vers un poste honorifique à Paris : inspecteur général de la Défense.
6. Edmond Jouhaud, Ô mon pays perdu, Fayard, 1969.
7. En 1963, la promesse tombera dans une oubliette. L’article 4 de la Constitution de l’État algérien stipulera : « L’islam est la religion de l’État. » Et l’article 23 : « Le Front de libération nationale est le parti unique d’avant-garde en Algérie. » Le 28 février 2006, le président Abdelaziz Bouteflika signera une ordonnance réglementant « les conditions et les règles d’exercice des cultes autres que musulmans ». Dans son article 11, celle-ci précisera : « Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 000 DA à 1 000 000 DA quiconque :
1° incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement, d’éducation, de santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout moyen financier.
2° fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman. »
Aussitôt, une vingtaine d’étudiants africains, participant à une rencontre biblique à Tizi Ouzou, seront expulsés, de même qu’en novembre 2007, de jeunes Brésiliens, invités par l’archevêque d’Alger, Mgr Henri Tessier. En décembre, un directeur d’école et un instituteur algériens seront radiés de l’Éducation nationale pour « prosélytisme ».
Le 27 janvier 2008, trois protestants seront traduits en justice pour avoir « proféré des injures contre la religion et la personne du prophète ».
Le 30, ce sera un prêtre catholique d’Oran. Son crime : avoir prié, le lendemain de Noël, avec un groupe d’immigrés camerounais catholiques.
Le 29 mars 2008, les gendarmes arrêteront, dans le bus d’Oran, une jeune chrétienne de Tiaret, Habiba Kouider, trente-sept ans, éducatrice dans une crèche. Dans son sac : des Bibles et des Évangiles. Accusée de « pratique d’un culte non musulman sans autorisation ». Le procureur lui proposera un marché : « Tu réintègres l’islam, et je classe le dossier ; si tu persistes dans le péché, tu subiras les foudres de la justice ! »
Le 12 août 2010, en Kabylie, deux ouvriers, Hocine Hocini, quarante-quatre ans, et Salem Fellak, trente-quatre ans, seront inculpés pour « atteinte et offense aux préceptes de l’islam ». La police les a surpris, sur un chantier, « en flagrant délit de consommation de denrées alimentaires ». Ils rompaient d’un casse-croûte le jeûne du ramadan. Au tribunal, Hocine Hocini objectera qu’il n’est pas musulman, mais chrétien. Le procureur lui conseillera de « quitter ce pays qui est une terre d’islam ».
8. Dès qu’il est informé de l’ampleur des massacres (171 victimes), Jacques Soustelle, alors gouverneur général d’Algérie, se rend sur les lieux. Quelques mois plus tard, dans Aimée et souffrante Algérie, livre publié en 1956, aux éditions Plon, il racontera ce qu’il a vu : « Alignés sur les lits, dans des appartements dévastés, les morts, égorgés et mutilés (dont une fillette de quatre jours) offraient le spectacle de leurs plaies affreuses. Le sang avait giclé partout, maculant ces humbles intérieurs, les photos pendues aux murs, les meubles provinciaux, toutes les pauvres richesses de ces colons sans fortune. À l’hôpital de Constantine, des femmes, des garçonnets, des fillettes de quelques années gémissaient dans leur fièvre et leurs cauchemars, des doigts sectionnés, la gorge à moitié tranchée… » Après son déplacement à El Halia, Jacques Soustelle, ethnologue, député gaulliste du Rhône, jusque-là partisan du dialogue, rompt tous pourparlers avec des interlocuteurs cautionnant pareille sauvagerie. Il ordonne la plus grande fermeté dans la répression. Un millier d’Arabes sont tués par l’armée et des milices de pieds-noirs formées dans la douleur.
9. Pierre Montagnon, Histoire de l’Algérie, Pygmalion, 1998.
10. André Rossfelder, Le Onzième Commandement, Gallimard, 2000.
11. Albert Camus, Essais, Gallimard, 1972.
12. Alain Vincenot, Pieds-noirs, les bernés de l’Histoire, L’Archipel, 2014.
13. Le 14 juin 1830, trente ans avant le rattachement de la Savoie à la France, l’armée du roi Charles X débarquait, au lever du jour, sur la presqu’île de Sidi-Ferruch. Dans la soirée, la 1ère division d’infanterie, sous les ordres du général baron Pierre Berthezène, épaulée par la division Loverdo, contrôlait la place. Le 5 juillet, le dey d’Alger, représentant du sultan ottoman qui régnait sur le Maghreb, se pliait à l’acte de capitulation transmis par le général Louis Auguste Victor de Ghaisne, comte de Bourmont, ministre de la Guerre, Commandant en chef de l’expédition. Le texte prévoyait : « L’exercice de la religion mahométane restera libre ; la liberté des habitants de toutes les classes, leur religion, leur commerce, leur industrie, ne recevront aucune atteinte ; leurs femmes seront respectées. Le général en chef en prend l’engagement sur l’honneur. » Pour Charles X, il s’agissait de laver un affront vieux de trois ans. Le 29 avril 1827, veille de l’Aïd el Seghir, fin du ramadan, le dey d’Alger, avait, au cours d’une audience rendue houleuse par des créances impayées, donné un coup de chasse mouche au consul de France, Pierre Duval. Ce n’était pas la seule raison.
Les pays européens voulaient mettre un terme à la piraterie barbaresque qui, depuis des siècles, infestait la Méditerranée, aux captures de chrétiens vendus comme esclaves sur les marchés d’Alger et aux cruels supplices dont Arabes et Ottomans appréciaient le spectacle. En mai 1830, 675 navires, avec à leur bord plus de 36 000 soldats, avaient levé l’ancre à Marseille et Toulon. Avant l’embarquement, le général en chef leur avait transmis son premier ordre du jour : « La cause de la France est celle de l’humanité. Montrez-vous dignes de votre belle mission. Qu’aucun excès ne ternisse l’éclat de vos exploits ; terribles dans le combat, soyez justes et humains après la victoire. »
14. Albert Camus, Le Premier homme, Gallimard, 1994. Le 4 janvier 1960, quand, à hauteur de Villeblevin, un village de l’Yonne, la Facel Vega du neveu de l’éditeur Gaston Gallimard, Michel Gallimard, directeur de la collection « Bibliothèque de La Pléiade », s’est encastrée, à 13 h 55, sur un des platanes bordant la RN6, entre Champigny-sur-Yonne et Villeneuve-la-Guyard, tuant Albert Camus sur le coup, dans une sacoche se trouvaient les 144 pages du Premier homme. Inachevé, le manuscrit ne sera publié que trente-quatre ans plus tard.
15. Considéré comme le père du nationalisme algérien, Ahmed Messali, dit « Messali Hadj », revendiquait dès 1927 l’indépendance de l’Algérie, le retrait des troupes françaises, la constitution d’une armée nationale et la confiscation des grandes propriétés agricoles. Né en 1898, dans une famille modeste de Tlemcen, il habitait Paris, enchaînant les petits boulots. Sa femme, une Française, Émilie Busquant, fille d’un mineur syndicaliste lorrain, vendeuse au rayon « parfumerie et objets pour dames » des Magasins réunis, aurait, en 1934, dans leur logement de la rue du Repos, dans le XXème arrondissement, confectionné le premier drapeau algérien, vert, blanc et rouge. En 1937, son mouvement, l’Étoile nord-africaine (ENA), essentiellement implanté en métropole parmi les travailleurs algériens, ayant été dissous par le gouvernement, il avait fondé le Parti du peuple algérien (PPA) qu’il a implanté en Algérie. Accusé de reconstitution de ligue dissoute, il a été arrêté et son mouvement interdit. Jusqu’à sa mort, en 1974, à Gouvieux, près de Chantilly, dans l’Oise, il n’allait plus connaître que la prison, la résidence surveillée et l’exil. Le PPA se transformera en Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), puis en Mouvement national algérien (MNA).
Une guerre féroce opposera FLN et MNA, faisant près de 4000 morts en métropole entre le 1er janvier 1956 et le 23 janvier 1962. Et le FLN éradiquera le MNA, s’érigeant, après l’indépendance, en parti unique, source d’autoritarisme, de bureaucratie, d’incompétence, d’affairisme et de corruption.
16. http://fondationmessali.org/
|
MON PANTHÉON DE L'ALGÉRIE FRANÇAISE
DE M. Roger BRASIER
Créateur du Musée de l'Algérie Française
|
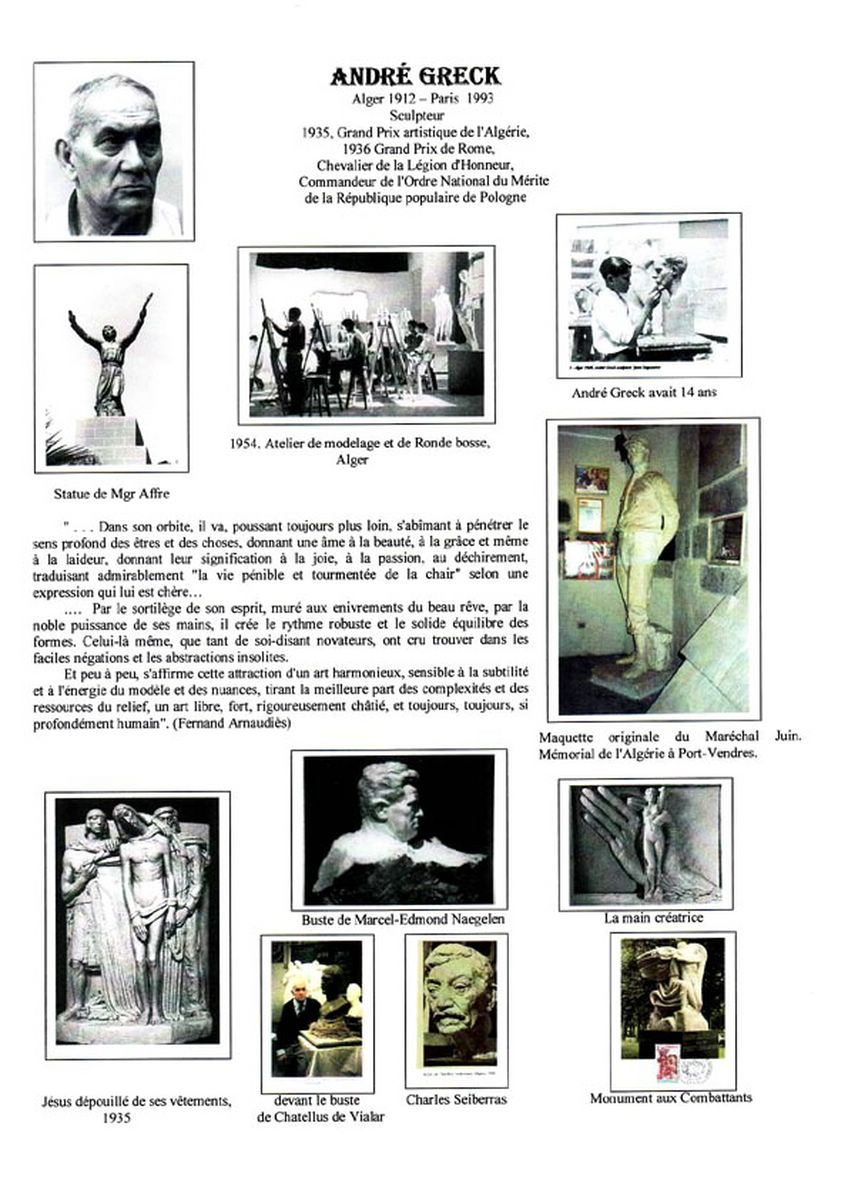 A SUIVRE
A SUIVRE |
|
| PARTITIONS
De Jacques Grieu
|
Sans demander son reste, on part souvent à tort,
Alors que si l’on reste, on a un meilleur sort.
Quand on part, on vous dit que « c’est mourir un peu »
Est-ce mourir beaucoup quand c’est partir à deux ?
Quand on aime, on part peu, mais c’est partir quand même;
Et si on part à deux, à quand, l’onction extrême ?
On part toujours perdant, sur la ligne, au départ,
Si l’on n’a pas d’espoir ou peur d’être en retard.
Le mourant ne part pas : il finit quelque part.
C’est de l’éternité que Dieu, pour le temps, part.
On a fait la part belle à ceux qui ont prié;
Heureux celui qui part avant que d’arriver …
Le monde est un gâteau, croustillant, coloré ;
Prenons-en notre part sans scrupules ni regrets ;
Sa part qu’on cueille au vol, comme un cadeau tentant ,
Se croque avec l’élan des cœurs d’enfants contents.
Chaque part de bonheur est un pain qu’on partage,
Et rend l’instant plus doux que l’or d’un héritage.
Si l’on voit l’avenir à partir du passé,
Alors de toutes parts, on sera agressé.
On pare au plus pressé pour prévoir l’avenir;
Il faut partir à temps, sinon, il faut courir.
On a sa quote-part des ennuis de la terre,
Sans trouver nulle part où pleurer sa misère.
Il y a parts et par et aussi parts sociales.
Encore le « pare-choc » ou le gilet « pare-balles ».
Le golfeur « fait le par » quand sa balle part très bien.
D’autre part, à la boxe, on « pare » avec entrain.
De part en part la pluie traverse le cycliste
Qui fait la part des choses sans qu’il en soit trop triste.
De la plume du paon, se pare le vain fat,
Qui voudra faire part de faits qui nous épatent.
Il se pare de titres et les fait ronfler fort,
Et en mauvaise part, il prend tous les rapports.
Mis à part les crédules (qui feront bande à part),
Il fatigue, il ennuie ; dites-lui donc de ma part …
Jacques Grieu
|
| |
LA SOUMISSION, ENCORE..
par M. Robert Charles PUIG.
|
Un climat de retenu, de frustration, une stratégie de soumission, un enfoncement dans le délit contre l'honneur et la vérité au profit de la censure comme les pages d'un journal où des faits sont interdits, une mise à l'index du peuple pour cacher la manigance d'élus poltrons, l'arriération d'individus qui ne savent plus gérer le pays mais préfèrent ramper sur le tapis de prière algérien.
Souvenons-nous le temps qu'il a fallu attendre des mois, pour apprendre qu'Alger refusait de reprendre les OQTF que nous leur envoyons ! C'est parce que l'un d’eux est revenu 14 fois d'Alger que nous avons appris combien le pays ne gérait pas ses décisions face à Abdelaziz Tebboune, le dictateur d'Alger...
Puis il y a eu Boualem Sansal, franco-algérien retournant en Algérie. Il est arrêté et emprisonné. Il vient d'être condamné à 5 ans de prison sans preuve convaincante !
Aujourd'hui en sus, nous apprenons qu’un journaliste français encore, Christophe Gleizes qui depuis un an est sous contrôle judiciaire en Algérie, vient d'être condamné à 7 ans d'emprisonnement ! Comme une vengeance d'Alger contre Paris !
Quelle est cette France sous la baguette inquiétante de l'Elysée ? Bien entendu nous souhaitons la libération de Boualem Sansal, mais faut-il à ce point en perdre notre honneur ? Nous attendons un geste le 5 juillet, date de la fête de l'indépendance algérienne. Il faut se souvenir que le 5 juillet 1962 ce fut avant tout le massacre des oranais par le douk-douk FLN. Ce sera donc une fête du sang, celle du Dieu du mal !
En 1962, le pays gaulliste n'avait pas réagi. Il avait laissé faire ces assassinats où des civils européens, plus de 3 000, furent torturés, massacrés et portés disparus pour un grand nombre sans que l'armée française n'intervienne, alors qu'elle était encore dans les murs d'Oran.
Aujourd'hui nous continuons à baiser la tête, à nous incliner sous les menaces d'Alger comme si notre rôle était celui de l'esclave du temps de Barberousse, celui qu'Alger peut mettre à la bouche du fameux "Baba Merzouk", le canon protégeant les turcs d'Alger, pour affirmer sa puissance et notre faiblesse.
J'ai honte de vivre cela.
Robert Charles Puig / 01/07/2025
|
|
Actualités, Nos amis Pied-Noirs
|
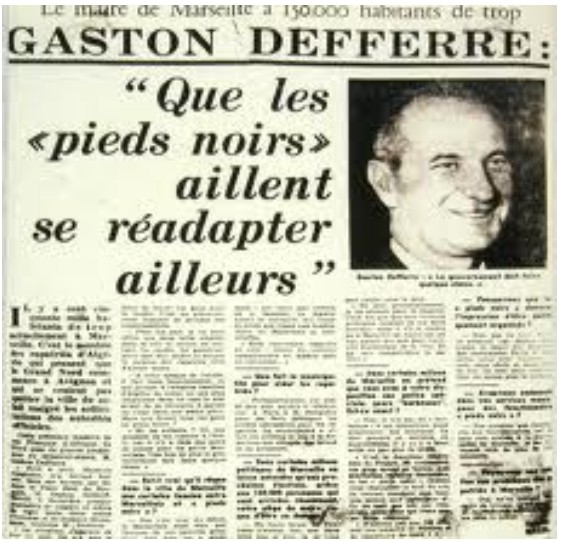
José Castano, notre mémoire
Merci à l’ami José Castano de nous rappeler quelques vérités sur l’expatriation de nos frères d’Algérie.
En ces temps qui marquent les soixante ans de l’exode, il est bon de se rappeler les circonstances du départ précipitées, en suivant ce lien,
Mais, José nous rappelle aussi les circonstances de l’accueil reçu à l’arrivée sur le sol de la Mère Patrie.
» … ET ILS NOUS ONT ACCUEILLIS
AVEC DES CRIS DE HAINE
« Des années d’amour ont été effacées par la haine
d’une seule minute » (Edgar Allan Poe)

… Peu à peu, le soleil, pareil à une meule incandescente, émergea des flots. Tout autour du navire, les eaux soyeuses tournoyaient lentement, en vastes cercles concentriques qui s’évanouissaient à la limite extrême de l’horizon. Un haut-parleur annonça bientôt que l’on apercevait les côtes de France. Mal réveillés, ils montèrent tous sur le pont. Sous le ciel gris, la côte paraissait noire. Des oiseaux de mer passaient au-dessus du bateau en poussant leurs cris aigus.
 Ils étaient tous là, serrés les uns contre les autres, appuyés à la rambarde. Le paradis dont ils avaient tellement rêvé, enfants, à travers les pages d’un livre de géographie approchait lentement et déjà ils n’en voulaient plus. Ils rêvaient à un autre paradis perdu : L’Algérie ; c’est à elle qu’ils pensaient tous à présent. Ils n’étaient pas les frères douloureux qui arrivaient pour faire panser leurs blessures, mais des étrangers. En eux remontaient des aigreurs. Le regret de ce qui n’était plus suffisait à faire revivre ce qui aurait dû être… Ils étaient tous là, serrés les uns contre les autres, appuyés à la rambarde. Le paradis dont ils avaient tellement rêvé, enfants, à travers les pages d’un livre de géographie approchait lentement et déjà ils n’en voulaient plus. Ils rêvaient à un autre paradis perdu : L’Algérie ; c’est à elle qu’ils pensaient tous à présent. Ils n’étaient pas les frères douloureux qui arrivaient pour faire panser leurs blessures, mais des étrangers. En eux remontaient des aigreurs. Le regret de ce qui n’était plus suffisait à faire revivre ce qui aurait dû être…
Ce qu’ils avaient laissé « là-bas », c’était avant tout cette part d’insouciance qui les faisait chanter et rire. En foulant pour la première fois le sol de la France, ils apprendraient brutalement la signification du mot « demain » dans une situation que personne n’avait pu prévoir et le qualificatif de « Rapatrié » serait apposé à chacun d’eux. C’était une manière comme une autre de les déposséder à tout jamais de ce sol qui les avait vus naître, de leur dire que jamais il n’avait été leur patrie. Et l’angoisse les étreignait car déjà la presse progressiste et bon nombre de politiques les avaient condamnés. C’est ainsi que « l’Humanité » du 6 Janvier 1962 parlait d’eux en ces termes « Ils ont une drôle d’allure ces passagers en provenance d’Algérie » et « La Croix » du 24 Février recommandait au sujet des jeunes rapatriés qu’il fallait « éviter de laisser notre jeunesse se contaminer au contact de garçons qui ont pris l’habitude de la violence poussée jusqu’au crime ».
Robert Boulin, secrétaire d’Etat aux rapatriés, avait déclaré le 30 Mai 1962 au Conseil des Ministres : « Ce sont des vacanciers. Il n’y a pas d’exode, contrairement à ce que dit la presse. Ce sont bien des vacanciers, jusqu’à ce que la preuve du contraire soit apportée »… tandis qu’au nom du Parti communiste, M. Grenier s’indignait de la réquisition d’une colonie de vacances pour les « saisonniers »… Le 5 Juin, par l’entremise de « l’Humanité », François Billoux, député communiste, conseillait au Gouvernement de loger les rapatriés « dans les châteaux de l’OAS », ajoutant : « Ne laissons pas les repliés d’Algérie devenir une réserve de fascisme ».
Lorsque ces nouveaux « vacanciers » débarquèrent, ils découvrirent aussitôt que le malheur ce n’était pas propre, pas beau à voir. Partout de lamentables cargaisons humaines où les matelas mal ficelés côtoyaient les cages à canaris. Des hommes, des femmes, des vieillards, dépenaillés, hirsutes, démoralisés, souffrants, la marche pesante, le découragement dans l’âme, tandis que les mamans étaient tiraillées en tous sens par leurs enfants qui pleuraient et poussaient des cris. On ne voyait plus que la morne lassitude des silhouettes courbées sous des charges hâtivement nouées qui donnaient l’impression d’avoir emporté, là, la part la plus précieuse du foyer. Mais la part la plus précieuse, en réalité, nul n’avait pu l’emporter avec soi, parce qu’elle dormait dans l’ordonnance des murs et dans la lumière qui baignait les paysages où s’étaient allumés les premiers émerveillements de l’enfance… on n’enferme pas les souvenirs, le soleil et la mer dans une valise !…
Certains arrivaient dans un état de dénuement physique et matériel invraisemblable… Misère vestimentaire, délabrement… Il s’élevait de ce troupeau une rumeur faite non de cris mais de sanglots, de paroles qui revenaient en leitmotiv : faim, soif, dormir et surtout, Misère… Misère…
Où étaient donc ces riches colons ? Ces exploiteurs de la misère arabe ? Ils étaient seuls désormais et ils n’en pouvaient plus.
Pour les accueillir, point de « cellules d’accueil »… mais un imposant « service d’ordre » qui avait pour mission essentielle de procéder à un « filtrage » des éventuels suspects (entendez-par là, les membres de l’OAS). Des chefs de famille qui avaient eu le malheur de voir leurs noms mentionnés sur les fiches de police étaient, sans la moindre humanité, arrachés à leurs épouses et à leurs enfants, déjà singulièrement éprouvés par ce cruel destin et, jugés aussitôt tels des criminels, allaient remplir les prisons françaises encore imprégnées de l’odeur des tortionnaires du FLN que l’on venait, en hâte, de gracier. Quelle affliction que de se voir ainsi arraché aux siens à un moment où on a tant besoin de la présence d’un père et d’un époux. Quel cruel spectacle que celui-là ! Ils avaient tous besoin de l’Armée du Salut… on leur envoya les R.G, les C.R.S et les gardes mobiles… (1)
Les pieds nus dans des babouches, un homme ouvrait un pardessus à chevrons : il n’avait que son pyjama dessous. Il se tordait les mains et racontait, la voix brisée par l’émotion, que sa fille avait été enlevée, le matin même du départ. Comme il avait perdu son dentier, on comprenait mal son récit et l’on entendait :
· Elle criait : « Me laisse pas, papa… me laisse pas ! »
Mais qu’est-ce que je pouvais faire ? Ils me tenaient. Ils me tenaient, je vous dis… criait le pauvre homme en éclatant en sanglots
« Mon Dieu, mon Dieu », répétait une femme en se signant.
A quelques pas, une dame effondrée racontait au personnel chargé de l’orientation des réfugiés :
– Moi, je ne voulais pas partir, Monsieur. Je savais bien ce que ça serait. Je me disais : « Il n’y a qu’à attendre ». Je ne sortais plus. Juste pour les commissions. Je croyais que ça allait se calmer. Puis les deux locataires du premier sont partis. On n’est plus restées qu’avec Madame Ramon, dans la maison. Le soir, on mangeait l’une chez l’autre, pour se tenir compagnie, pour parler. Et puis, l’autre matin, quand je suis revenue du marché, elle était dans l’escalier, allongée, plein de sang partout, avec sa tête en arrière qui tenait plus que par le chignon. On avait tout chamboulé chez elle. Qu’est-ce que je vais devenir Monsieur… qu’est-ce que je vais devenir ?…
C’était la litanie de la débâcle. Tous avaient un viol à raconter, un pillage, un crime, un enlèvement dont ils avaient été témoins.
· Et l’armée ? demanda un journaliste effaré par toutes ces horreurs.
· Ah ouah ! Quelle armée m’sieur ? répondit un homme dont le visage était blême.
· L’armée française !
· Il n’y a plus d’armée française, m’sieur. L’autre jour, auprès de la grande poste, ils étaient dans les étages en train de frapper un Européen.
· Qui ils ?
· Les Arabes ! On entendait hurler. Passe une jeep avec un lieutenant français et trois soldats. Je fais signe. Ils s’arrêtent. « Vous n’entendez pas ? », je dis. « Non. Je n’entends pas, qu’il me répond le lieutenant ! Et même si j’entendais, ce serait pareil. J’ai pas d’ordre ! »
Ma parole ! Je lui ai fait un bras d’honneur. Si c’est pas malheureux. Et ça s’appelle la France, m’sieur ?
A cet instant un homme qui écoutait la conversation s’adressa au journaliste :
– Monsieur, le drame des Français d’Algérie rejoindra dans l’histoire celui des juifs chassés et persécutés sous le nazisme. Ce sera la même honte.
Au même moment, ce 18 Juillet 1962, dans l’indifférence générale, se tenait le Conseil des Ministres. En parlant des Pieds-Noirs (vocable que bon nombre de Français d’Algérie entendaient pour la première fois), De Gaulle déclara : « Il faut les obliger à se disperser sur l’ensemble du territoire », ce qui permit à Louis Joxe, son éminence grise, de renchérir : « Les Pieds-Noirs vont inoculer le fascisme en France. Dans beaucoup de cas, il n’est pas souhaitable qu’ils retournent en Algérie ou qu’ils s’installent en France où ils seraient une mauvaise graine. Il vaudrait mieux qu’ils aillent en Argentine ou au Brésil ».
Et des jours durant, on rencontrait dans tout le Sud de la France, notamment dans les zones maritimes, des masses de Pieds-Noirs hébétés, prostrés, embarrassés dans les enfants, les valises et les formalités, assommés de douleur et de fatigue, amers face à l’indifférence et au mépris, se perdant dans des rues qu’ils ne connaissaient pas, photographiés comme des bêtes venues d’un autre âge, avec leur visage mort, ravagé par les larmes et la douleur.
Dans les ports, c’était la désolation. Les cadres de déménagement de ces « richards », hâtivement construits en bois, étaient volontairement plongés dans la mer par les dockers de la CGT et autres gauchistes. Ceux qui avaient eu la chance d’être épargnés, étaient éventrés. Leur contenu gisait, épars, sur le sol faisant le « bonheur » des rôdeurs à l’affût de toutes ces richesses…
A Marseille, un homme dont la haine pour les Français d’Algérie n’avait aucune retenue, le socialiste Gaston Defferre, allait se charger personnellement de leur accueil. Sur les bancs de l’Assemblée Nationale, il alla jusqu’à prononcer ces mots infâmes : « Il faut les pendre, les fusiller, les rejeter à la mer… », ajoutant qu’il ne les recevrait jamais dans sa cité. Le 26 Juillet 1962, lors d’une interview réalisée par Camille Gilles pour « Paris-presse», à la question de ce dernier : « Dans certains milieux de Marseille, on prétend que vous avez à votre disposition une police spéciale, genre « barbouzes », est-ce exact ? » Réponse : « Ce sont simplement des militants… Ils sont groupés en sections et sous-sections. Il y en a à Marseille un peu plus de 15.000 (payés par le contribuable ou par le PS ?). C’est la deuxième fédération de France et, croyez-moi, ces gens savent se battre. Aux prochaines élections et réunions électorales, si les « Pieds-Noirs » veulent nous chatouiller le bout du nez, ils verront comment mes hommes savent se châtaigner… Ce ne sont pas eux qui viendront, mais nous qui iront casser leurs réunions. N’oubliez pas aussi que j’ai avec moi la majorité des dockers et des chauffeurs de taxis ». Et à une nouvelle question du journaliste : «Voyez-vous une solution aux problèmes des rapatriés de Marseille ? » « Oui, répondra sans vergogne Defferre, qu’ils quittent Marseille en vitesse ; qu’ils essaient de se réadapter ailleurs et tout ira pour le mieux ».
Ainsi, tenaillés entre communistes et socialistes qui leur vouaient, à l’instar de leur « maître à penser », une haine sans borne et qui, de surcroît, détenaient les rouages de la vie politique, sociale, administrative… et mafieuse, les Français d’Algérie installés à Marseille allaient connaître durant les premiers mois de leur exil, des difficultés à nulles autres pareilles…
« Se réadapter ailleurs », c’est ce que les « Rapatriés » allaient tenter de faire en dépit des difficultés qui s’amoncelaient : précarité, chômage, logement, scolarité, santé… Cependant, dans tous les coins de France où ils étaient arrivés en masse, on en profitait pour faire monter les prix ; chambres d’hôtels et meublés affichaient complet et la nuit, beaucoup de ces malheureux se retrouvaient dans les halls de gare, remâchant un peu plus leur rancune. Les logements se faisaient rares et étaient proposés à des tarifs exorbitants, les établissements scolaires n’acceptaient plus, par manque de place, les enfants… A la vue de tant de misère, ils ne cessaient de se répéter : « Est-ce cela la France ? Cette France que nous avons tant aimée ? »…
Mais la France, ce pays merveilleux des droits de l’homme, cette terre d’asile de tous les réfugiés du monde, manquait, pour la première fois de son histoire, de générosité. Elle accueillait ces pauvres gens à contrecœur, témoignant autant d’indifférence que d’hostilité. Combien de ces « rapatriés » allaient découvrir des mots nouveaux tels que « dépression nerveuse », « stress »… termes dont ils ignoraient le sens, eux, transfuges d’un pays de soleil où tout était prétexte à la fête… Combien de morts prématurés cette communauté compta la première année de son rapatriement en France !…
Face à ce désastre humain, le gouvernement demeura de marbre. Seuls quelques élus locaux réagiront humainement avec des moyens limités et quand Alain Peyrefitte, pris de remords, exposera au « général Président », le 22 Octobre 1962, « le spectacle de ces rapatriés hagards, de ces enfants dont les yeux reflètent encore l’épouvante des violences auxquelles ils ont assisté, de ces vieilles personnes qui ont perdu leurs repères, de ces harkis agglomérés sous des tentes, qui restent hébétés… », De Gaulle répondra sèchement avec ce cynisme qu’on lui connaissait : « N’essayez pas de m’apitoyer ! »… On était bien loin du « C’est beau, c’est grand, c’est généreux la France ! »…
Et c’est ainsi que, des années durant, les Français d’Algérie promèneront leur mélancolie à travers cette France égoïste et indifférente qui, sans se soucier des martyrs, aura laissé égorger les vaincus…
1. : C’est cette mésaventure qui mena directement le père de l’auteur de ces lignes à la prison de Fresnes.
-o-o-o-o-o-o-o-
|
|
|
Cimetières d'Afrique du Nord
Envoyé par M. Jacques Villard
|
|
Exigences locatives de l’Algérie...
Envoyé par Regis Sanchez
|
|
Bernard Lugan
Le gouvernement algérien ose demander à la France une réévaluation de la valeur locative de ses emprises diplomatiques en Algérie et le remboursement de loyers prétendument « sous-payés », alors qu’il s’agit de bâtiments construits par la France avec l’argent des Français sur des terrains qui appartenaient à la France avant 1962…
Sans parler des centaines de milliers d’immeubles, d’appartements, de villas, de fermes, de commerces, d’entreprises, de véhicules et de machines volés aux Français lors de l’indépendance de 1962.
Sans parler non plus de l’héritage exceptionnel que la France légua à l’Algérie en 1962, à savoir 54.000 kilomètres de routes et pistes (80.000 avec les pistes sahariennes), 31 routes nationales dont près de 9.000 kilomètres étaient goudronnés, 4.300 km de voies ferrées, 4 ports équipés aux normes internationales, 23 ports aménagés (dont 10 accessibles aux grands cargos et dont 5 qui pouvaient être desservis par des paquebots), 34 phares maritimes, une douzaine d’aérodromes principaux, des centaines d’ouvrages d’art (ponts, tunnels, viaducs, barrages etc.), des milliers de bâtiments administratifs, de casernes, de bâtiments officiels, 31 centrales hydroélectriques ou thermiques, une centaine d’industries importantes dans les secteurs de la construction, de la métallurgie, de la cimenterie etc., des milliers d’écoles, d’instituts de formations, de lycées, d’universités avec 800.000 enfants scolarisés dans 17.000 classes (soit autant d’instituteurs, dont deux-tiers de Français), un hôpital universitaire de 2.000 lits à Alger, trois grands hôpitaux de chefs-lieux à Alger, Oran et Constantine, 14 hôpitaux spécialisés et 112 hôpitaux polyvalents, soit le chiffre exceptionnel d’un lit pour 300 habitants.
Sans parler d’une agriculture florissante laissée en jachère après l’indépendance, à telle enseigne qu’aujourd’hui l’Algérie doit importer du concentré de tomates, des pois chiches et de la semoule pour le couscous…
Tout ce que la France légua à l’Algérie avait été construit à partir du néant, dans un pays qui n’avait jamais existé et dont même son nom lui fut donné par la France.
Tout avait été payé par les impôts des Français. En 1959, toutes dépenses confondues, l’Algérie engloutissait 20 % du budget de l’Etat français, soit davantage que les budgets additionnés de l’Education nationale, des Travaux publics, des Transports, de la Reconstruction et du Logement, de l’Industrie et du Commerce !
La seule réponse à l’arrogance des dirigeants algériens serait donc de leur présenter la note…
Bernard Lugan
lundi 18 août 2025
Source : https://nouveaupresent.fr/2025/08/11/cest-a-lalgerie-de-rembourser-la-france/
|
|
SI L’ALGERIE M’ETAIT CONTEE.
VERITAS N° 71, mars 2003 PAR Pierre Cattin
|
|
OU LES FAUSSAIRES DE LA PRESSE
" Dès la prise d'Alger en juillet 1830, la ville est vidée de ses habitants musulmans qui s'enfuient en Tunisie, au Maroc, en Syrie. La France a promis de respecter la religion musulmane... Elle trahit immédiatement sa promesse... » Quel auteur étranger, animé par une haine et un parti pris surprenants, peut ainsi calomnier la France, de façon aussi grossière, car tous les historiens de bonne foi savent qu'il s'agit là de contrevérités primaires ?
Hélas, il s'agit de L’EXPRESS, dans son numéro du 14 mars 2002 (commenté dans LA LETTRE DE VERITAS de mai 2002). Ce journal, tourmenté dès sa fondation par une haine viscérale pour tout Français né en Afrique du Nord, n'a jamais rougi de s'abaisser aux pires sottises, battant même, parfois, «L'HUMANITE» dans ce domaine !
On imagine l'ironie, pleine de mépris, que doivent éprouver les journalistes algériens devant cette attitude rampante, dégradante, d'une certaine presse française qui dit aux étrangers : «Faites comme nous, allez-y, salissez la mémoire de nos propres ancêtres, prenez exemple sur nous... »
Cela va parfois tellement loin dans l'auto dénigrement que I'on se demande si le pire ennemi de la France pourrait encore en rajouter ! Renouvelons encore une fois - comme le fait Alain Griotteray dans LE LIVRE BLANC DE L'ARMEE FRANCAISE - nos craintes devant la haine ainsi développée et entretenue auprès des jeunes Algériens nés en France contre ce pays d'adoption dont on maudit plusieurs générations d'ancêtres dans les colonnes même des journaux français !
Après les insultes au drapeau français, allons-nous voir, bientôt, l'Armée française conspuée lors du prochain défilé du 14 juillet ?
Dès la capitulation du Dey d'Alger – ce représentant factice de I'Empire ottoman dont la succession se faisait, une fois sur deux, par l'égorgement du prédécesseur depuis plus de deux cents ans - le Maréchal de Bourmont prit I'engagement historique que reproduisaient tous les manuels scolaires d'avant 1962, et qui, maintenant, est soigneusement occulté :
" L'exercice de la religion musulmane sera libre. La liberté des habitants de toutes classes, leur religion, leurs propriétés, leurs commerces et leurs industries, ne recevront aucune atteinte.
Les femmes seront respectées. Le Général en chef Yussuf en chef en prend I'engagement, sur I'honneur. »
Une convention signée avec un envoyé du Dey au quartier Général français, accompagné de l'interprète Louis de Bracevitz qui, trente deux ans auparavant avait participé à la campagne d'Egypte, prévoyait que le haut fonctionnaire turc serait libre de choisir sa résidence, avec son harem, ses serviteurs et ses richesses. Certaines calomnies, reprises par Jules Roy, racontaient que le Maréchal de Bourmont avait dérobé le trésor du Dey, envoyé en France, « caché dans un cercueil, ceci sans aucune preuve...
En réalité, le fils du Maréchal avait été tué dans la bataille et le cercueil en question ramenait simplement son corps en France... Dans ces diffamations indignes, on retrouve toujours le plaisir insigne de salir un Français, de la part d'autres Français... Est-ce en train de devenir une passion nationale ?
Le 6 juillet, le Maréchal de Bourmont dicte l'ordre du jour à I'Armée française : " Vingt jours ont suffi pour la destruction d'une entreprise dont l'existence tyrannisait l'Europe. La reconnaissance de toutes les nations civilisées d'Europe sera, pour I'Armée d'expédition, le fruit le plus précieux de sa victoire (Gabriel Esquer - La prise d'Alger – Edition Champion 1923). Et cet auteur continue ainsi : " Certains indigènes étaient impassibles et comme indifférents, d'autres, qui avaient eu peur des horreurs d'un assaut, témoignaient de leur étonnement et de leur joie en dansant au son des musiques militaires. Les Juifs témoignaient bruyamment de leur allégresse, un grand nombre couraient comme des fous dans les rues. Les Turcs témoignaient d'une résignation pleine de dignité.
En fait, les Arabes étaient restés passifs. Cette lutte entre les Turcs et les Français ne les concernait pas. C'est seulement quand la défaite des Turcs se confirma qu'ils manifestèrent leur joie d'en être délivrés.
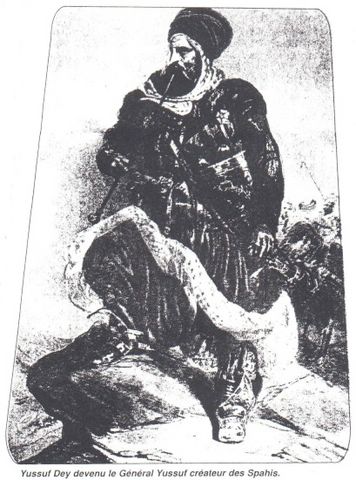 Ainsi, quand on lit maintenant dans les livres scolaires qu'en juillet 1830. Les Algériens défendirent vaillamment leur patrie, I'Algérie, on se trouve face à une double erreur. D'abord parce que le nom Algérie, n'existait pas : c'est l'administration française qui, beaucoup plus tard, créa ce terme. Ensuite, parce que, seuls, les Janissaires turcs combattirent vaillamment. Un certain nombre d'entre eux passèrent ensuite au service de la France dont un certain Yussuf, qui, plus tard, deviendra général, fondateur des Spahis algériens et, un court instant, Gouverneur de l'Algérie. Ainsi, quand on lit maintenant dans les livres scolaires qu'en juillet 1830. Les Algériens défendirent vaillamment leur patrie, I'Algérie, on se trouve face à une double erreur. D'abord parce que le nom Algérie, n'existait pas : c'est l'administration française qui, beaucoup plus tard, créa ce terme. Ensuite, parce que, seuls, les Janissaires turcs combattirent vaillamment. Un certain nombre d'entre eux passèrent ensuite au service de la France dont un certain Yussuf, qui, plus tard, deviendra général, fondateur des Spahis algériens et, un court instant, Gouverneur de l'Algérie.
Le « sauve-qui-peut, général de tous les musulmans d'Alger, voilà encore une belle légende noire. Mentir, mentir encore, mentir toujours plus pour mieux accabler la France. Certains historiens de gauche n'hésiteront pas à qualifier le Général Yussuf « d'aventurier sauvage, barbare, » ceci simplement parce qu'il avait rallié la France. Ah ! S'il avait continué à combattre contre notre pays, alors, bien sûr, on I'aurait considéré comme un héros. Vraiment " Il y a quelque chose de pourri au royaume de France » !
Assez rapidement, se posa la question au Gouvernement de Louis-Philippe : maintenant que le nid de pirates était détruit et la liberté des mers assurée, devait-on rester à Alger ? On insistait, à la Chambre, sur le coût de I'expédition, I'absence d'intérêt économique du pays privé de ressources naturelles, la pauvreté des sols, l'étendue des plaines marécageuses inhabitables au sud d'Alger, le grand nombre de malades parmi les militaires atteints de la malaria.
Le 29 avril 1834, le député Lamartine monta à la tribune de la Chambre : Eh ! Quoi, Messieurs, les nations n'ont-elles qu'une balance de chiffres à établir ? Si I'or a son poids, la politique, I'honneur national, la protection désintéressée du faible, l’humanité, n’ont-elle pas le leur ? Remettre, comme le proposent certains, les rivages et les villes d'Afrique à des princes arabes, ce serait confier la civilisation à la barbarie, la mer à la garde des pirates et nos colons à la protection et à I'humanité de leurs bourreaux. La pensée de I'abandon d'Alger resterait éternellement comme un remords sur la date de cette année, sur la Chambre et sur le Gouvernement qui l'aurait consenti. (Archives parlementaires du 29 avril 1834 citées par René Valet "L'Afrique du Nord devant le Parlement" et " Les Français d'Algérie" de Jeannine Vergès Ledoux Editions Fayard page 129)
Quelle hauteur de vue et quelle vision prémonitoire surtout quand on compare le style de ce grand poète et écrivain, français avec celui de I'homme qui brada le tout en 1962, dans le sang et dans le déshonneur : " Bye, bye les Algériens, vous nous coûtez trop cher ; » (Alain Peyrefitte - C'était De Gaulle - Fayard 1994).
Pierre Cattin
|
|
TERRORISME
PAR MANUEL GOMEZ
9 juillet 2025
|
| l La France est le seul pays au monde à honorer ceux qui ont tué des Français
Comment un garde des Sceaux, ministre de la Justice et un ministre de l’Intérieur (dont on entend quotidiennement les belles envolées mais dont on attend toujours les actes) peuvent-ils rester muets devant une telle trahison ? Le Conseil départemental socialiste de la Seine-Saint-Denis – et son président Stéphane Troussel – commémore le 5 juillet et l’indépendance de l’Algérie et souligne « les liens inextricables entre le peuple algérien et le peuple français », sans un seul mot de compassion sur la situation dramatique de l’écrivain Boualem Sansal, et il accompagne le maire de Bobigny, le Franco-Algérien Abdel Sadi (Parti Communiste Français) dans sa décision de donner le nom de Danièle Djamila Amrane-Minne à la Maison du parc de la Bergère à Bobigny.
Et pas une seule condamnation de Bruno Retailleau ni de Gérald Darmanin.
Pourtant Danièle-Djamila Amrane-Minne, qui est née à Neuilly-sur-Seine, a trahi son pays, la France, en devenant l’une des poseuses de bombes du FLN lors de la guerre d’Algérie. Sa mère, Jacqueline Netter, avait épousé, après son divorce, Abdelkader Guerroudj, militant du Parti Communiste et Danièle avait suivi son exemple en épousant Rabah Amrane.
Danièle Amrane a tué et blessé nos enfants, nos femmes, attablés paisiblement à la terrasse de la cafétéria l’Otomatic, rue Michelet à Alger en janvier 1957.
Il y eu d’autres poseuses de bombes, Zorah Drif et Djamila Bouhireb (bombe au Milk-Bar, rue d’Isly à Alger : 3 jeunes femmes tuées et 12 blessés), Baya Hocine (bombe au stade municipal : 9 morts) ; moins célèbres, Samia Lakhdari, Hassiba Ben Bouali, Djamila Boupacha, mais il s’agissait d’Algériennes qui, selon elles, luttaient pour l’indépendance de leur pays. Ce n’était pas le cas de Danièle Amrane-Minne ni de Raymonde Peschard, toutes deux françaises.
Retenons que Danièle Amrane-Minne a quitté la France après sa libération suite aux Accords d’Évian, pour s’installer en Algérie.
La France est le seul pays au monde à honorer des traîtres qui l’ont combattue dans les rangs de ses ennemis. C’est une honte.
Nous attendons, pour le moins, une condamnation du ministre de l’Intérieur puisque, bien entendu, nous n’avons rien à attendre ni du président ni du Premier ministre.
|
|
Et si on abolissait leurs privilèges ?
Eric de Verdelhan, 5 août 2025
Envoyé par M.
|
« Je ne consentirai jamais à dépouiller mon clergé, ma noblesse… C’est alors que le peuple français pourrait m’accuser d’injustice et de faiblesse. Monsieur l’archevêque, vous vous soumettez aux décrets de la Providence ; je crois m’y soumettre en ne me livrant point à cet enthousiasme qui s’est emparé de tous les ordres, mais qui ne fait que glisser sur mon âme. Si la force m’obligeait à sanctionner, alors je céderais, mais alors il n’y aurait plus en France ni monarchie ni monarque… »
(Lettre prémonitoire du Roi Louis XVI à l’archevêque de Chartres)
Mince alors, parti en vadrouille pendant une semaine, j’ai failli rater la célébration de la nuit du 4 août 1789. En réalité, je n’ai rien raté car notre République maçonnique, nourrie aux idéaux des Lumières et qui a fait de la Révolution un marqueur historique, ne fête jamais la nuit du 4 août 1789.
En ce temps-là, les petits hobereaux de province, souvent pauvres comme Job, respectaient le peuple. De nos jours, Emmanuel Macron voit, dans les gares, « des gens qui ne sont rien » et il dénigre ou insulte son peuple chaque fois qu’il est à l’étranger ; ce qu’aucun chef d’État français avant lui n’aurait osé faire. Ce type déteste le vulgum pecus, qui l’a pourtant élu par deux fois.
Mais faisons un bref rappel de cette fameuse « nuit de 4 août 1789 » ; une nuit de folie !
En fait il s’agit d’un vent de panique et d’une surenchère démagogique lors d’une séance nocturne de l’Assemblée Constituante au cours de laquelle fut votée la suppression des privilèges féodaux. Débutée à sept heures du soir, elle allait se prolonger jusqu’à deux heures du matin.
L’Assemblée Constituante mettait à terre le système féodal. C’était l’abolition pure et simple de tous les droits et privilèges féodaux ainsi que de tous les privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations, à l’initiative du « Club breton », le futur « Club des Jacobins ».
L’Assemblée Constituante élaborait la future Constitution (ainsi que la « Déclaration des droits de l’homme ») lorsqu’elle reçut des récits très alarmistes sur les mouvements populaires qui sévissaient un peu partout dans le pays. L’Assemblée envisageait alors deux hypothèses : soit réaffirmer les valeurs de la propriété, et donc contrôler la révolte. Solution rejetée, car on avait peur de la colère paysanne. Soit instaurer des « bureaux de secours », qui permettraient d’aider les plus pauvres. Mais cette suggestion ne répondait en rien à l’urgence de la situation. C’est donc pour sortir de ce blocage, nous dit-on, que naquit l’idée de l’abolition des droits seigneuriaux. En réalité, cette idée fumeuse a germé au sein du « Club Breton ». Ce projet émanait de quelques aristocrates ouverts aux idéaux des Lumières (et francs-maçons) : le duc d’Aiguillon lançait l’idée, aussitôt reprise par le vicomte de Noailles. Dans une ambiance de panique, Guy de Kerangal, le vicomte de Beauharnais, Lubersac, l’évêque de La Fare vont surenchérir en supprimant les banalités, les pensions sans titre, les juridictions seigneuriales, le droit de chasse, les privilèges ecclésiastiques, etc.
Le marquis de Foucault demande que « le premier des sacrifices soit celui que feront les grands, et cette portion de la noblesse, très opulente, qui vit sous les yeux du prince, et sur laquelle il verse sans mesure et accumule des dons, des largesses, des traitements excessifs, fournis et pris sur la pure substance des campagnes ». L’envolée est belle, mais était-elle sincère ?
Le vicomte de Beauharnais propose « l’égalité des peines sur toutes les classes des citoyens, et leur admissibilité dans tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires ». Cottin demande l’extinction de « tous les débris du régime féodal qui écrase l’agriculture ». L’Assemblée est en proie à une cacophonie démagogique ; chacun y va de sa proposition plus ou moins loufoque.
Michelet écrira un siècle plus tard, dans un style emphatique (1) : « Après les privilèges des classes, vinrent ceux des provinces. Celles qu’on appelait Pays d’État, qui avaient des privilèges à elles, des avantages divers pour les libertés, pour l’impôt, rougirent de leur égoïsme, elles voulurent être France, quoi qu’il pût en coûter à leur intérêt personnel… Le Dauphiné, dès 1788, l’avait offert magnanimement pour lui-même et conseillé aux autres provinces. Il renouvela cette offre.
Les plus obstinés, les Bretons, liés par les anciens traités de leur province avec la France, n’en manifestèrent pas moins le désir de se réunir. La Provence en dit autant, puis la Bourgogne et la Bresse, la Normandie, le Poitou, l’Auvergne, l’Artois. La Lorraine dit… qu’elle avait le bonheur de se réunir à ses frères, d’entrer avec eux dans cette maison maternelle de la France, dans cette immense et glorieuse famille ! Puis ce fut le tour des villes… »
Enfin, Lally-Tollendal termine la séance en apothéose en proclamant Louis XVI « Restaurateur de la Liberté française » (2). En une nuit, les fondements d’un système vieux de plusieurs siècles s’effondrent. Louis XVI n’accorde sa sanction (son aval) à ces décrets que contraint et forcé, le 5 octobre. Ainsi disparaissent les privilèges des ecclésiastiques, des nobles, des corporations, des villes et des provinces. Toutefois, les droits féodaux sont déclarés rachetables le 15 mars 1790, et leurs détenteurs ne sont pas tenus d’en prouver l’origine. Mais, devant le refus de quelques communautés paysannes, l’Assemblée supprime le rachat des droits le 25 août suivant. Enfin, le 17 juillet 1793, la Convention vote leur abolition complète, sans indemnité, et l’autodafé des titres féodaux.
Sont donc abolis : la main-morte réelle et personnelle (article 1er), la servitude personnelle (article 1er), l’exclusivité seigneuriale sur les colombiers (article 2), la chasse (article 3), l’exclusivité sur l’accès à certaines professions (article 11), les justices seigneuriales (article 4), les dîmes (article 5), la vénalité des offices (article 7), les privilèges particuliers de provinces (article 10) ainsi que la pluralité des bénéfices (article 14). On détricotait tout l’Ancien Régime avant de tuer la monarchie.
Le Roi Louis XVI est proclamé « Restaurateur de la liberté française » par l’article 17. L’année suivante, à la « fête de la Fédération », il donnera le premier coup de pioche pour planter « l’arbre de la Liberté » et acceptera de coiffer le bonnet phrygien. Puis, le 21 janvier 1793, sa tête finira dans le panier du « rasoir national », toujours au nom de la Liberté bien sûr !
L’abolition des privilèges était-elle utile, était-ce une nécessité inéluctable ?
Si l’on tient compte du pourrissement – moral et mental – d’une noblesse de cour, nourrie et enrichie sur le dos d’une paysannerie qui, elle, crevait de faim, cela ne fait aucun doute. D’autant que cette noblesse, qui n’en avait plus que les titres et privilèges, se plaisait à critiquer le Roi et l’Église dans les salons de quelques cocottes (3) ou dans les loges maçonniques qui fleurissaient partout.
On avait oublié que les privilèges et droits féodaux imposaient, en contrepartie, des devoirs sacrés : le chevalier était, si besoin, homme de guerre. Il mettait son épée au service de son Roi (4), protégeait ses vassaux et défendait « la veuve et l’orphelin ». Il était prêt à verser l’impôt du sang.
Le clergé soignait les malades et les indigents, hébergeait les pèlerins, aidait les pauvres et les nécessiteux, créait des écoles. Saint Vincent-de-Paul est le précurseur de la Sécurité Sociale (5) et non de l’abbé Pierre, car ce curaillon miteux avait une charité chrétienne à géométrie variable (6).
Claude-Henry de Saint-Simon (1760-1825), que d’aucuns présentent comme un réformateur social, considérait, dans les années 1820-1825, que la Révolution n’était pas achevée. Chaud partisan de « l’industrialisme », il proposait une réorganisation totale de la société, hiérarchisée entre les scientifiques et industriels d’une part et la classe ouvrière d’autre part. Il a été à l’origine du saint-simonisme et de la mise en œuvre de la révolution industrielle au XIXe siècle.
Les dynasties bourgeoises – les banquiers, les armateurs, les maîtres de forges – ont supplanté les aristocrates. On a remplacé Dieu par le fric-roi et on a envoyé dans les mines des enfants de dix ans (auxquels on accordait généreusement une journée de repos pas semaine et des journées limitées à douze heures de travail). Rien de nouveau sous le soleil puisque, de nos jours, le « bobo » achète des vêtements « froissés chics » fabriqués au Viêtnam ou au Bengladesh par des gosses qui triment six jours sur sept pour un salaire de misère.
Au début des années 60, la loi scélérate dite « Pisani-Debatisse » (tous deux francs-maçons) supprimait l’un des derniers privilèges : celui des bouilleurs de cru. L’État jacobin ne supportait pas l’idée qu’un petit propriétaire puisse transmettre à son fils le droit de confectionner sa goutte, sa gnole, son marc, et de surcroît sans payer de taxes.
Alors oui, on peut s’interroger sur l’intérêt ou la nécessité d’abolir les privilèges.
Sous l’Ancien Régime, les impôts étaient nombreux et le vassal devait un tiers de ses gains – en temps ou en argent – au royaume et/ou à son suzerain.
De nos jours, « le Figaro » nous apprend que, si l’on retire de ses revenus les impôts, taxes, et cotisations sociales diverses et variées, le Français travaille pour l’État jusqu’au… 25 juillet.
En clair, notre économie socialiste – car il s’agit bien de cela ! – lui prend les deux tiers de ce qu’il gagne. Et la France bat un record mondial d’hyper-fiscalité puisqu’on compte chez nous plus de 200 impôts et taxes. Notons, au passage, que les pays qui sont encore des monarchies – certes constitutionnelles – s’en sortent plutôt mieux que nous. Franchement, cela valait-il le coup de faire une révolution, de guillotiner le Roi, de massacrer la Vendée, de mettre l’Europe à feu et à sang ?
Sincèrement, je pense que non mais ceci n’engage que moi !
À l’heure actuelle, je pense que ce serait une œuvre salutaire, une bénédiction, d’abroger TOUS les privilèges honteux des petits marquis poudrés de la Macronie, ces parasites incompétents et arrogants formés (ou déformés) à l’ENA.
Pour ma part, je m’arroge UN privilège, UN SEUL, celui de ne pas rendre ma plume serve (7).
1)- « Histoire de Révolution française », de Jules Michelet, Flammarion, 1897-1898
2)- Et, le 21 janvier 1793, la France guillotinera le « Restaurateur de la Liberté française », sans doute pour le remercier d’avoir été si bon ?
3)- De nos jours, on dirait « poules de luxe ».
4)- Et au service de Dieu car le Roi était monarque « de droit divin ».
5)- Mais qui ne coûtait rien au contribuable.
6)- En 1954, le saint homme, avant de lancer son appel en faveur des sans-abris, avait refusé sa pitié aux combattants de Diên-Biên-Phu qui faisaient « une sale guerre colonialiste ». C’est le même qui, plus tard, condamnera les parachutistes d’Algérie mais pas le FLN.
7)- « La plume est serve mais la parole est libre » dit-on en droit.
https://ripostelaique.com/et-si-on-abolissait-leurs-privileges.html
Eric de Verdelhan (5 août 2025)
|
|
AL DJAZAÏR
Par VERITAS N° 76, octobre 2003
Georges-Emile PAUL
|
|
DE TAMANRASSET A DUNKERQUE
La France viendra-t-elle un jour à obtenir « son indépendance » de l'Algérie ?
La question peut, sans doute, paraître idiote à quelques-uns uns, sauf à ceux qui s'aperçoivent de la ferveur des Algériens à solliciter visas et permis de séjour (à vie sûrement) dans cette bonne vieille France qui les colonisa si maladroitement jusqu'en 1962, les oppressant odieusement au point de les inciter à une guerre de huit années qui ne fut finalement conclue qu'en imposant au Général-Président français une retraite générale et sans condition de ses soldats et de ses civils. Lui, le glorieux, n'obtint rien en échange, rien de rien.
Ce qui confirme bien la réflexion, plus tard, d'un de ses biographes, Jean Lacouture : « Jamais l'une de ses concessions majeures ne fut payée d'une seule satisfaction venue de la partie adverse ». On pourrait ajouter qu'il y a là, pour un homme dont la vie tant encensée connut finalement plus d'échecs retentissants que de succès réels, une aptitude sans doute ignorée à prendre des coups de pieds au c... ! Et si l'on devait les compter, de Churchill à Ben Bella, avouons qu'il en a pris quelques-uns qui ont bien dû lui marquer les fesses.
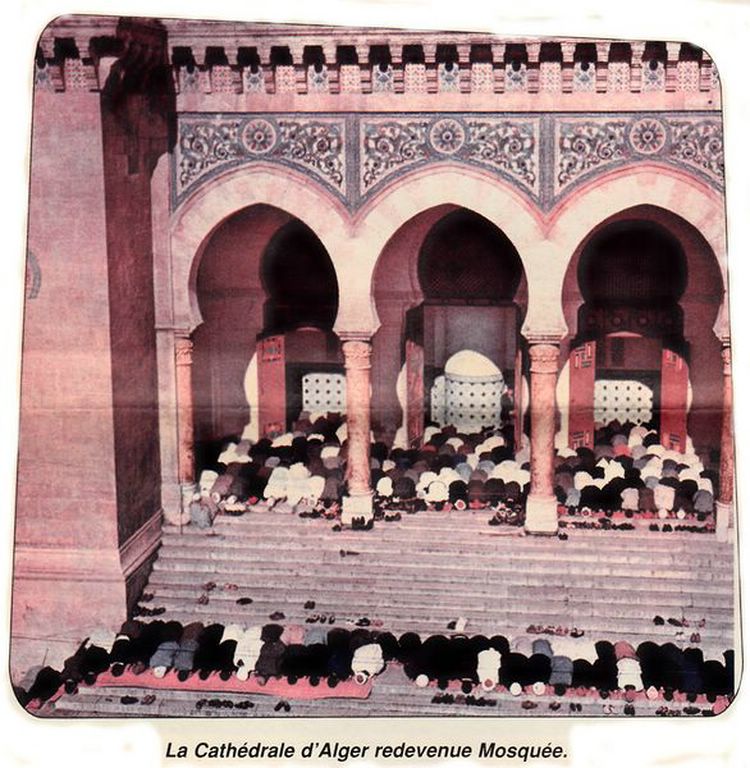 Aujourd'hui, quarante et un ans le plus beau temps des mensonges et de la lâcheté, ce M. De Gaulle, bien mort, n'est plus à même de nuire sauf s'il est imité par quelques-uns uns de ces zélés serviteurs qui lui empruntent parfois la voix et le bâton, nécessaire indispensable à toute contradiction. Il reste cependant cette Ve République dont il modifia à souhaits la Constitution pour mieux conduire son œuvre néfaste. Aujourd'hui, quarante et un ans le plus beau temps des mensonges et de la lâcheté, ce M. De Gaulle, bien mort, n'est plus à même de nuire sauf s'il est imité par quelques-uns uns de ces zélés serviteurs qui lui empruntent parfois la voix et le bâton, nécessaire indispensable à toute contradiction. Il reste cependant cette Ve République dont il modifia à souhaits la Constitution pour mieux conduire son œuvre néfaste.
Bien peu amendée depuis 1958, elle a offert d'excellents habits à ses successeurs et ce, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre ! Et l'on voit aujourd'hui M. Chirac se persuader qu'héritier de la pensée du grand homme, il lui revient de conduire le «peuple de veaux » avec la même stratégie que le gisant de Colombey : laisser croire à la France qu'elle est encore et toujours belle et grande et généreuse...
Généreuse, certes, elle l'est, et sans doute un peu plus pour l'étranger à qui elle donne sans compter, offrant ici les euros par millions, là une remise de dette où s'opère un gaspillage indécent, toutes ces largesses non sollicitées du « contribuable-payeur » qui pourrait avoir son mot à dire mais que l'on ne consulte pas !
Qu'importe que cela mène à une dette accumulée de 1000 milliards d'euros (6 550 milliards de ce qu'étaient nos francs), ce qui laisse à chaque nouveau-né dans notre hexagone un « arriéré » de 15000 euros, inextricable situation qui ne semble guère inquiéter les responsables de l'Etat et moins encore les économistes de Bercy.
Si d'aucuns conviennent que notre endettement est excessif et que laisser filer encore plus un déficit abyssal n'est pas une bonne politique, reste que le paisible ronronnement élyséen dicte aux élus (eux, toujours mieux rémunérés) un cheminement docile qu'on peut aussi qualifier de coupable. Après tout, d'autres, plus tard, hériteront du fardeau et des problèmes, ces problèmes, qui eux aussi, se compliquent et se multiplient sans inquiéter le Gouvernement ou le Président...
Revenons sur cette affaire de visas généreusement accordés par milliers à ces demandeurs algériens, lesquels, à peine débarqués dans notre beau pays, attestent volontiers s'y sentir à l'aise, bien accueillis, bien nantis sur place jusqu'à s'y voir en « terre conquise », ce qu'on peut lire à ce que l'on nous rapporte sur les murs de quelques lieux bien annexés en banlieue où d'ailleurs le slogan fait recette : « L'ALGERIE de TAMANRASSET à DUNKERQUE ! ».
Ainsi, tout doucement, comme a dit un certain Houari Boumediene, d'ailleurs nullement l'idiot qu'il semblait être : « avec une ration annuelle de visas et le ventre de nos femmes algériennes, nous coloniserons la France ! ... ».
Quand donc celle-ci comprendra-t-elle enfin - jusqu'à en persuader ses dirigeants prompts à se soutenir un peu trop dans leur travers de sourds-irresponsables - que nous voilà, en cette année de l'Algérie fort alambiquée, quasiment au pied du mur ?
II y a pourtant bien peu d'années qu'un certain Michel Rocard, alors Premier Ministre, n'avait pas craint de souligner, sans renier son socialisme militant, que : « la France n'a pas les moyens d'accueillir toute la misère du monde... » et nous de préciser : « toute la misère du Maghreb ! ». C'était, il y a seulement quelques années mais il est vrai d'un autre siècle où quelques-uns avaient encore le mot juste.
Lorsqu'en mars dernier, lors de son voyage quasi-inutile en Algérie, Jacques Chirac déclarait, sous une salve d'applaudissements « nous sommes déterminés à mettre en place tous les moyens qui faciliteront, dans un esprit de responsabilité partagée, la délivrance des visas... », le Président envisageait-il l'aménagement de l'Elysée en vaste immeuble H.L.M (« avec bruits et odeurs »...), où se défalquait-il déjà sur les 36000 communes de France de l'accueil, logement, viatique des milliers d'Algériens qui lui réclamaient à Oran et à très haute voix : « des visas, des visas, des visas, des visas ... ».
A en croire le monde ouvrier français et ses syndicalistes fortement mobilisés jusqu'à la veille des vacances, nombre de travailleurs souffrent d'être mal payés ou dans un emploi économiquement fragilisé. S'ajoutent à l'inconfort et aux incertitudes le sort de deux millions de chômeurs et le mal vivre d'une société de smicards dont on ne peut douter qu'ils peinent à joindre les deux bouts ! Si ce constat est juste, pourquoi persister à distribuer des visas par milliers, qui feront demain des milliers de clandestins qu'une mafia saura pourvoir en bonne identité, à des Algériens, la plupart du temps analphabètes et sans qualification, mais qui sauront faire foule pour réclamer bruyamment, avec l'aide des professionnels du désordre, des droits qu'un Français ne se risquerait pas de réclamer au pays de Bouteflika.
Qui nous dira ce qu'il en coûte à une France quasi-ruinée de l'aide spontanée offerte à ces milliers d'immigrants algériens que leur pays pourrait au moins aider par une ristourne sur ces produits pétroliers mis à jour par nos ingénieurs, mais qu'en fait des contrats dits « politiques » nous imposent de payer au plus haut prix du marché ?
Voit-on par ailleurs, une volonté d'intégration de ces populations que le Trésor Public porte à bout de bras, qu'une armée de policiers et de magistrats peine à tenir dans le respect de nos lois ? Absolument pas ! C'est, le plus souvent, le contraire qui joue car ces gens viennent avec la haine de l'Occident et plus particulièrement de cette France que l'on accuse des pires maux depuis 40 ans, jusqu'à écrire que si, en Algérie, l'industrialisation n'opère plus, si l'agriculture ne nourrit plus un peuple qui compte aujourd'hui plus de trente millions d'âmes, la faute en revient à la France et à ses colonisateurs qui ont ensemble 132 ans durant, pompé les richesses du pays !
Il n'en fallait guère plus pour faire de ces immigrants une population qui nous méprise, qui exige tout sans rien donner en retour, se souvenant que ses fedayins ont vaincu la puissante Armée française et que de ce fait ils n'en n'ont que plus de droit chez nous et sur nous !
On a répété cela à l'envi durant 40 ans, on l'a lu mille fois sur « El Watan » jusqu'à préciser qu'on ne recevait l'aide de la France qu'en forme de dédommagement.
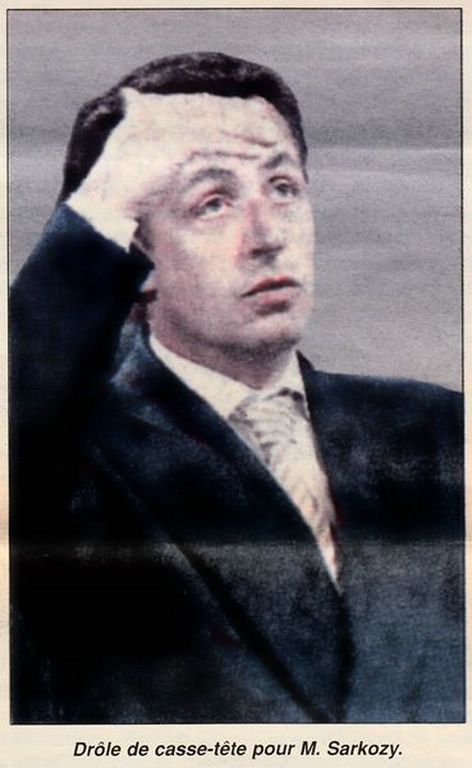 Ce n'est qu'avec l'apparition d'une presse libre, mais rare et souvent saisie, que les Algériens ont pu savoir que leur pays détenait de formidables atouts économiques, que son aisance était déjà réelle au temps de la colonisation, et que, venue l'indépendance, c'est l'ère d'une nomenklatura d'ambitieux et de corrompus qui pilla les avoirs et les richesses du pays, lequel, soumis depuis des années à un socialisme d'Etat en faillite jusqu'en U.R.S.S, ne pouvait que conduire l'Algérie à la ruine. Ce n'est qu'avec l'apparition d'une presse libre, mais rare et souvent saisie, que les Algériens ont pu savoir que leur pays détenait de formidables atouts économiques, que son aisance était déjà réelle au temps de la colonisation, et que, venue l'indépendance, c'est l'ère d'une nomenklatura d'ambitieux et de corrompus qui pilla les avoirs et les richesses du pays, lequel, soumis depuis des années à un socialisme d'Etat en faillite jusqu'en U.R.S.S, ne pouvait que conduire l'Algérie à la ruine.
C'est aussi une bonne accumulation de fautes politiques qui a donné naissance à cette guerre affreuse qui se poursuit toujours et dont le bilan, dit-on, aurait déjà fait DEUX CENTS MILLE MORTS. Et ce n'est pas le récent mauvais calcul du pouvoir - la libération des deux principaux meneurs du F.I.S. en échange d'un « coup de main » à Bouteflika pour sa réélection de l'an prochain - qui apportera la paix civile à une Algérie que l'on dit d'ores et déjà acquise au changement, ce que confirmerait la toute récente scission au sein du F.L .N partagé entre Bouteflika et Benflis. Nous en reparlerons...
Notre sujet, aujourd'hui, reste le problème que pose cette immigration massive d'Algériens, véritable exode, en somme, après celui, en 1962 de la communauté européenne, pourtant dépossédée de tous ses biens et rentrée en métropole dans les exécrables conditions dont ce journal s'est fait maintes fois l'écho.
Ce serait faillir à l'honnêteté intellectuelle que de ne pas différencier les deux grandes époques de l'immigration algérienne : la première, au temps des trente glorieuses, fut une immigration par appel d'emploi certainement utile en son temps mais hélas vite ramenée à ce qu'on pourrait appeler une immigration incontrôlée de simple peuplement.
Toutes deux se confondent aujourd'hui comme elles attestent une maladresse politique des hommes de gouvernement qui n'ont pas su - ou pas voulu - négocier là où il y avait lieu pour une véritable immigration contrôlée, ce qui mène à ce constat aberrant : en 1962, la France recensait trois cent cinquante mille Algériens. En 2002, on en donnait 5 MILLIONS probables d'où, en quelques décennies, une métropole passée de 55 à 60 millions d'habitants et nos spécialistes en démographie soulignent aujourd'hui que la femme Française est de loin la femme d'Europe la plus prolifique ! Ne voit-on pas quelque part une ficelle anormalement grosse ?
Mais le fait est là, grâce en particulier au moyen du regroupement familial, la masse migratoire n'a cessé d'enfler d'années en années en conservant jalousement religion et particularismes de société et allant inéluctablement vers un communautarisme qui défiera peut-être demain les lois fondamentales de la République Française...
C'est faire là aussi un constat d'échec de toutes formes d'intégration !
Et il nous faut faire encore le même constat, non moins grave, sur la tentative de notre Ministre de l'Intérieur M.Sarkozy, dans son souhait de donner à notre pays un Conseil Français du Culte Musulman, large fédération des divers courants se réclamant de l'Islam. Sur ce sujet, nous avons porté un vif intérêt à l'article de M. Mohamed Ibn Gouadi, islamologue à l'Université de Strasbourg, paru dans « le Figaro » du 17 juin 2003.
L'auteur ne s'explique pas que l'on s'offusque de la politisation de l'Islam en France ou ailleurs : " c'est là un non-sens puisque l'Islam a toujours été politique ! que l'on en soit ou non choqué, le fait que les Musulmans fassent passer le Coran avant les lois de la République est parfaitement juste en Islam, ce qui amène à dire que les efforts des Musulmans souhaitant concilier Islam et laïcité sont vains ! ".
C'est un point de vue, qui sans doute, a ses adeptes, ce qui ne veut pas dire que la majorité des Musulmans de France s'y reconnaît, loin s'en faut !
Dans la perspective d'unifier les diverses tendances d'agitation des Musulmans de France, M. Sarkozy s'est employé à donner corps à ce C.F.C.M. dont, apparemment, il attend beaucoup ! II a donc convié les 25 présidents régionaux de ce culte en assemblée pour, finalement, devoir constater un désaccord profond entre ces responsables, à commencer par celui des opposants l'U.O.I.F., laquelle est, au dire de beaucoup, l'instigatrice chez nous d'un Islam militant, politisé, et disposant notoirement de moyens financiers exceptionnels dont ne jouissent pas les autres organisations. On peut aussi ajouter que l'U.O.I.F. est une émanation des « Frères musulmans », celle-ci jamais très regardante, au Moyen-Orient, sur les moyens à arriver à ses fins et toujours en faveur aux yeux de ses généreux financiers : l'Arabie Saoudite ou les Emirats du Golfe.
En privilégiant un tant soit peu les contacts avec cette association longtemps tenue pour suspecte, voire dangereuse, c'était à la fois lui reconnaître une représentativité qu'elle n'avait pas, et fortement contrarier les autres, faisant dire au Mufti de Marseille que notre Ministre ne faisait rien moins que : « Légitimer des courants obscurantistes », opinion partagée par l'unique femme de l'assemblée Mme Betoule Fekkar - Lambiotte, laquelle, avant de démissionner de la COMOR, puis du C.F.C.M., dénonçait publiquement un « Islam parfaitement rétrograde », ce qui est bien le cas de l'U.O.I.F. dans son programme relatif à l'évolution du statut de la femme Arabe plus que restrictif, ou à la définition d'un Islam de tolérance dans la République.
Nous avons eu une belle démonstration dans le vaste chahut mené au Bourget en avril dernier, lors des vingtièmes rencontres de l'U.O.I.F. qui avaient, pour l'occasion, rassemblé quelques milliers de femmes ostensiblement voilées, et fait huer fort irrespectueusement notre Ministre, lequel, eut bien du mal à rappeler que : « en France, la loi républicaine l'emportera toujours sur la religion et en garant de la laïcité de l'Etat, il ne serait toléré aucun prosélytisme ». Escarmouche limitée, certes, mais déjà révélatrice d'une pression sous-jacente à montrer combien les fondamentalistes sont décidés - voire pressés - de s'identifier à part, tout autant semble t-il que leur évidente volonté d'accaparer le débat.
Voilà ce qui ne nourrissait guère les grandes espérances de vaincre de M. Sarkozy quant à son vaste projet d'une forte union des Musulmans de France, d'autant plus que ces dissensions étalées au sein même du premier conseil du C.F.C.M. ( seize voix à des Présidents ralliés à un Islam modéré, neuf voix à l'U.O.I.F.) allaient inciter à la création du Mouvement des musulmans laïques de France », lequel a déjà prévu de tenir son congrès au mois d'octobre, rappelant avec force qu'il est issu de la majorité silencieuse des musulmans de ce pays, hommes et femmes épris de paix, de justice, et de laïcité !
M. Sarkozy s'est sorti de ce mauvais pas en affirmant que « l'Islam de France a besoin de toutes ses tendances, sauf à rester l'Islam clandestin, celui des caves et des garages... ». Il n'en a pas moins bien aidé à valider un Islam assez radical pour devenir dangereux, tant pour les musulmans qui souhaitent évoluer dans le cadre des institutions françaises, que pour garantir demain la stricte laïcité de la République.
Il ne serait pas bon pour nos concitoyens d'ignorer ce qui n'est d'ailleurs que l'échec d'une tentative ministérielle, et non l'échec de la France en l'affaire !
Voyons bien qu'au fil du temps et de ce qui deviendra - ne le sent-on pas de toute part ? - une pression islamique dont on perçoit tant l'origine que l'orientation, ces voies extrémistes ne veulent que la déstabilisation de nos démocraties, en agglutinant maladroitement les problèmes dans une immigration à tout va, et l'insuccès d'une intégration que l'on ne peut imposer en l'état, tant y sont réfractaires ceux dont on refuse de voir qu'ils ont la volonté de combattre nos institutions. Notre pays s'offre ainsi aux risques de l'éclatement majeur d'une cohésion nationale déjà fragilisée.
La France a fait l'erreur, avec ce qui fut l'Algérie Française, de n'accepter en tant qu'interlocuteurs, à l'heure de débattre de son avenir, que ces ennemis les plus tenaces, les plus irréductibles, ceux qui tiennent encore le pouvoir à Alger grâce à nous, à nos faiblesses et à nos sous, nous gratifiant, en retour, de leur intolérance et de leur mépris !
A l'heure d'initier un véritable conseil français du culte musulman dont on ne sait ce qu'il en adviendra dans deux ans, à son renouvellement, gardons-nous donc de rêver d'un « Islam à la française » proprement inconcevable dans les luttes et les paradoxes qui sont actuellement le problème à tant d'inconnues de l'Islam et des musulmans dans le monde du XXIe siècle...
Par Georges-Emile PAUL
|
|
L’Algérie du Père Ubu
Par M. Bernard Lugan
Envoyé par Mme A. Bouhier
|
|
L’Algérie manque de tout. En dehors des hydrocarbures et des dattes, elle ne produit rien. Pas même le grain pour le couscous ou le concentré de tomates. Aussi, afin d’éviter l’explosion sociale, le gouvernement vient-il de légaliser la contrebande. Par le décret n°25-170 du 28 juin 2025, les « auto-importateurs », lire les « trafiquants-entrepreneurs », sont désormais autorisés à importer jusqu’à 24.000 euros de marchandises par mois. Certes, mais comme il est interdit de sortir de son compte bancaire plus de 7.500 euros par an, le « trafiquant-entrepreneur » va donc acheter sur le marché parallèle ses euros à un taux deux fois supérieur au taux officiel. Début juillet, la Banque d’Algérie affichait ainsi un euro à un peu plus de 150 dinars quand le marché parallèle le proposait à un peu plus de 270 dinars.
Puis, le « trafiquant-entrepreneur » va déposer ses précieux euros sur un compte régulier ouvert en devises, et sans que la banque l’interroge sur l’origine de cet argent.
Or encore, dans ce royaume du Père Ubu qu’est l’Algérie, le décret du 28 juin 2025 impose aux auto-importateurs de ne pas être salariés, commerçants ou bénéficiaires d’aides sociales.
Conclusion, seuls les inactifs sont donc autorisés à devenir officiellement « trafiquants-importateurs ».
Mais comment des chômeurs ou des inactifs peuvent-ils justifier d’être porteurs de 24.000 euros en espèces ? En réalité, c’est le blanchiment et le recyclage des fonds occultes qui est donc désormais officiellement possible… Enfin, comme l’Algérie doit importer tout ce qui permet de nourrir, habiller, soigner et équiper sa malheureuse population, et alors que l’urgence serait de soutenir la diversification et les productions locales, des milliers de « trafiquants-entrepreneurs » vont donc achever de tuer ce qui reste de commerce licite puisque la contrebande officialisée est plus rentable que l’entreprise…
|
|
Anniversaire :
Article paru dans l'éphéméride de "JSF" de ce jour
(Envoyé par Mme A. Bouhier)
|
|
N'oublions pas le tribut de tant des nôtres dans la libération de "l'Amère" Patrie !...
1944 : Débarquement Allié en Provence
Composé essentiellement de Français des colonies, le débarquement de Provence, baptisé « Anvil » (enclume), débute par un parachutage de troupes suivi d’un débarquement sur la côte.
L’opération, engageant plus de 300 000 hommes, est de moindre envergure qu’en Normandie mais elle obtient une avance plus rapide, les nazis ayant envoyé des renforts vers le nord.
Les villes de Marseille, Toulon ou encore Grenoble, seront libérées en moins de dix jours.
Dès le 20 août 1944, le général de Monsabert mène l’investissement de Marseille, avec les chars du 2ème Régiment de Cuirassiers.
Du 23 au 27 août, la bataille fait rage. Le 25 août, l’assaut de Notre-Dame de la Garde par les 1ère et 2ème Compagnies du 7ème Régiment de Tirailleurs Algériens, appuyés par les blindés du 2ème Escadron du 2ème Cuirassiers, en est l’un des épisodes les plus dramatiques : le char Jeanne d’Arc, sévèrement touché, est immobilisé devant l’Evêché, et trois de ses cinq occupants sont tués sur le coup. Restauré et inauguré comme monument commémoratif le 25 août 1946, ce char témoigne encore aujourd’hui de la rudesse de ces combats.
Dans son C’était De Gaulle, Alain Peyrefitte a clairement expliqué pourquoi De Gaulle n’a jamais commémoré le 6 juin, rapportant ses propos, que nous retranscrivons ci-dessous :
« Le débarquement du 6 juin, ç’a été l’affaire des Anglo-Saxons, d’où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s’installer en France comme en territoire ennemi ! Comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s’apprêtaient à le faire en Allemagne. Ils avaient préparé leur AMGOT qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l’avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis.
C’est exactement ce qui se serait passé si je n’avais pas imposé, oui imposé, mes commissaires de la République, mes préfets, mes sous-préfets, mes comités de libération ! Et vous voudriez que j’aille commémorer leur débarquement alors qu’il était le prélude à une seconde occupation du pays ? Non, non, ne comptez pas sur moi ! Je veux bien que les choses se passent gracieusement mais ma place n’est pas là !
Et puis, cela contribuerait à faire croire que, si nous avons été libérés, nous ne le devons qu’aux Américains. Ca reviendrait à tenir la Résistance pour nulle et non avenue. Notre défaitisme naturel n’a que trop tendance à adopter ces vues. Il ne faut pas y céder.
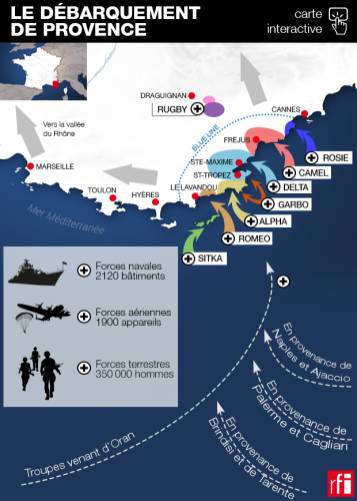
En revanche, ma place sera au mont Faron, le 15 août, puisque les troupes françaises ont été prépondérantes dans le débarquement en Provence, que notre 1ère Armée y a été associée dès le premier jour, que sa remontée fulgurante par la vallée du Rhône a obligé les Allemands à évacuer tout le Midi et tout le Massif central sous la pression de la Résistance. Et je commémorerai la libération de Paris, puis celle de Strasbourg, puisque ce sont des prouesses françaises, puisque les Français de l’intérieur et de l’extérieur s’y sont unis, autour de leur drapeau, de leur hymne, de leur patrie. Mais m’associer à la commémoration d’un jour où l’on demandait aux Français de s’abandonner à d’autres qu’eux-mêmes, non !
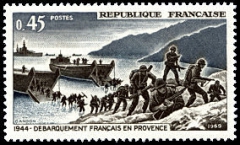 Les Français sont déjà trop portés à croire qu’ils peuvent dormir tranquilles, qu’ils n’ont qu’à s’en remettre à d’autres du soin de défendre leur indépendance ! Il ne faut pas les encourager dans cette confiance naïve qu’ils paient ensuite par des ruines et des massacres ! Il faut les encourager à compter sur eux-mêmes ! Allons, Peyrefitte ! Il faut avoir plus de mémoire que ça ! Il faut commémorer la France et non les Anglo-Saxons ! Je n’ai aucune raison de célébrer ça avec éclat. Dites-le à vos journalistes. » Les Français sont déjà trop portés à croire qu’ils peuvent dormir tranquilles, qu’ils n’ont qu’à s’en remettre à d’autres du soin de défendre leur indépendance ! Il ne faut pas les encourager dans cette confiance naïve qu’ils paient ensuite par des ruines et des massacres ! Il faut les encourager à compter sur eux-mêmes ! Allons, Peyrefitte ! Il faut avoir plus de mémoire que ça ! Il faut commémorer la France et non les Anglo-Saxons ! Je n’ai aucune raison de célébrer ça avec éclat. Dites-le à vos journalistes. »
Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, mémoires, 1994-2000.
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône et la Province du Constantinois méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il a continué jusqu'à son dernier souffle. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous, des pages qui pourraient être complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir. Jean Claude est décédé, et comme promis j'ai continué son oeuvre à mon rythme.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Guelma, Philippeville, etc. a été fait pour d'autres communes de la région de Bône et de Constantine.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et du Constantinois
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
|
| Papy Marcel
Envoyé Par Eliane
|
81 ans, chez le médecin
Docteur j’voudrais ben un p’tit fortifiant
Un fortifiant ? qu’est ce qui ne va pas cher monsieur ?
Ben v’la docteur, bon on est entre hommes, vous comprenez ?
Bien sûr... Bien sûr…
V’la quand j’vais voir ma copine c'est pu comme avant, voyez ben sque j'veux dire ?
Bien sûr, bien sûr, racontez moi.....
Bon ben v’la squi m'arrive vous comprenez, on est entre hommes hein ? bon pour le premier ça va, pour le deuxième ça peut aller mais déjà maintenant pour le troisième j’peux pu.
Je vois je vois, je vais vous donner un fortifiant mais je vous conseille vu votre âge de vous arrêter au deuxième.
Ben oui, docteur, mais ma copine elle habite au quatrième !!!
|
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d'informer est grandement menacée, et c'est pourquoi je suis obligé de suivre l'exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d'information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d'expression, tel qu'il est reconnu par la Résolution 59 de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d'expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
| |
|
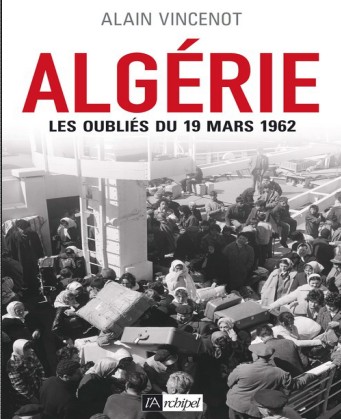



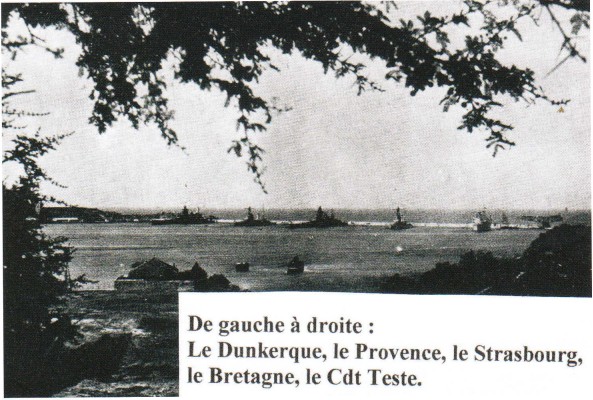

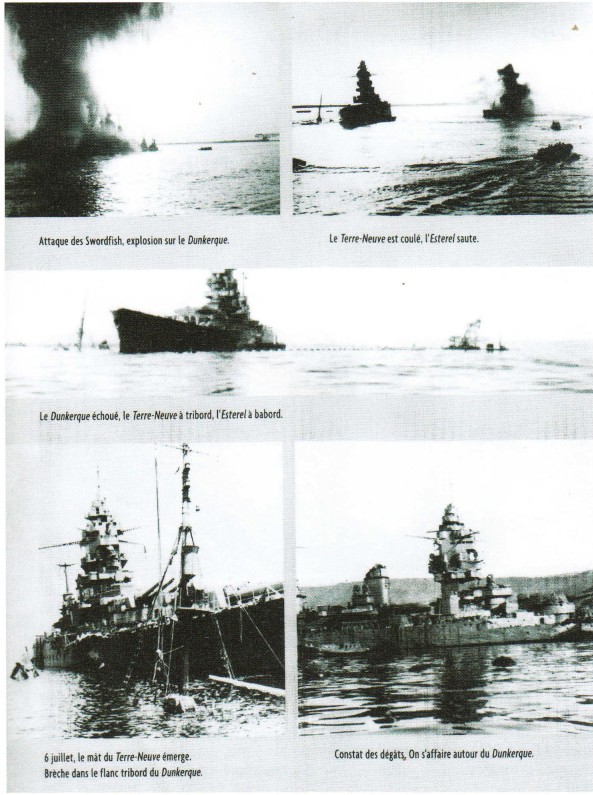
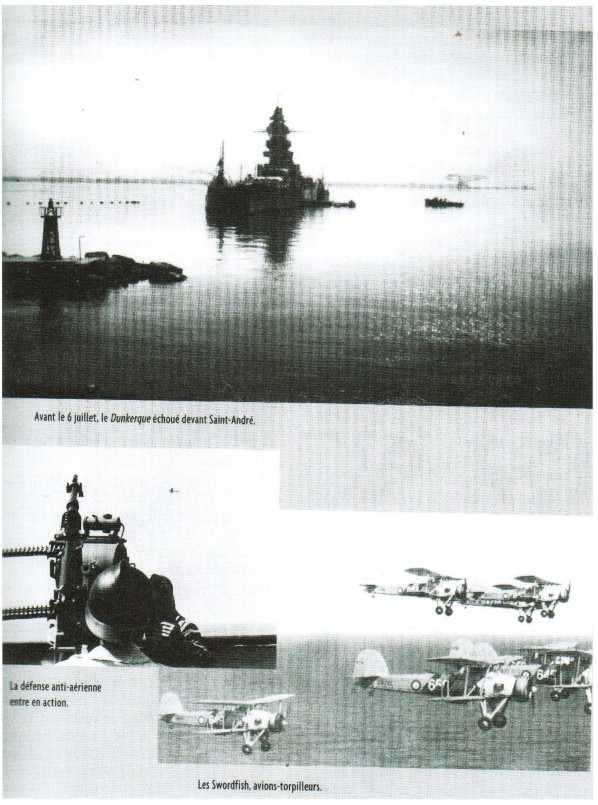
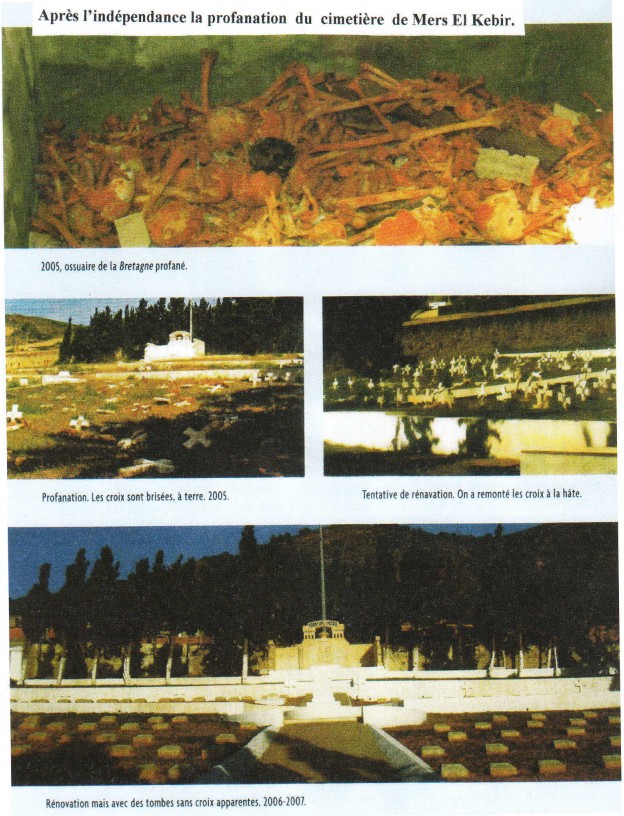
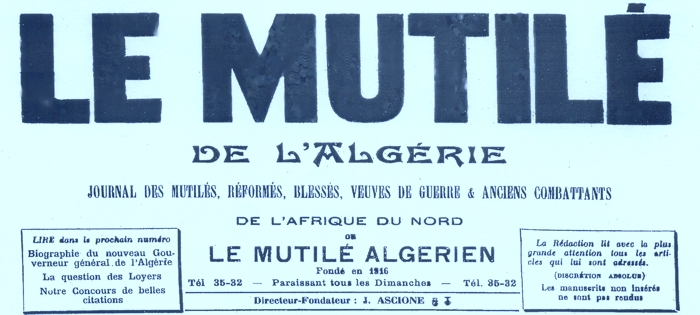
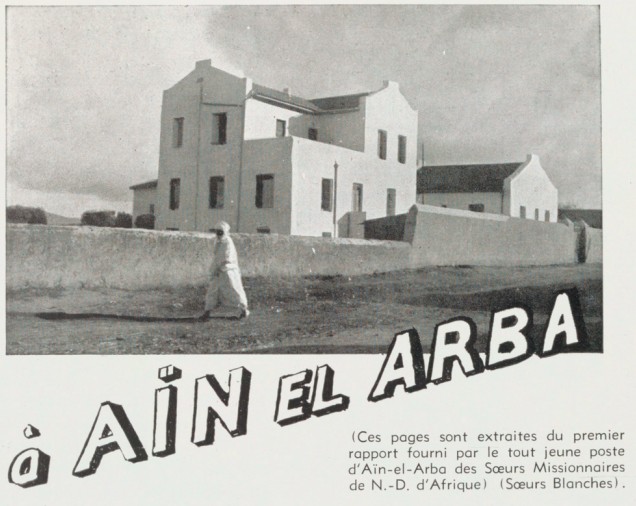
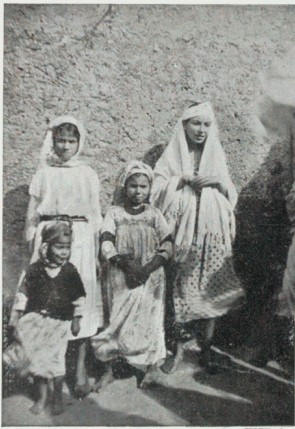

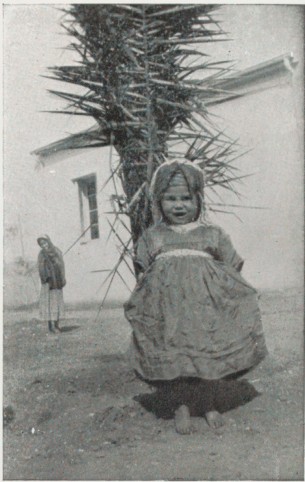 Aïn-el-Arba étant éloigné des centres, le dispensaire répond à un réel besoin de la population indigène. Les malades ne craignent pas de faire 20 à 25 kilomètres pour y recourir. II serait prématuré de parler de son influence ; on peut cependant bien augurer de ses développements. Du fait de sa situation, il est appelé à rendre de vrais services ; le chiffre de 25.800 soins donnés durant les neuf premiers mois semblent l'indiquer.
Aïn-el-Arba étant éloigné des centres, le dispensaire répond à un réel besoin de la population indigène. Les malades ne craignent pas de faire 20 à 25 kilomètres pour y recourir. II serait prématuré de parler de son influence ; on peut cependant bien augurer de ses développements. Du fait de sa situation, il est appelé à rendre de vrais services ; le chiffre de 25.800 soins donnés durant les neuf premiers mois semblent l'indiquer.

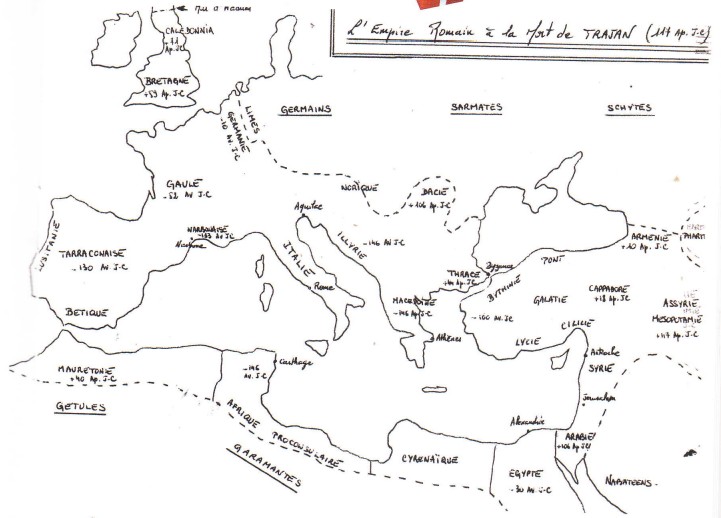
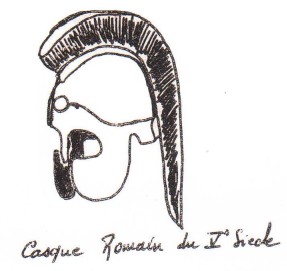 L'armement de I'armée royale et du début de la république fut certainement de type hoplitique et de style ou d'origine étrusque. Le casque lourd, les cnémides protégeant les tibias et le bouclier rond donnaient une allure grecque à notre fantassin romain. Une longue pique ( hasta) et une épée de fer viennent compléter la panoplie.
L'armement de I'armée royale et du début de la république fut certainement de type hoplitique et de style ou d'origine étrusque. Le casque lourd, les cnémides protégeant les tibias et le bouclier rond donnaient une allure grecque à notre fantassin romain. Une longue pique ( hasta) et une épée de fer viennent compléter la panoplie.
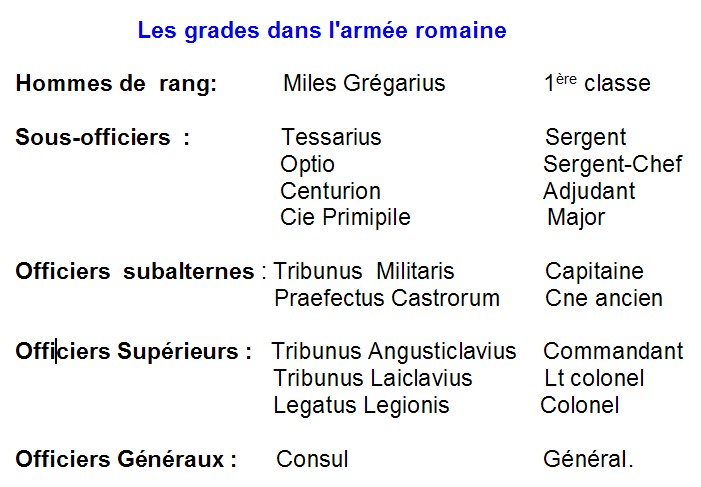
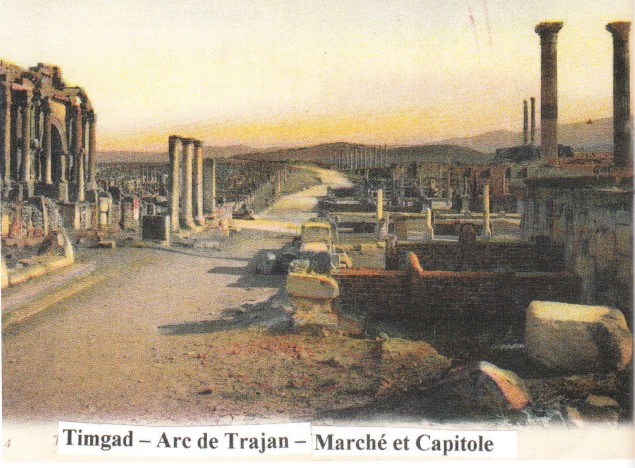


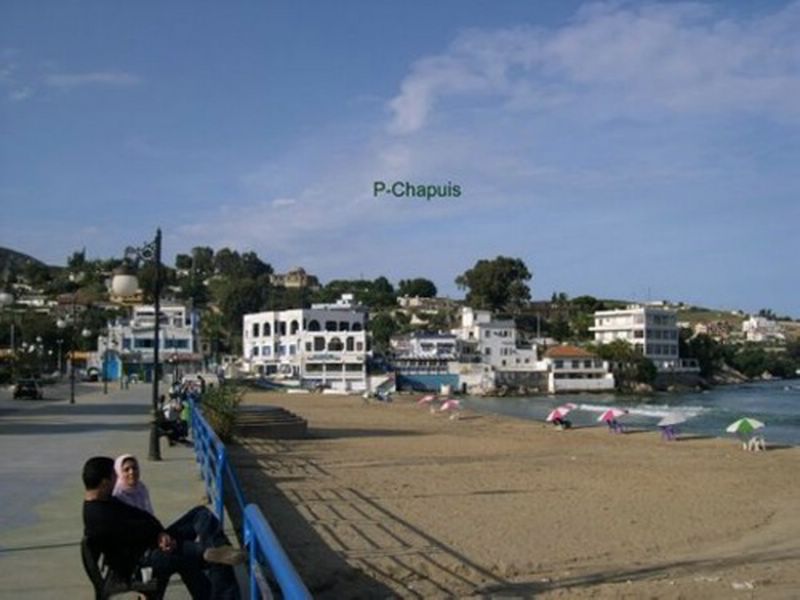
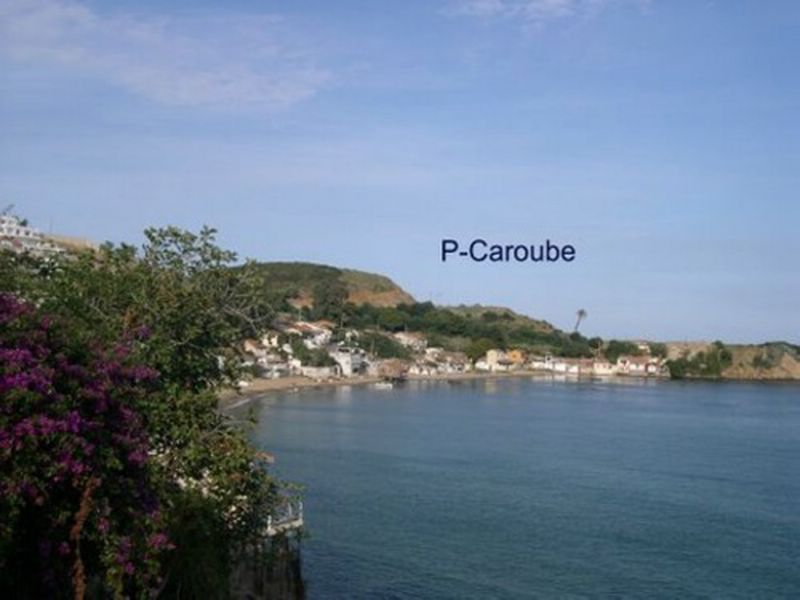


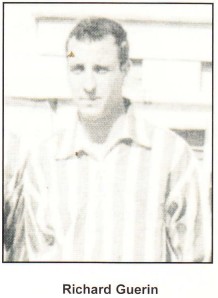 Avec un père footballeur à I'AGS Mascara, Champion d'AFN de course à pied (Charles ELKAIM) et un oncle qui évolua au CALO, avant d'être transféré à l'Olympique de Marseille à 17 ans et demi, sélectionné en équipe de France "B" avant d'être "interdit" d'Espagne - France "A" pour une sordide histoire de... religion (Emile Dahan), le jeune Richard ne pouvait échapper au sport.
Avec un père footballeur à I'AGS Mascara, Champion d'AFN de course à pied (Charles ELKAIM) et un oncle qui évolua au CALO, avant d'être transféré à l'Olympique de Marseille à 17 ans et demi, sélectionné en équipe de France "B" avant d'être "interdit" d'Espagne - France "A" pour une sordide histoire de... religion (Emile Dahan), le jeune Richard ne pouvait échapper au sport.
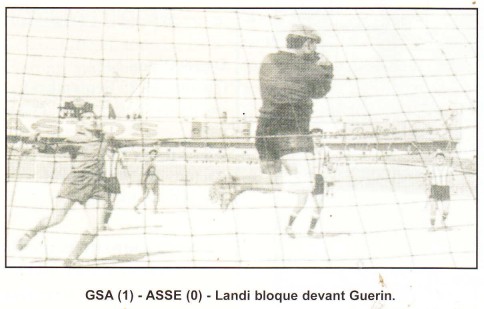 L'équipe est bonne mais I'ailier gauche "Aouah ! rien qu'il touche pas une bille" C'est ainsi que Richard signe en 1949 chez les "Coqs" algérois. MONTEL prend cette équipe en main. On y retrouve des joueurs qui brilleront au plus haut niveau : Ichalalene, Barbier, Picard, Billota entre autres. Fin connaisseur, le père de Richard suit toutes les prestations de son rejeton et il n'est pas de meilleur ni de plus honnête critique. Aussi, Richard, dribbleur dans l'âme, simplifie son jeu. Infatigable et attaquant polyvalent, il mise sur des accélérations foudroyantes pour fatiguer son adversaire direct avant de reverser dans son péché mignon, le dribble.
L'équipe est bonne mais I'ailier gauche "Aouah ! rien qu'il touche pas une bille" C'est ainsi que Richard signe en 1949 chez les "Coqs" algérois. MONTEL prend cette équipe en main. On y retrouve des joueurs qui brilleront au plus haut niveau : Ichalalene, Barbier, Picard, Billota entre autres. Fin connaisseur, le père de Richard suit toutes les prestations de son rejeton et il n'est pas de meilleur ni de plus honnête critique. Aussi, Richard, dribbleur dans l'âme, simplifie son jeu. Infatigable et attaquant polyvalent, il mise sur des accélérations foudroyantes pour fatiguer son adversaire direct avant de reverser dans son péché mignon, le dribble.
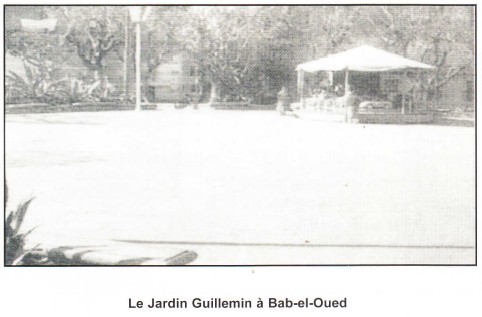 Marcel Salva suit d'un oeil, ô combien exercé, ce gamin remuant qui se faufile, tel une anguille, dans les défenses. Champion d'Alger, minimes et cadets, il sera titularisé en équipe fanion" lors d'un match au Municipal mettant aux prises le GSA et le Mouloudia Club Algérois. Pour son baptême de feu, le MCA lui propose comme adversaire direct un Amtouche réputé pour son jeu...viril.
Marcel Salva suit d'un oeil, ô combien exercé, ce gamin remuant qui se faufile, tel une anguille, dans les défenses. Champion d'Alger, minimes et cadets, il sera titularisé en équipe fanion" lors d'un match au Municipal mettant aux prises le GSA et le Mouloudia Club Algérois. Pour son baptême de feu, le MCA lui propose comme adversaire direct un Amtouche réputé pour son jeu...viril.
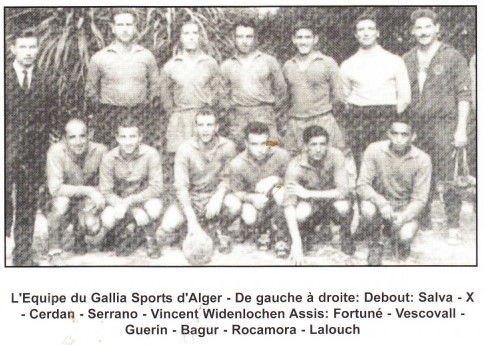 Il signe à nouveau au GSA mais ses performances se ressentent de son manque d'entraînement dû aux études de plus en plus accaparantes. Après une saison où il obtient une sélection en Equipe de France Universitaire et son diplôme de Médecine Générale, il signe à I'Association Sportive de Saint-Eugène.
Il signe à nouveau au GSA mais ses performances se ressentent de son manque d'entraînement dû aux études de plus en plus accaparantes. Après une saison où il obtient une sélection en Equipe de France Universitaire et son diplôme de Médecine Générale, il signe à I'Association Sportive de Saint-Eugène.
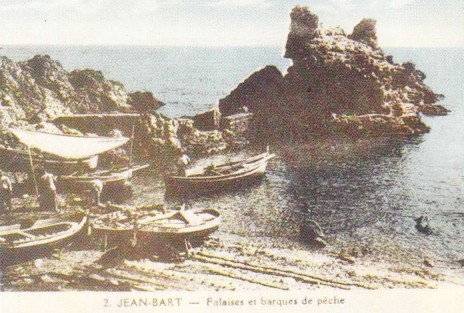
 Jean Bart, Surcouf, La Pérouse, ces villages aux noms évocateurs - créés à l'origine pour accueillir des pécheurs bretons ne semblent pas en avoir retenus beaucoup...
Jean Bart, Surcouf, La Pérouse, ces villages aux noms évocateurs - créés à l'origine pour accueillir des pécheurs bretons ne semblent pas en avoir retenus beaucoup...
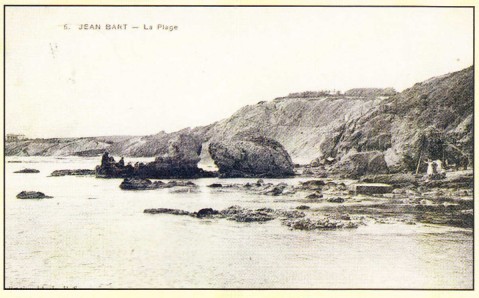
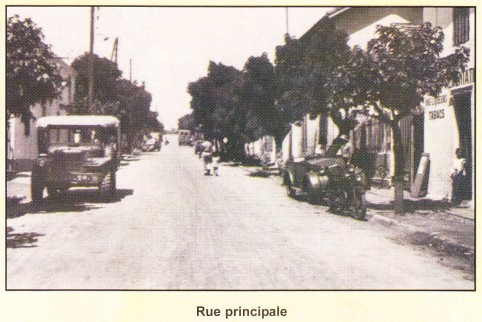
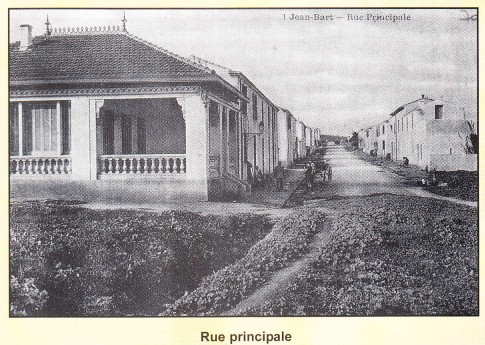
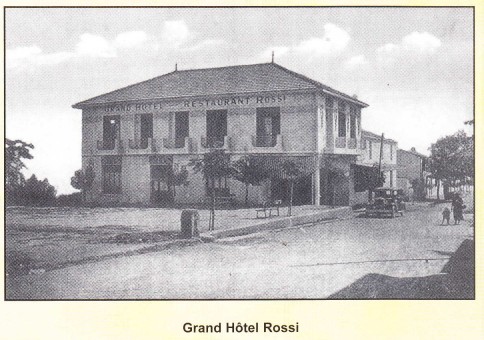
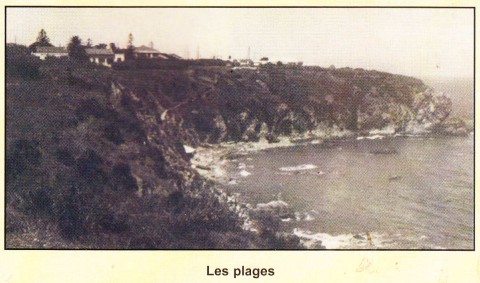
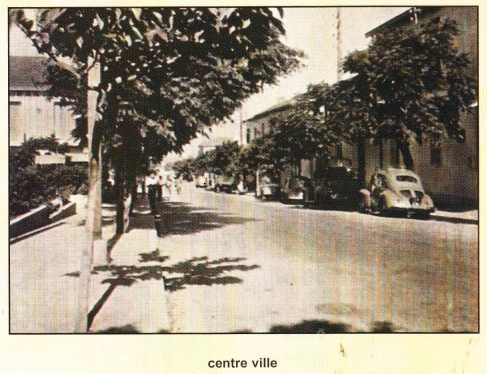
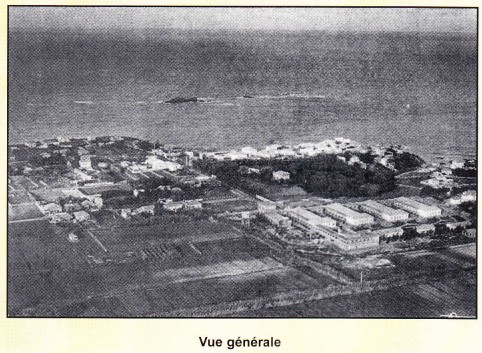
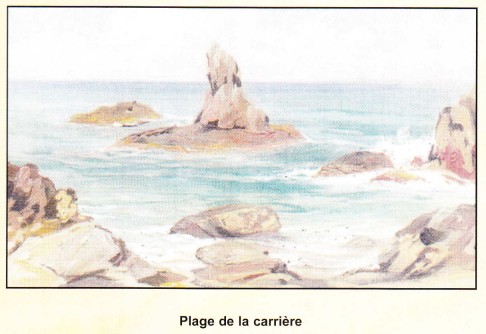 .
.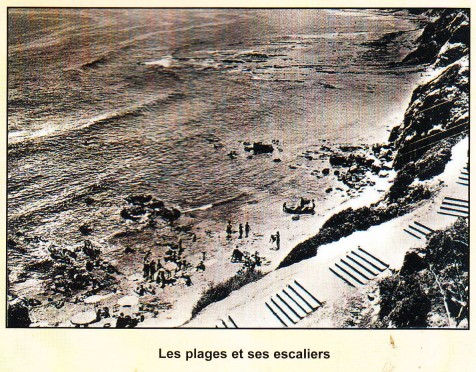
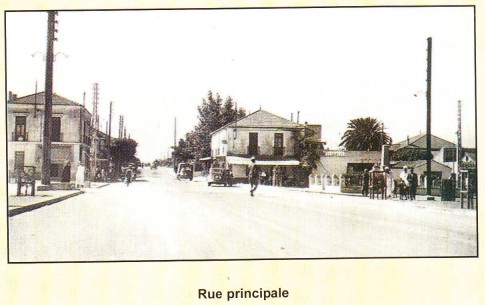
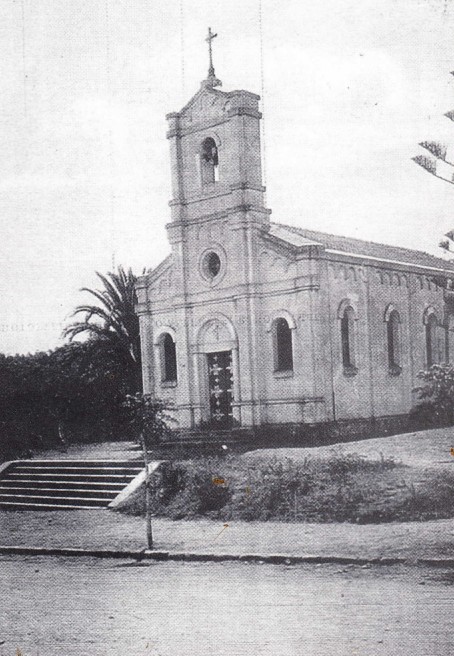
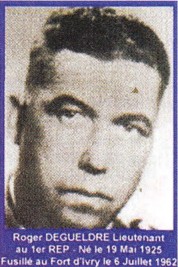 C'est un document historique, totalement inédit, particulièrement émouvant et précieux pour tous ceux qui, comme nous, s'attachent à rétablir la vérité sur le combat de ces hommes exceptionnels qui ont tout sacrifié à I’idée qu'ils se faisaient de la France, et de la parole donnée.
C'est un document historique, totalement inédit, particulièrement émouvant et précieux pour tous ceux qui, comme nous, s'attachent à rétablir la vérité sur le combat de ces hommes exceptionnels qui ont tout sacrifié à I’idée qu'ils se faisaient de la France, et de la parole donnée.
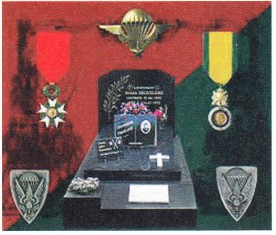 Depuis quelques temps, une campagne d'intoxication de l'opinion publique tend à minimiser, sinon ridiculiser, les décorations accrochées aux poitrines de ceux qui n'ont cessé de se battre hors d'une métropole qui voulait tout ignorer des sacrifices de l'armée. Devant de hautes personnalités militaires, il serait malvenu de ma part d'insister sur le prix du sang versé par nos soldats de métier, notamment les Légionnaires. Mais, concernant les exploits de Degueldre, je tiens au moins à préciser l'un d'eux, dont j'ai été à la fois le témoin et le bénéficiaire.
Depuis quelques temps, une campagne d'intoxication de l'opinion publique tend à minimiser, sinon ridiculiser, les décorations accrochées aux poitrines de ceux qui n'ont cessé de se battre hors d'une métropole qui voulait tout ignorer des sacrifices de l'armée. Devant de hautes personnalités militaires, il serait malvenu de ma part d'insister sur le prix du sang versé par nos soldats de métier, notamment les Légionnaires. Mais, concernant les exploits de Degueldre, je tiens au moins à préciser l'un d'eux, dont j'ai été à la fois le témoin et le bénéficiaire.
 Au nom des 2.000 Légionnaires qui, pendant les six ans de campagne de Roger Degueldre en Algérie, ont été tués sur le sol algérien, encore pour l'Honneur de nos armes - parce qu'ils ne se sont tout de même pas battus pour que le drapeau vert et blanc du FLN flotte un jour sur le quartier Vienot de Sidi-Bel-Abbès...
Au nom des 2.000 Légionnaires qui, pendant les six ans de campagne de Roger Degueldre en Algérie, ont été tués sur le sol algérien, encore pour l'Honneur de nos armes - parce qu'ils ne se sont tout de même pas battus pour que le drapeau vert et blanc du FLN flotte un jour sur le quartier Vienot de Sidi-Bel-Abbès...
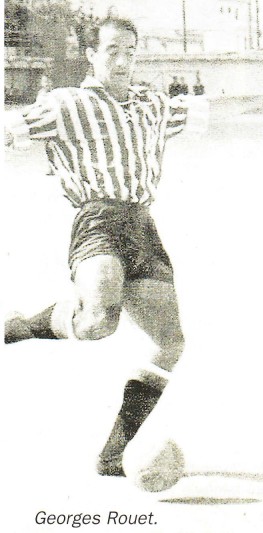 Georges Rouet se dirigea dès l'adolescence vers la natation.
Georges Rouet se dirigea dès l'adolescence vers la natation.
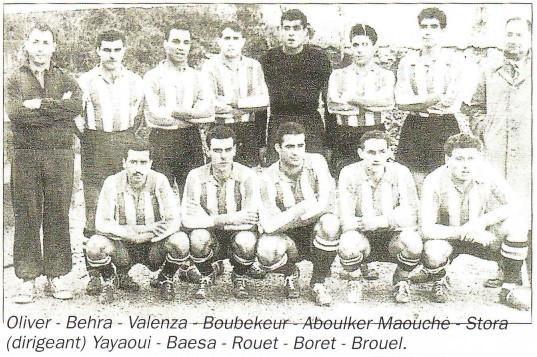
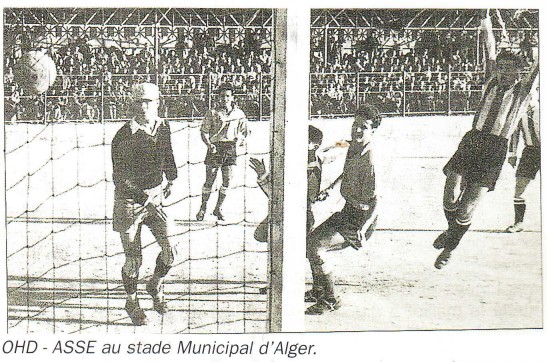

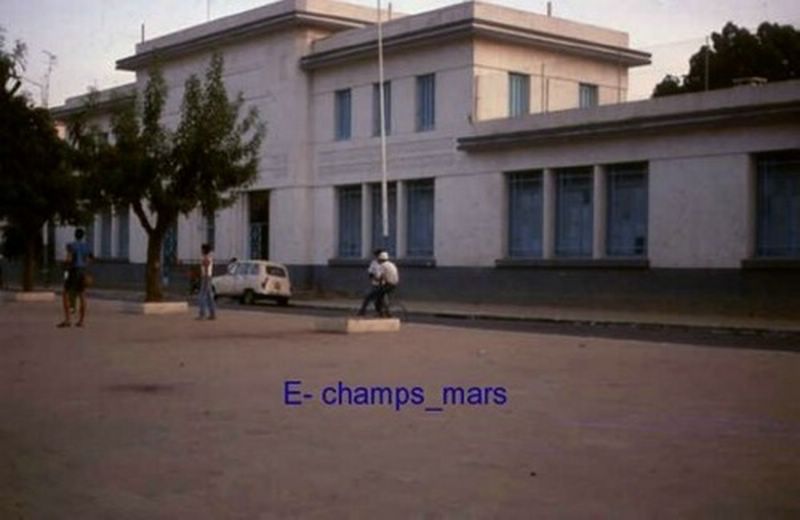





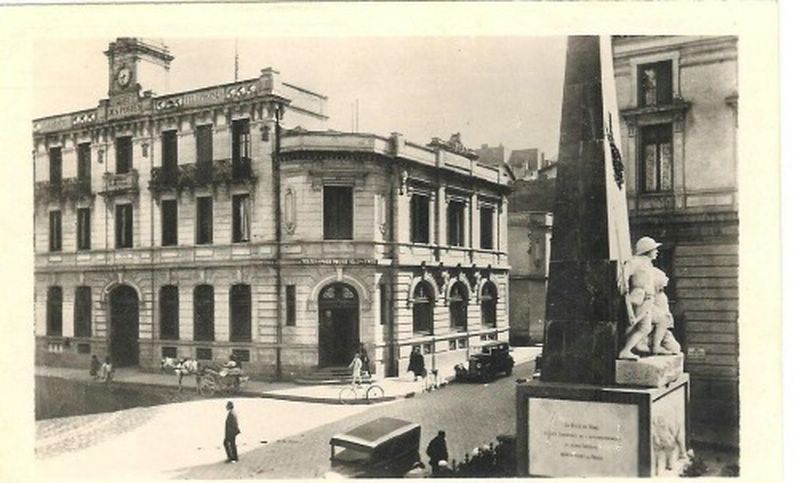




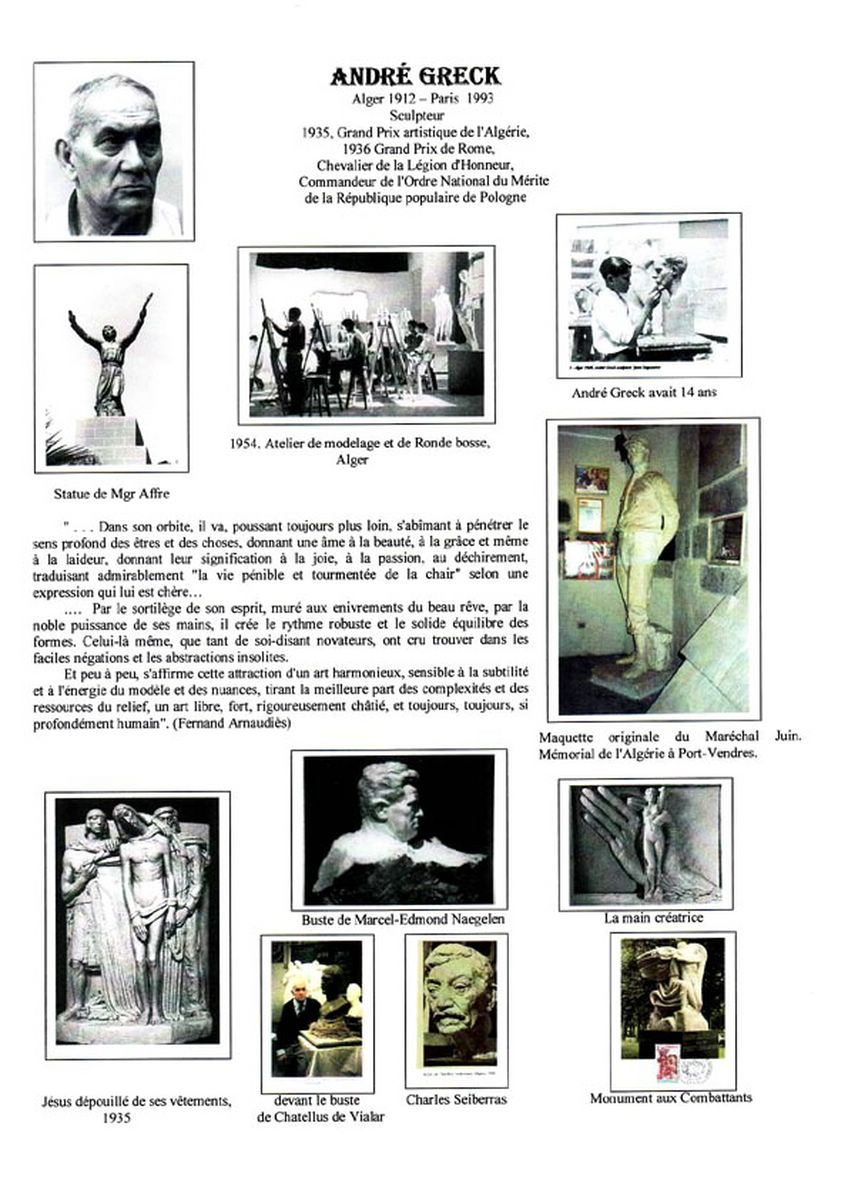
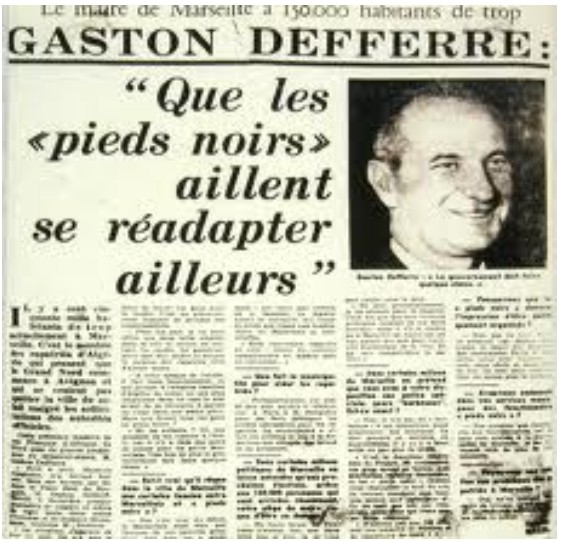

 Ils étaient tous là, serrés les uns contre les autres, appuyés à la rambarde. Le paradis dont ils avaient tellement rêvé, enfants, à travers les pages d’un livre de géographie approchait lentement et déjà ils n’en voulaient plus. Ils rêvaient à un autre paradis perdu : L’Algérie ; c’est à elle qu’ils pensaient tous à présent. Ils n’étaient pas les frères douloureux qui arrivaient pour faire panser leurs blessures, mais des étrangers. En eux remontaient des aigreurs. Le regret de ce qui n’était plus suffisait à faire revivre ce qui aurait dû être…
Ils étaient tous là, serrés les uns contre les autres, appuyés à la rambarde. Le paradis dont ils avaient tellement rêvé, enfants, à travers les pages d’un livre de géographie approchait lentement et déjà ils n’en voulaient plus. Ils rêvaient à un autre paradis perdu : L’Algérie ; c’est à elle qu’ils pensaient tous à présent. Ils n’étaient pas les frères douloureux qui arrivaient pour faire panser leurs blessures, mais des étrangers. En eux remontaient des aigreurs. Le regret de ce qui n’était plus suffisait à faire revivre ce qui aurait dû être…
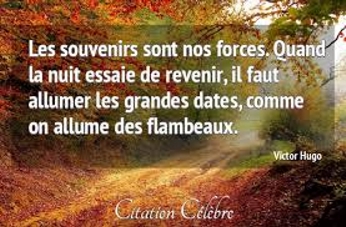
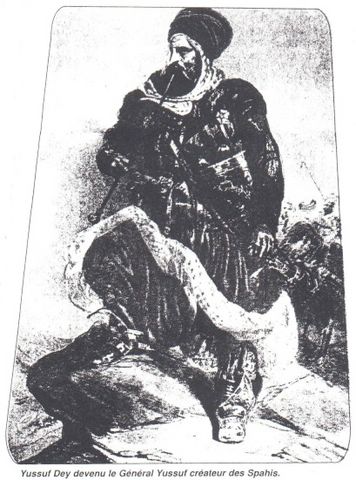 Ainsi, quand on lit maintenant dans les livres scolaires qu'en juillet 1830. Les Algériens défendirent vaillamment leur patrie, I'Algérie, on se trouve face à une double erreur. D'abord parce que le nom Algérie, n'existait pas : c'est l'administration française qui, beaucoup plus tard, créa ce terme. Ensuite, parce que, seuls, les Janissaires turcs combattirent vaillamment. Un certain nombre d'entre eux passèrent ensuite au service de la France dont un certain Yussuf, qui, plus tard, deviendra général, fondateur des Spahis algériens et, un court instant, Gouverneur de l'Algérie.
Ainsi, quand on lit maintenant dans les livres scolaires qu'en juillet 1830. Les Algériens défendirent vaillamment leur patrie, I'Algérie, on se trouve face à une double erreur. D'abord parce que le nom Algérie, n'existait pas : c'est l'administration française qui, beaucoup plus tard, créa ce terme. Ensuite, parce que, seuls, les Janissaires turcs combattirent vaillamment. Un certain nombre d'entre eux passèrent ensuite au service de la France dont un certain Yussuf, qui, plus tard, deviendra général, fondateur des Spahis algériens et, un court instant, Gouverneur de l'Algérie.
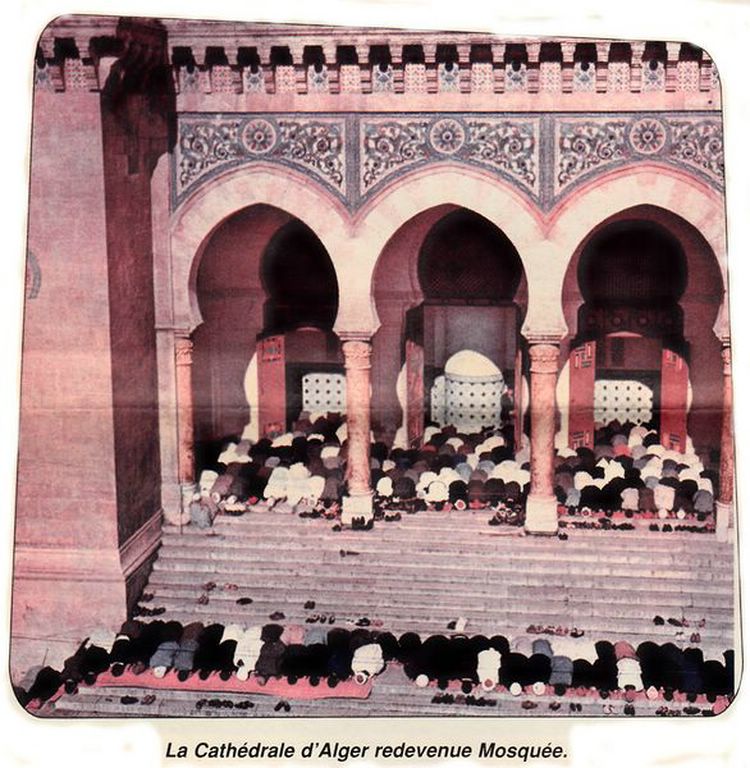 Aujourd'hui, quarante et un ans le plus beau temps des mensonges et de la lâcheté, ce M. De Gaulle, bien mort, n'est plus à même de nuire sauf s'il est imité par quelques-uns uns de ces zélés serviteurs qui lui empruntent parfois la voix et le bâton, nécessaire indispensable à toute contradiction. Il reste cependant cette Ve République dont il modifia à souhaits la Constitution pour mieux conduire son œuvre néfaste.
Aujourd'hui, quarante et un ans le plus beau temps des mensonges et de la lâcheté, ce M. De Gaulle, bien mort, n'est plus à même de nuire sauf s'il est imité par quelques-uns uns de ces zélés serviteurs qui lui empruntent parfois la voix et le bâton, nécessaire indispensable à toute contradiction. Il reste cependant cette Ve République dont il modifia à souhaits la Constitution pour mieux conduire son œuvre néfaste.
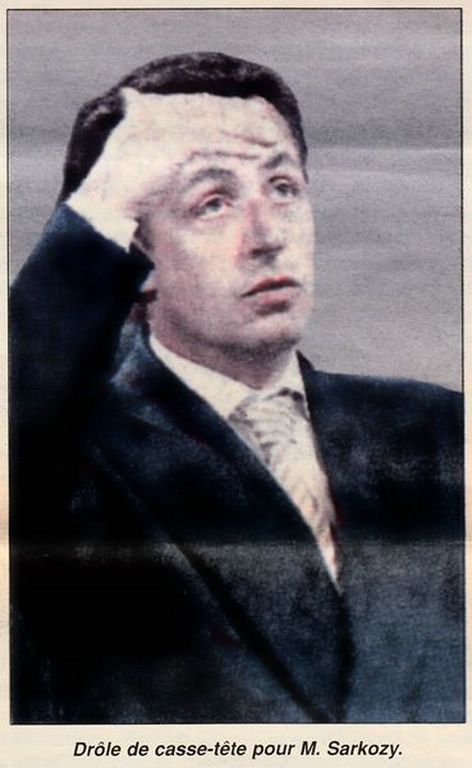 Ce n'est qu'avec l'apparition d'une presse libre, mais rare et souvent saisie, que les Algériens ont pu savoir que leur pays détenait de formidables atouts économiques, que son aisance était déjà réelle au temps de la colonisation, et que, venue l'indépendance, c'est l'ère d'une nomenklatura d'ambitieux et de corrompus qui pilla les avoirs et les richesses du pays, lequel, soumis depuis des années à un socialisme d'Etat en faillite jusqu'en U.R.S.S, ne pouvait que conduire l'Algérie à la ruine.
Ce n'est qu'avec l'apparition d'une presse libre, mais rare et souvent saisie, que les Algériens ont pu savoir que leur pays détenait de formidables atouts économiques, que son aisance était déjà réelle au temps de la colonisation, et que, venue l'indépendance, c'est l'ère d'une nomenklatura d'ambitieux et de corrompus qui pilla les avoirs et les richesses du pays, lequel, soumis depuis des années à un socialisme d'Etat en faillite jusqu'en U.R.S.S, ne pouvait que conduire l'Algérie à la ruine.


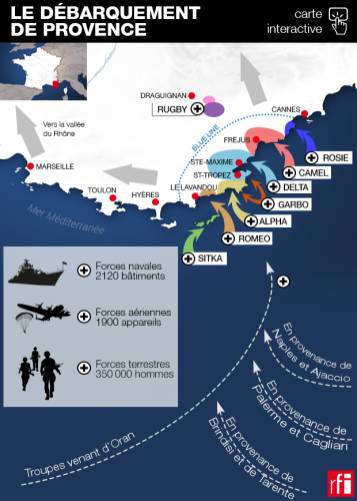
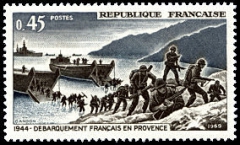 Les Français sont déjà trop portés à croire qu’ils peuvent dormir tranquilles, qu’ils n’ont qu’à s’en remettre à d’autres du soin de défendre leur indépendance ! Il ne faut pas les encourager dans cette confiance naïve qu’ils paient ensuite par des ruines et des massacres ! Il faut les encourager à compter sur eux-mêmes ! Allons, Peyrefitte ! Il faut avoir plus de mémoire que ça ! Il faut commémorer la France et non les Anglo-Saxons ! Je n’ai aucune raison de célébrer ça avec éclat. Dites-le à vos journalistes. »
Les Français sont déjà trop portés à croire qu’ils peuvent dormir tranquilles, qu’ils n’ont qu’à s’en remettre à d’autres du soin de défendre leur indépendance ! Il ne faut pas les encourager dans cette confiance naïve qu’ils paient ensuite par des ruines et des massacres ! Il faut les encourager à compter sur eux-mêmes ! Allons, Peyrefitte ! Il faut avoir plus de mémoire que ça ! Il faut commémorer la France et non les Anglo-Saxons ! Je n’ai aucune raison de célébrer ça avec éclat. Dites-le à vos journalistes. »