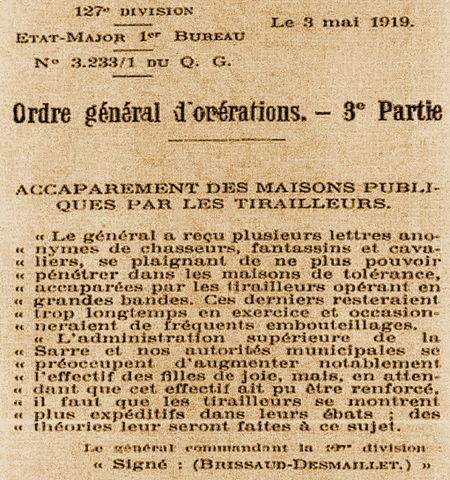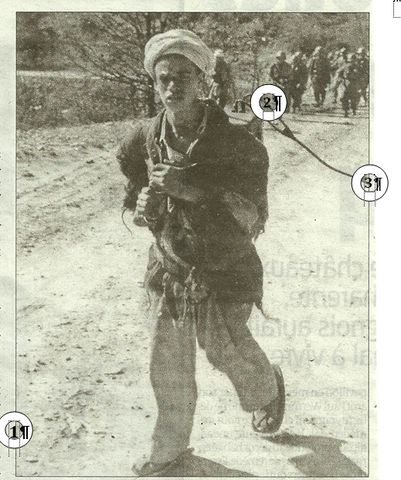|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Ecusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyrigth et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site. |
|
EDITO
LE CHOIX…, LE VRAI CHOIX…
L'élection présidentielle approchant, beaucoup d'électeurs ont déjà fait leur choix et ils rêvent déjà de leur " poulain ". Les partisans du plus grand parti de France " les abstentionnistes " n'ont pas de choix mais ils se posent aussi des questions. Cauchemar, onirisme, " idyllisme ", idéalisme, tout est possible une fois la tête sur l'oreiller.
Même si je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique politicienne et à ses mystérieux arcanes, cela m'interroge, surtout de savoir pourquoi beaucoup de français et parmi eux un grand nombre de P.N. ont choisi ce " Parti des abstentionnistes".
En revanche, je suis un père de famille et même un grand-père qui à ce titre ne voit pas d'un bon œil l'avenir qui se dessine avec des candidats qui vendent le pays, bradent ses habitants comme des futurs esclaves.
Bien sur on pourrait me rétorquer que je ne vois que du noir, mais comment vais-je expliquer à mon petit-fils de 15 ans, son avenir au travers du parcours du prochain Président de la Patosie. Comment lui faire comprendre un jour il devra partir, s'exiler de France son sol natal, parce qu'un Président ou sa suite auront pris des décisions favorisant le terrorisme, le barbarisme, le banditisme, le communautarisme antirépublicain, le laxisme, l'intégrisme de tout bord, le racisme à l'envers à cause de lois perverses, bref tous les ingrédients qui sont le creuset de la guerre civile.
C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas le problème principal du français lambda, mais l'idée est dérangeante quand on l'expose autour de soi ou dans les médias qui se font un réel plaisir à minimiser les vrais problèmes de société ou institutionnelles.
Ces médias nous bassinent à longueur de journées de sondages bidons car nous savons qu'ils sont truqués afin de nous faire croire que le seul choix possible se situe entre la Peste et le Choléra.
Deux maladies mortelles à terme. Avec la Peste, nous gagnerons 5 ans de plus de gestation ; avec le Choléra, nous entrons de suite dans la phase mortelle car n'oublions pas que les virus de la guerre civile sont déjà sur le territoire et les actes de terrorisme, non reconnus ou cachés par les autorités, se développent de plus en plus sur ce sol français. Toulouse et Montauban ne sont que des tests.
Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec la guerre civile d'Algérie, en gestation de 1945 jusqu'à son explosion en 1954 et le résultat de 1962. On peut aussi faire un parallèle en pensant aux années 30 avec la démilitarisation et l'insouciance des français qui ne pensaient qu'aux nouveaux congés payés gagnés de haute lutte, mais tout cela a amené la débâcle de 1940.
En avril/mai nous aurons un choix à faire pour l'avenir de nos progénitures et il faudra leur expliquer ce choix afin de les mettre dans le futur bain de la vie très difficile qu'ils auront à affronter.
De toutes façons, ne nous faisons pas d'illusions, tous les signaux sont au rouge, la guerre civile ou la révolution, nous y courrons tout droit. La France et l'Europe seront obligés de s'y engager devant les menaces de plus en plus précises, voyantes et exprimées. Il n'y aura pas d'autres choix pour les dirigeants de ces pays.
Devrons-nous choisir le parti de " l'abstentionnisme ", choisir les petites maladies des petits candidats ou choisir entre la petite Peste ou le Choléra mou.
Sans trahir le secret des urnes, mon choix sera d'aller voter pour tenter la sauvegarde de notre société occidentale, civilisée, républicaine et laïque.
Je souhaite que chacun se pose les bonnes questions et fasse le bon choix entre GUERRE ou PAIX deux mots qui peuvent s'inverser selon l'interprétation.
Comme pour " Shakespeare " et son fameux dilemme ÊTRE ou NE PAS ÊTRE, GUERRE ou PAIX est un dilemme assez complexe.
En effet pour les uns ce sera GUERRE contre la nocivité qui mine nos institutions afin d'avoir la PAIX,
Et pour d'autre se sera PAIX dans l'insouciance matérielle afin de subir la GUERRE qui sera terrible.
Il n'y aura plus de " C'est nous les Africains…… " pour venir défendre la Patrie.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
|
|
| Espaces des souvenirs
ECHO D'ORANIE Mars/Avril 2001 - N°285
|
Algérie, aujourd'hui je t'aime encore
Dans mes pensées, je revois tes décors,
Là-bas, une partie de mon cœur est restée,
Au fond de moi, tu restes bloquée.
On pense toujours, à nos chers parents
A nos enfances, à nos maisons
A toutes ces vies qui sont passées
Que jamais on ne pourra oublier.
Les églises torturées gardent toujours
La résonance de nos beaux jours
Comme une tombe tant de secrets
Elles garderont tous nos pêchés.
Et ce temps qui nous écrase
Et qui mélange toutes nos phrases
On se revoit dans nos errances
Une fois éparpillés en France,
Les belles années passées là-bas
Meknès, Oran, ou Annaba.
Toutes les pensées qui nous promènent
Nous laissent figés sur les mêmes scènes
Esprits malins d'Afrique du Nord
Oubliez-nous dans vos remords...
CHORRO Lucien (23 juillet 2002) d'Aïn-El-Arba
|
|
|
CONTE EN SABIR
Par Kaddour
|
|
LA LION Y LI DO MAROCANES
FABLE IMITEE DE LA FONTAINE!
On jor do Marocanes, qui n'an a pas l'arjan
Son vendre por on Anglis
La peau di lion noir, qui sont encore vivan.
" Doman, nos marchons di côté di Dellys ;
Ti coni bian Dellys ?
Bor qui ji touillé lui "
Qui dir cit, Marocane. " Cit un lion manific.
ll y gross, il y grand, y tot à fi jouli
Jami ti voir comme lui, cit comme on Bachalie,
Doman... pri doman... do jor ji soui venir,
Y ji vo port' one peau, qui ji fir bon blisir. "
L'Anglis y loui dimande, combien y fir beyer :
Y loui di çanq cents francs ; alors y son ksepter.
Tot souite y son barti por touiller la lion,
Y son marché la route, to pri di Sébaou,
Y bassi la rivière, quand y voit : ah ! mon Diou
La lion qui discend, por sarchi on moton
Por bisoan mangi loui.
L'Marocan quand y voir qui vian la lion noir
Y son por mon zami !!!
Y lisse lo l'Anglis, la peau y tot l'histoire
Y pensi bor sauvi.
On y monte sor on arbre, y l'autre y sa cochi
Barc' qu'on camarade, on fois y son provi,
Qui jami la lion y mange di bite crivi.
La lion (gran coillion !!!) y bansi qui sont mort.
Y la sant', y la torne, y mit lo su l' côté,
Apri y li ritorne por qui ji soui sur mon dos.
Dans sa poche y rigarde, si yana di douros,
Sors voir qu'il itit, tot à fi rafalé.
" Cit zomme y son crivi ! ! Ji crois y sent mauvi.
Cit one salopri qu'ja t.rovi. "
La lion y lisse lo, y marche por son mison,
Por mangi one moton.
Coui là qui son sor l'arbre, quand y voir qui son loann
Y dissend por barli afic l'autre Marocann.
" La lion y ti torne, et ti yana pas d'mal ?
Ji crois ti a la sanche, y vo protège Allah ! !
Matenant por l'Anglis, la peau yana pas ? "
" La peau ji sarche plu. Ça ji mi fot pas mal. "
" Ma ji voir la lion qui parle à ton zorille.
Quis qui dire mon zami. "
" Il y barle afic moi, comme one pire di famille.
Voilà quis qui ma dire : To si ? ni vende jami,
Quand ji soui pas touillé, mon peau à one Anglis
Barc' qui vos ites Maroc, y qui ji soui Francis. "
|
|
MES SOUVENIRS
Par Mme ETIENNE Paulette
|
|
LE MARCHE ARABE
Avec un mercredi de la rue Gambetta.
Souvent la nuit je ne dors pas et je vais me promener dans les rues de Bône. Au gré de ma fantaisie, je vais d'une rue à l'autre, d'une époque à l'autre, enfance ou adolescence confondue.
Les souvenirs de mon enfance, six ou sept ans, il y a déjà très longtemps…
Je passe du Cours Bertagna à la Colonne Randon et reviens par la Rue Bugeaud au temps où, à la place du marché actuel, était construit le Marché Arabe. Cet important édifice de style maghrébin était surmonté de quatre tours très appréciées par des couples de cigognes qui les occupaient d'avril à août.
A l'intérieur des arcades entouraient une immense cour où se promenait à longueur d'année un couple de cigognes qui blessées n'avaient pas pu repartir. Pas farouches du tout, elles déambulaient, gobant ça et là des détritus tombés à terre. Sous les arcades, de nombreuses échoppes abritaient différents commerces : fripiers, coiffeurs, barbiers qui maniaient le rasoir avec dextérité.
Je me souviens d'un marchand de racines de Pyrèthre (chrysanthème sauvage) employées dans la fabrication d'insecticide et d'un autre marchand qui lui, vendaient des peaux tannées qui dégageaient une odeur nauséabonde. Je traversais ce Marché le jeudi avec mon père qui m'emmenait, rue Gambetta, et je me retrouvais à l'air libre avec grand soulagement.
Je ne sais pas si beaucoup d'affaires s'y traitaient mais la foule était dense et devant les échoppes, circulaient des garçons du café voisin avec plateaux de thé à la menthe qui se vidaient aussitôt apparus. Les trottoirs après le marché étaient aussi hétéroclites mais j'en parlerai une autre fois.
Le Marché Arabe fût détruit dans les années 30/40 et reconstruit au début du Bd Lavigerie.
A la sortie du marché, on se dirigeait vers le bout de la rue Gambetta. Les trottoirs présentaient des commerces insolites.
- Les têtes de mouton : accroupis devant une grille remplie de braises, posée sur deux briques à même le sol, certains faisaient cuire des têtes de moutons. De temps à autre, avec un carton, ils éventaient les braises qui grésillaient joyeusement. Une appétissante odeur s'échappait. La foule qui déambulait tout autour vous enlevait l'envie d'y goûter.
- Les petits pains : En équilibre sur leurs têtes, d'autres un plateau métallique remplis de petits pains de semoule, ronds, la kesra, des vendeurs allaient de groupe en groupe proposer cette délicieuse marchandise.
- Les produits de la chasse : des mechtas voisines arrivaient des hommes avec le produit de leur chasse, bécasses, perdrix, lièvres.
Tout ce méli-mélo était étourdissant, heureusement le reste de la rue était paisible et un peu moins encombrée. On y trouvait une bourrellerie, la boucherie des frères Zammit (un autre frère était établi rue Bugeaud) et après un marchand de beignets, l'épicerie de M. Basile Ruggieri. C'est lui qui venait nous ravitailler à la Ménadia à l'époque où n'existait aucun commerce, et avant qu'il n'ouvre un café rue Bugeaud.
Au bout de la rue Gambetta, après le bureau de courtage de mon père, on avait vue sur la porte des Karézas, déjà en partie démolie.
Paulette ETIENNE
|
|
|
LE MUTILE N° 196, 6 juin 1921
|
Le train des Zouaves à Verdun
" Au bas de la côte du Poivre, devant Verdun, quand le touriste passe il voit confusément de la route lointaine un amas de ferrailles et de planches brisées. S'il se renseigne, on lui dira : " C'est ce qui reste du train qui a sauvé Verdun. ".
C'est, en effet, ce qui reste du train qu'un jour de 1916, un jour où tout était perdu, où l'ennemi dévalait les hauteurs sur la Meuse, Pétain lança en plein midi.
Ce train, mon général, transportait neuf cents zouaves. Quand il passa, ce convoi de mort, dans tonnerre et dans les flammes, les soldats de Verdun, c'est à dire des Braves ! D'admiration se prirent à pleurer ! Une rumeur montait du train... des chants, peut-être ! Que cadençaient les gros canons qui, sur lui s'acharnaient.
Il s'arrêta enfin. Les zouaves en sortirent.. ceux qui restaient. Dans un élan désespéré, ils rejetèrent l'envahisseur jusqu'au sommet de la côte du Poivre. Il n'en redescendit jamais.
Des neuf cents zouaves de Verdun, onze survivent...
Mon général, les combattants voudraient que les essieux rouillés de ces wagons détruits, que quelques roues arrachées à la terre et sauvées de l'oubli, soient apportées aux Invalides. Mieux qu'aux débris d'un zeppelin ou de gothas tueurs de femmes, leur place y es marquée à l'ombre grave du grand dôme.
"Il s'agit de reliques et non pas de curiosités. "
J. Ascione.
©§©§©§©§©§©§©
|
|
| HISTOIRE DES VILLES DE LA
PROVINCE DE CONSTANTINE N°13
PAR CHARLES FÉRAUD
Interprète principal de l'Armée auprès du Gouverneur général de l'Algérie.
|
|
LA CALLE
ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE
DES ANCIENNES CONCESSIONS
FRANÇAISES D'AFRIQUE.
Au GÉNÉRAL FORGEMOL
Ancien Capitaine Commandant supérieur,
du Cercle de La Calle
Bombardement d'Alger par Destrée en 1688
En particulier, De Tourville avait exigé l'envoi auprès de Louis XIV, d'un Ambassadeur pour lui faire ses excuses à l'occasion de la rupture de la Paix et de l'insulte qui lui avait été faite dans la personne de son Consul, Hadj Djaffer, Agha, fut désigné pour ce message. Le Dey fit précéder son représentant d'une Lettre adressée au Roi de France, et de deux autres pour ses Ministres. Sur la Lettre au Roi, on lisait :
" Au plus glorieux des grands Princes chrétiens, qui est élu par les magnifiques Souverains de la loi de Jésus, pour médiateur des affaires qui surviennent entre les peuples Chrétiens, qui est revêtu de la robe de la Majesté comme le possesseur de l'honneur et de la gloire, l'Empereur de Fiance, Louis, à qui Dieu veuille donner un heureux succès en ses entreprises, et le conduire incessamment dans les droites voies. Double sens signifiant qu'il embrasse bientôt la religion musulmane.
" De la part de l'illustre et magnifique Hadji Hassein Dey, de la Ville et Royaume d'Alger, Dieu augmente sa prospérité et perpétue Sa Grandeur.
" Après avoir souhaité à Votre Majesté le Salut et la Paix qui accompagnent ordinairement ceux qui suivent le chemin de la vérité, nous vous disons, Sire, que le sieur Chevalier de Tourville, Lieutenant général des Armées navales de Votre Majesté étant venu en nos côtes, nous nous sommes attachés avec toute l'assiduité possible pour conclure avec lui une bonne Paix ; enfin, nous en sommes convenus de part et d'autre au contentement de toute la Milice et nous avons fait des réjouissances publiques pour ce sujet; c'est pourquoi Hadji Djaffer, Sénateur de la Régence, a été choisi pour Ambassadeur d'Alger auprès de Votre Majesté. Il lui fera savoir comme notre Traité de Paix a été juré solennellement en plein Divan, avec un applaudissement général et qu'ainsi, il doit être permanent et stable à jamais, en sorte que ceux qui agiront au contraire seront traités de perturbateurs et traités comme tels.
" Il doit encore marquer à Votre Majesté que le Dey qui m'a précédé dans cette dignité a manqué en deux points : le premier est d'avoir rompu de lui-même la Paix avec l'Empereur de France, sans prendre conseil de personne et contre le consentement de tout le monde ; la seconde faute qu'il a faite, est d'avoir, par la crainte de vos bombes dont on aurait tiré environ 500 sur Alger, rendu inutilement 55 Esclaves que nous gardions entre nos mains comme un gage très précieux ; mais cette lâche peur qui le saisit fut causée par le bon astre qui accompagne partout les armes de Votre Majesté.
" Il y a encore une chose à dire qui est que celui qui commandait en ce temps là votre Armée navale ne sut pas se servir de l'influence de ce bon astre qui formait cette favorable conjoncture pour conclure alors une Paix qui aurait apporté, à Votre Majesté, une gloire immortelle, et l'exil de mon prédécesseur s'en suivit ainsi que l'assassinat de Baba Hassan.
" Alors, je fus élu pour être en leur place ; mais Sire, dans l'honneur où je me trouve, je ne veux pas encourir le malheur d'être dans la disgrâce du plus grand Empereur des Chrétiens.
" Je fus obligé, pour me délivrer de l'importunité d'un grand nombre de gens de notre Milice rebelle, qui demandaient le paiement des Esclaves qu'on leur avait ôtés, de débourser 400 mille écus, et leurs discours aussi bien que ceux de tous les autres gens de guerre était que celui qui commandait alors l'Armée de Votre Majesté, ne devait pas en user comme il fit après avoir reçu un si bon nombre d'Esclaves. Nous payâmes véritablement le prix des Esclaves à leurs patrons ; mais, Sire, il ne fut pas en notre pouvoir d'arrêter la furie de la Milice soulevée, ni d'empêcher l'action infâme qu'elle commit envers le Consul de France et quelques autres, comme vous dira bien mieux notre Ambassadeur, quand il aura l'honneur d'être en la présence de Votre Majesté.
"Nous avons fait plus que notre possible pour terminer notre Paix ; Dieu veuille qu'elle soit ratifiée et qu'elle demeure stable à jamais. Nous avons promis et promettons de rendre généralement tous les Français qui se trouveront dans les États d'Alger ; nous prions aussi Votre Majesté de nous faire la grâce de nous renvoyer tous les Algériens qui sont dans les galères de France, afin que les Esclaves de l'un et l'autre Royaume se trouvent contents et rendent grâce de leur liberté. Cela étant exécuté, il n'y aura rien au monde de plus juste que la ratification et la stabilité de notre Paix, puisque n'y ayant aucune raison contraire, on sera à l'ombre de l'amitié et de l'intelligence ; et, aujourd'hui, nous demandons l'amitié de la France et nous n'avons point de plus grand désir que de l'obtenir, puisque son Empereur est le médiateur des affaires de tous les peuples Chrétiens, le plus puissant de tous les Rois, le plus majestueux et le plus formidable comme il est marqué dans notre Traité.
" Nous supplions très humblement Votre Majesté de donner foi et créance à tout ce que notre Ambassadeur dira de notre part et même de ne pas lui refuser ce dont il aura l'honneur de vous prier, parce que nous jurons et promettons que ce Traité de Paix a été écrit du consentement général de toute notre Milice ; et pourvu que nos Sujets n'y contreviennent pas, nous tiendrons à honneur et aurons un singulier plaisir d'être de vos amis, et derechef, nous jurons par le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qu'il ne se passera jamais rien de contraire à cette foi que nous donnons et au Traité dont nous sommes convenus et qui sera observé de point en point. Je prie Dieu qu'il bénisse ceux qui suivent les voies de la vérité.
" Le Magnifique HADJ HASSEIN, Dey d'Alger. "
L'Ambassadeur fut accueilli, à Marseille et à Paris, avec les plus grands égards. Admis en la présence du Roi, il dit :
" Très heureux, très excellent, très puissant, très magnanime et très invincible Prince Louis XIV, Empereur des Français,
" Dieu perpétue ton règne et ta prospérité !
" Je viens aux pieds de ton sublime Trône impérial, pour t'exprimer la joie de notre République et du Dey, mon maître, d'avoir conclu la Paix avec ton Lieutenant, et le désir ardent qu'ils ont qu'il plaise à Ta Haute Majesté d'y mettre le sceau de ton dernier consentement.
" La force de tes armes très puissantes et l'éclat de ton sabre toujours victorieux leur ont fait connaître quelle a été la faute de Baba Hassan d'avoir osé déclarer la guerre à tes Sujets, et je suis député pour t'en venir demander pardon et te protester que nous n'aurons, à l'avenir, d'autres intentions que de mériter, par notre conduite, l'amitié du plus grand Empereur qui soit et qui ait jamais été dans la loi de Jésus et le seul que nous redoutions.
" Nous pourrions appréhender que l'excès détestable commis en la personne de ton Consul ne fut un obstacle à la Paix, si ton esprit, dont les lumières semblables au soleil qui pénètre toute chose, ne connaissait parfaitement de quoi est capable une populace émue et forcenée, au milieu de ses concitoyens écrasés par les bombes, où se trouvaient des pères, des mères, des enfants et des frères, de se voir enlever des Esclaves, le plus beau de ses biens; à qui, pour comble de malheur, on refuse en échange la liberté de ses compatriotes qu'elle avait justement espérée. Quelques motifs que puisse avoir cette violente, je te viens prier de détourner pour jamais tes yeux sacrés de dessus une action que tous les gens de bien parmi nous ont détestée, particulièrement les Puissances, et qu'il ne serait pas raisonnable de leur imputer, Nous espérons, ô grand Empereur, cette grâce de tes bontés.
" Et même dans la haute opinion que nous avons de ta générosité incomparable, nous n'avons garde de douter que tu nous rendras libres tous ceux de nos Frères qui se trouvent arrêtés dans les fers, comme nous remettrons en pleine liberté tous ceux de tes Sujets qui sont entre nos mains, et même tous ceux qui ont été honorés de l'ombre de ton nom, afin que la joie de cette heureuse Paix soit égale et universelle.
" Et de cela que demandons-nous, sinon d'ouvrir un plus grand nombre de bouches à ta louange, et que dans le temps que les tiens rendus à leur patrie te béniront prosternés à tes pieds, les nôtres se répandront dans le vaste pays d'Afrique, allant y publier ta magnificence ,et semer dans le cœur de leurs enfants une profonde vénération pour tes vertus incomparables. Ce sera le paiement d'une éternelle Paix que nous conserverons, de notre part, par une observance exacte et religieuse de toutes les conventions sur lesquelles elle a été établie, ne doutant point que par l'observance parfaite que tu lui fais rendre, tes Sujets ne prennent le même soin de la conserver.
" Veuille le Créateur tout puissant et tout miséricordieux y donner sa bénédiction et maintenu une union perpétuelle entre le très heureux, très excellent, très puissant, très magnanime et très invincible Louis XIV, Empereur des Français et Nous illustre et magnanime Dey, Pacha, Divan et invincible Milice. "
Louis XIV répondit au Dey le 17 juillet 1684 :
" Illustre et magnifique Seigneur, nous avons reçu par les mains d'Hadji Djaffer, Agha, que vous avez envoyé auprès de Nous, la Lettre que vous nous avez écrite, et il nous a encore expliqué de bouche le déplaisir que Vous et la République d'Alger avez eu d'avoir rompu les Capitulations qui avaient été faites par mes ordres et la ferme résolution dans laquelle vous êtes d'entretenir inviolablement celles qui ont été faites, en dernier lieu, avec le Chevalier de Tourville, l'un de mes Lieutenants généraux dans nos Armées navales. C'est aussi ce qui nous fait oublier les justes sujets de plainte qui vous avaient attiré les effets de notre ressentiment ; et comme nous avons fait connaître audit Hadji Djaffer, Agha, nos intentions sur ce qui vous regarde et l'approbation que nous donnons à ce qui vous a été promis en notre Nom, nous ne faisons la présente plus longue que pour prier Dieu qu'il vous ait, Illustre et magnifique Seigneur, en sa garde.
" Fait à Versailles, le 17 juillet 1684.
" Louis. "
L'échange des Esclaves et la ratification, par le Roi, se firent attendre deux mois ; les Puissances d'Alger en témoignèrent plusieurs fois leur étonnement et même leur mécontentement, à Dussault, le 1er juillet 1684: " Nous sommes forts en peine de ce qu'il y a un si grand retardement dans nos affaires ne sachant point quelle en peut être la cause. Le Traité que nous avons fait avec vous ne porte pas que les choses doivent aller ainsi. C'est pourquoi pressez-en l'expédition avec diligence, aussitôt que vous aurez reçu cette Lettre d'amitié qui vous est écrite et prenez soin, selon votre prudence, que tout aille bien. Prenez active-ment garde aux choses qui vous ont été recommandées, qu'elles ne sortent point de votre mémoire et ne les négligez pas. Mais surtout, mon cher ami, si vous venez sans eux, à la fi n vous en porterez la peine. Au reste, le salut soit sur ceux qui prennent le bon chemin: "
A la réception de cette lettre, Dussault demanda le 1er août 1684, au Ministre de la Marine, les ordres du Roi pour l'entière consommation du Traité dont l'exécution lui était commise par l'Article 4. Il le prévint également que le Dey en exigerait la ratification par le Roi puisque c'était une des clauses exprimées dans l'Article 29 et il ajoutait : " Le Dey vous a écrit, Monseigneur, sur ce qui regarde les véritables moyens de parvenir à une entière Conciliation, qui sont, de faire en sorte qu'il ne reste aucun sujet du Roy entre leurs mains, ni sur les galères du Roy aucun des leurs. Il y a 300 Français esclaves et 246 Turcs sur les galères, non compris 54 Turcs invalides ; ainsi l'échange peut se faire sans difficulté.
" Il plaira au Roy de nommer un Consul à qui le Roy ou le Commerce donnera de quoi subsister.... Les Algériens rendirent aussi une partie des canons que Beaufort avaient abandonnés à Gigelli.
Après la conclusion de la Paix, de Tourville prescrivit de la part du Roi, à Sorhaindre, Gouverneur provisoire du Bastion, de venir exercer les foncions de Consul à Alger jusqu'à ce qu'il plut au Roi de nommer un titulaire, ce qui n'eut lieu qu'au Lois de juin 1685, par l'envoi de Piolle qui afferma le Consulat 1,500 livres et dont les Esclaves n'eurent pas à se louer.
A cette même époque, le Roi écrivit la Lettre suivante au Pacha d'Alger :
" Illustre et magnifique Seigneur, les plaintes continuelles que nous recevons des abus qui se commettent dans le Commerce que font nos Sujets, nous ayant fait prendre la résolution d'y envoyer le sieur Dortières pour établir l'ordre et la police nécessaires parmi les marchands Français qui y trafiquent ou qui y sont domiciliés, nous vous faisons cette Lettre pour vous en donner avis et pour vous dire en même temps que vous nous ferez plaisir de donner, au dit Dortières, toute l'assistance et protection dont il aura besoin pour l'exécution de nos Ordres et une créance entière à tout ce qu'il vous dira de notre part.
" Louis. "
Les instructions remises à cet Inspecteur du commerce étaient ainsi conçues :
" A Versailles, le 15 août 1685.
" S. M. ayant fait choix du sieur Dortières pour visiter toutes les Échelles du Levant, y prendre connaissance et régler les affaires concernant le commerce de ses Sujets, elle veut que, sur les informations qu'il prendra de la conduite des Français qui y sont établis, il fasse embarquer sur les bâtiments qui en partiront pour France, ceux dont les mœurs pourraient causer des troubles parmi les marchands de la Nation qui y font commerce. Enjoint S. M. à tous Capitaines, Patrons de vaisseaux, barques et autres bâtiments, de les recevoir sans difficulté pour les repasser à Marseille et de les consigner, à leur arrivée, entre les mains des Officier, de l'Amirauté de la dite Ville.
" Extrait de l'instruction donnée à Dortières. "
" S. M. voulant remédier par toutes sortes de moyens aux abus et malversations qui se sont glissées dans le commerce et mettre le même ordre dans les Échelles qu'elle a fait établir partout ailleurs, elle a fait choix du dit sieur Dortières pour se transporter dans tous les lieux du Levant où ses Sujets font commerce, s'y faire rendre compte par les Consuls de la Nation Française qui auront ordre de le reconnaître et de lui obéir, de tout ce qui s'y passe et examiner leur conduite et celle des marchands Français qui y sont établis et généralement dresser des mémoires exacts de tout ce qu'il croira le plus avantageux pour perfectionner et augmenter le commerce des Français et détruire celui des Étrangers.
" S. M. étant informée que beaucoup de marchands Français de mauvaises mœurs, après avoir fait banqueroute en France, se retirent dans les Échelles, où ils font non seulement des commerces illicites, mais même rendent la Nation méprisable par leur mauvaise foi et leur mauvaise conduite, a fait rendre une Ordonnance qui leur défend de passer en Levant pour s'y établir, qu'après avoir été examinés et reçus par la Chambre de commerce établie à Marseille, à l'exécution de laquelle le dit sieur Dortières tiendra soigneusement la main, comme aussi à celle qui a été rendue sur les plaintes qui ont été faites que la plupart des Capitaines, Écrivains et Matelots des équipages des vaisseaux marchands, qui vont trafiquer au Levant, embarquent, pour leur compte, des marchandises du crû du Royaume; et, lorsqu'ils sont arrivés dans les Echelles, les vendent vil prix, pour en avoir un plus prompt débit. Employant ensuite à des achats de peu de conséquence le fond qu'ils ont retiré de la vente de leurs marchandises, ils les font enchérir, et obligent, par ce moyen, les principaux Marchands à payer sur le même prix les marchandises qu'ils traitent avec les Turcs, ce qui étant très préjudiciable au commerce que les Français font au Levant, il leur est défendu, à l'avenir, de traiter avec les Turcs, ni d'acheter aucune marchandise que par le canal des Marchands de la Nation qui y sont domiciliés. "
Les difficultés pécuniaires n'étaient pas les seules épreuves qui attendaient Piolle au Consulat d'Alger, quoiqu'elles ne fussent pas des plus légères. Malgré le Traité récent, les pirateries incessantes des Corsaires, sur les vaisseaux Français, provoquaient de nombreuses réclamations du Consul auprès des Puissances, qui se montraient sourdes à toutes ses demandes.
Il en fut bien autrement encore lorsque Mezzomorto, au commencement de 1686, céda, pour devenir Pacha, sa place de Dey à Ibrahim Khodja, d'un caractère entreprenant, aventureux, cruel, cupide et jaloux de la faveur de la Milice.
Piolle ayant à se plaindre de son Trucheman, nommé Mercadier, Renégat de Marseille, en sollicita un autre, au choix du Dey, quoique d'après les conventions précédemment arrêtées il eût le droit de prendre qui il voudrait. Ce changement lui fut refusé obstinément.
Le Gouvernement de France, fatigué de tant d'audace des Corsaires et des plaintes des Négociants, envoya M. de Blainville avec une Escadre, à Alger, au mois d'août 1686, pour exiger les satisfactions convenables; Les Puissances en firent immédiatement quelques-unes et promirent de réparer les antres griefs ; mais à peine le Commandant Français eût-il repris le large, les mêmes déprédations recommencèrent avec la même violence.
La négociation entreprise par le Duc de Mortemart, dans les premiers jours de janvier 1687, n'eût pas un meilleur effet que celle de M. de Blainville ; à cette occasion, M. Montmasson, Vicaire-Apostolique à Alger, qui, conduit par son zèle, avait quitté la cure de Versailles pour aller succéder au malheureux Le Vacher, dont il devait bientôt subir le même sort, mandait au Ministre, le 16 janvier 1687 :
" Depuis le départ de M. le Duc, les Puissances d'Alger se sont assemblées pour délibérer si elles feraient la guerre à la France ou à l'Angleterre. Elles l'auraient faite aux Anglais, s'ils ne leur eussent fourni abondamment ce qui est nécessaire pour la faire aux Chrétiens ; depuis peu, en effet, il est arrivé deux vaisseaux de guerre de cette Nation qui ont déchargé quantité de poudre, de plomb et autres choses nécessaires pour l'équipement des vaisseaux. Je crains bien qu'après qu'ils seront bien approvisionnés, elles ne leur déclarent la guerre, comme elles l'ont fait aux Hollandais elles n'osent la faire à la France. Mezzomorto ne répondit fièrement, lorsque les vaisseaux du Roy parurent devant Alger, que parce qu'il craignait qu'Ibrahim Khodja, qui devait arriver de Tunis avec le Camp, ne le taxât de lâcheté. "
Le 22 avril, le Vicaire Apostolique écrivait encore : " Le Dey a voulu deux fois déclarer la guerre à la France, y étant porté par les Corsaires d'ici; qui se plaignent fort de ce qu'ils ne font plus rien en mer, Mais le Pacha s'y est toujours fortement opposé, et, depuis peu de jours, j'ai appris d'une personne discrète qu'il lui avait demandé, par grâce, qu'il ne parlât point de guerre avec la France tant qu'il vivrait, qu'il savait, par expérience, combien on la doit redouter ; mais comme le Dey ne l'a point expérimentée, je ne sais s'il s'y arrêtera. Quoiqu'il en soit, on ne parle de rien à présent. "
Si le Dey ne faisait pas connaître ouvertement ses dispositions hostiles à la France, il n'en tolérait pas moins les actes de piraterie à cause des profits qui lui en revenaient; il faisait acheter les marchandises des Chrétiens au prix que lui suggérait son caprice, et obligeait les gens du Pays de les prendre pour une valeur bien supérieure.
Le 15 juillet 1687, les Corsaires, la plupart appartenant au Pacha et au Dey, entrèrent dans le port d'Alger, amenant 95 Français. Vers la fin de cette année, le Ministre de la Marine ordonna une chasse à outrance contre tout Corsaire Algérien qui serait rencontré dans la Méditerranée. Le Pacha, à titre de représailles, fit conduire les Français, d'Alger, au nombre de 372 et le Consul au bagne, et, le lendemain de leur arrestation, ils furent emmenés enchaînés à la montagne pour briser des pierres ; on ne leur laissa que la chemise sur le corps. Le Représentant de la France fut exposé à toutes sortes d'insultes de la part de la populace ; sa maison fut pillée, tous ses effets furent vendus, ainsi que onze bâtiments Français qui se trouvaient dans le port. Persuadé qu'une insulte aussi grave ne resterait pas impunie, le Dey fit fortifier, en toute hâte, le port et élever de nouvelles forteresses pour en garantir l'approche.
M. Montmasson ne fut pas compris dans Cette proscription générale : on lui laissa la liberté de porter aux Français les consolations que réclamait leur triste position, et de leur fournir tout ce qu'il trouvait à sa disposition....
Dassault, qui dirigeait toujours les Affaires du Bastion, chercha à se porter médiateur entre la France et les Puissances d'Alger, et, dans ce but, il se rendit à Alger ; il trouva Mezzomorto assez bien disposé, mais Ibrahim Khodja se montra intraitable. Quelque temps après, le 28 avril 1688, il écrivit encore pour les engager, au nom de leurs plus chers intérêts, à ne pas attirer sur leur ville la colère du Roi et à envoyer demander la Paix. Le 27 mai, il en reçut cette réponse étrange et bien oublieuse des services passés :
" A Dussault,
" Nous, Pacha, Dey et Divan, nous avons reçu vos impertinentes lettres ; nous voudrions bien savoir d'où vient que vous vous émancipez à nous donner des conseils. Si pareille chose vous arrive dans la suite, nous pourrions vous en faire repentir ; c'est vraiment bien à un marchand, comme vous êtes, à se mêler des affaires d'État. Nous ne vous avons jamais donné des ordres pour agir de cette, façon, nous ne pensons pas non plus que vous en ayez de l'Empereur, votre maître : ainsi c'est bien mal à propos que vous vous êtes voulu ingérer de nous donner des conseils salutaires, ainsi que vous dites; vous ne devez pas avoir d'autres vues que votre Commerce et non pas vous ériger en homme d'État. Nous voulons bien vous avertir charitablement que même quand nous viendrions à terminer les Affaires avec l'Empereur, votre maître, nous n'entendrons jamais que vous soyez chargé de la moindre chose touchant la Négociation, ni même que vous puissiez mettre pied à terre ; suffit que le Pacha et Nous, vous connaissions de longue main pour un homme plus propre à brouiller les Affaires qu'à les raccommoder : ainsi, attachez-vous uniquement à mettre votre Commerce sur pied. "
Toute espérance de soumission se trouvant évanouie, il ne restait plus qu'à recourir à la force ; or, Louis XIV, qui venait de réduire Tripoli et Tunis et de les soumettre à une contribution, ne pouvait laisser Alger apporter impunément une perturbation considérable dans les Relations commerciales que la France entretenait avec les Contrées situées sur la Méditerranée, et sa Flotte reçut l'ordre de sortir de Toulon.
Dès que l'on connut, à Alger, la déclaration de Guerre de la France, le Pacha pourvut à la défense du Pays : il fit commencer la construction d'un fort au Cap Matifou. Les Corsaires eurent ordre de rentrer, on les démâta et on coula les plus gros pour les mettre à l'abri des bombes.
Les habitants d'Alger, ayant encore peur des bombes, se hâtèrent d'emporter à la campagne tous leurs effets, de sorte qu'il ne resta que fort peu de monde dans la ville avec la Milice.
Arrivé devant Alger, vers la fin de juin 1688, le Maréchal d'Estrées s'occupa de faire placer, aussitôt que le temps le permit, les galiotes à bombes, et, dès le 26, neuf occupaient leur position, soutenues par neuf vaisseaux.
Le 29, on amena à bord du vaisseau amiral le Magnifique, deux Esclaves qui s'étaient sauvés à la nage ; ils racontèrent qu'il y avait dans la ville trois partis : celui du Dey, qui se trouvait au Camp devant Oran ; celui de Mezzomorto, Pacha, qui se trouvait en ville, et celui des indifférents qui n'était favorable ni à l'un ni à l'autre des premiers et qui voudrait peut-être les ruiner tous deux ; que Mezzomorto inclinait pour la Paix, mais qu'étant surveillé par, les amis du Dey qui ne la voulaient pas, il se conformait à leurs sentiments et menaçait, tout haut, de faire mettre les Français au canon si les bombes étaient lancées sur la ville.
Cet avis détermina l'Amiral Français à faire porter sur une machine, que l'on conduisit presque jusqu'à terre, la déclaration suivante attachée à une planche sur du parchemin :
" Le Maréchal d'Estrées, Vice-amiral de France, vice-Roy d'Amérique, Commandant l'Armée navale de l'Empereur de France, déclare aux Puissances et Milices du Royaume d'Alger que si, dans le cours de cette guerre, on exerce les mêmes cruautés qui ont été ci-devant pratiquées contre les Sujets de l'Empereur, son maître, il en usera de même envers ceux d'Alger, à commencer par les plus considérables qu'il a entre les mains et qu'il a eu ordre d'amener pour cet effet avec lui. " Ce 29 juin 1688,
" Le MARÉCHAL D'ESTRÉES. " Par commandement :
" BLOT, Secrétaire, "
Le Capitaine d'un vaisseau Anglais, mouillé tout près de la ville, fut chargé d'apporter la réponse sur le revers de l'écrit de l'Amiral Français, avec une Lettre du Pacha pour les Turcs embarqués sur les vaisseaux et les galères ; Mezzomorto disait au Maréchal :
" Vous dites que si nous mettons les Chrétiens à la bouche du canon, vous mettrez les nôtres à la bombe ; eh bien ! si vous tirez des bombes, nous mettrons le Roy des vôtres au canon ; et si vous me dites : qui est le Roy ? c'est le Consul Ce n'est pas parce que nous avons la guerre, c'est parce que vous tirez des bombes. Si vous êtes assez forts, venez à terre ou tirez le canon avec les vaisseaux. "
Le 1er juillet, le calme ayant succédé à un vent Nord-Est assez frais, à la pointe du jour on fit avancer cinq galiotes. On ne tira que 95 bombes en deux heures et les ennemis 240 coups de canon. La brise ou le vent du Nord étant venu à son ordinaire, on fut obligé de se retirer.
" Cet essai, dit d'Estrées dans son rapport, n'a pas laissé de faire connaître, à ceux d'Alger, que l'on peut mettre leur ville en poudre, et j'espère que cette crainte les portera aux choses que l'on désire.
" Dans le temps que chacun se retirait, on entendit huit coups de canon sans balles et une salve de mousqueterie tirée du Fanal d'Alger. On ne douta pas que ce ne fut l'effet des menaces de Mezzomorto ; plusieurs même de nos officiers auraient juré avoir vu des bras et des jambes en l'air, Il est aisé de juger combien nous fûmes affligés d'une telle barbarie, et même de la revanche qu'il en fallait prendre ; mais, comme on jugea dans le Conseil de guerre des Officiers généraux que j'avais assemblé pour déterminer la manière de la faire, qu'il était à propos d'être informé du fait et de toutes les circonstances, avant que d'en venir à une, telle exécution, je chargeai le sieur de Pointis d'aller au vaisseau Anglais, avec des chaloupes armées pour en apprendre la vérité. Il n'était pas à moitié chemin que l'Écrivain de ce vaisseau le vint joindre et m'apporta plusieurs Lettres, entre autres un Écrit signé du Consul et de plusieurs Français.
" Il est aisé de juger combien cette résurrection nous fit plaisir, et l'on conclut de la manière dont ces Lettres étaient écrites, que le Pacha et ceux d'Alger n'étaient pas si résolus ni si méchants qu'ils le voulaient paraître. Entre ces Lettres, il y en avait une pour M. d'Amfreville, d'un marchand de Marseille nommé Toucas. J'obligeai M. d'Amfreville de répondre qu'il ne fallait se flatter, en aucune manière, que je pusse faire autre chose qu'exécuter les ordres que j'avais reçus; que rien ne m'empêcherait de faire tirer les 11,000 bombes que nous avions avec nous, et que si l'on était assez barbare pour en venir à l'extrémité qu'ils disaient, on saurait bien les venger, et que cette cruauté aurait de terribles suites ; que j'étais fort en colère de l'insolent Écrit du Pacha et résolu de pousser toutes choses à bout ; cependant que s'ils faisaient des propositions on les écouterait, et que, de ma part, c'était tout ce que je pouvais faire que de leur donner cet avis. "
Le 2 juillet, et onze heures du soir, le Renégat Mercadier se présenta à bord du vaisseau Amiral, apporta plusieurs Lettres des Français qui témoignaient plus de frayeur que par les premières. Le Maréchal dit à l'envoyé :
" Je n'ai que faire de lire ces Lettres, puisqu'il n'y a pas de remède è apporter ; que l'on m'envoie des Députés à mon bord pour me faire des propositions, sans cela, je ne pourrai faire discontinuer de tirer des bombes, et, dès que le calme le pourra permettre, on recommencera aussitôt. Et comme il m'apprit, à dessein de nous étonner, qu'on avait mis trois matelots Français au canon, je donnai ordre sur-le-champ d'aller prendre dans la flotte trois Turcs, pour les faire passer aujourd'hui par les armes à la vue de toute la ville.
" Cependant, s'il était ami de Mezzomorto, comme on disait, il le devait informer promptement de ma résolution et que, si les choses allaient plus loin, on mettrait cette ville en poudre et qu'on ruinerait, après, tous leurs vaisseaux à la mer, sans qu'ils pussent jamais espérer la Paix. "
" Le 3, à 10 heures du matin, pour représailles des trois matelots que les Algériens avaient mis à la bouche du canon, on fit passer par les armes, trois des leurs, du nombre des invalides. L'on envoya leurs corps sur un Raz à la ville, avec un Écrit par une autre voie, où l'on déclarait qu'ayant su qu'on avait tiré trois Français, on faisait mourir trois Turcs et qu'on se porterait à bien d'autres extrémités si ces cruautés continuaient.
" Le même jour, 3, le temps avait paru si propre pour bombarder, qu'on tira avec assez de succès 1,700 bombes jusqu'au lendemain 4.
" Mais le 3, vers midi, l'Armée navale entendit à la pointe du Fanal, une salve de mousqueterie et de dix-huit coups de canon sans balles, comme les Algériens ont accoutumé de tirer lorsqu'ils mettent des hommes à la bouche des canons. Il n'y eût personne dans l'Armée qui ne fut touché de douleur et de colère tout ensemble, d'une telle exécution, ne doutant pas que ces enragés n'aient fait mourir le Consul et les principaux Français. On envoya au vaisseau Anglais pour en apprendre des nouvelles ; mais l'écrivain n'ayant pas été à la ville, on n'a pu savoir encore ce qui en était.
" Ce pressentiment n'était que trop fondé ; le lendemain, 4 juillet, on apprit que le Consul et quinze autres Français avaient été mis au canon ; seize Turcs furent passés par les armes, par représailles ; les corps furent mis sur un Raz que les courants portèrent du côté de la ville. Cette exécution consterna et rendit furieux tout ensemble les Algériens. ". Rapport de d'Estrées sur le bombardement d'Alger.
De la flotte Française, passons à Alger, pour prendre connaissance des actes de barbarie dont les Turcs se rendirent coupables envers les victimes de leurs fureurs.
Le 26 juin, le gardien Bachi, ayant fait passer en revue tous les pauvres prisonniers, commença par nommer Piolle, Consul Français et dix autres qu'il fut marquer pour être mis les premiers à la bouche du canon. Ensuite, il appela M. le Vicaire Montmasson qu'il marqua aussi avec dix autres Français et ainsi des autres ; chaque Capitaine ayant dix Français pour aller de compagnie avec lui à la mort. On les mit tous à la chaîne, même le Consul.
Pendant que le Maréchal d'Estrées faisait disposer toutes choses en état pour bombarder la ville, M. Montmasson, de son côté, faisait tous ses efforts pour préparer ces pauvres victimes à la mort.
Le 1er juillet, depuis cinq heures du matin jusqu'à six heures du soir, les bombes ne cessèrent pas de tomber dans la ville avec un grand bruit et faisant de grands dégâts. Beaucoup d'Algériens succombèrent sous les ruines des maisons. Mezzomorto lui-même fut blessé à la tête. Vers les 10 heures du matin de ce jour, on transféra les Chrétiens Esclaves destinés à la mort, du Bagne du Beylik dans un Fondouk ou espèce de Parc éloigné de la ville. A 11 heures de la même matinée, le Gardien du Port vint prendre le Consul et le mena à la Marine, accompagné de quatre autres Français, trois desquels passèrent à la bouche du canon étant suspendus par les pieds, à la vue du Consul qu'on reconduisit avec le quatrième au lieu d'où on les avait tirés. On ne peut exprimer les insultes qu'ils firent au Consul, l'ayant meurtri de coups de bâton.
Le 2 juillet, le temps ne permit pas de bombarder. Le Trucheman de la Nation Française, Mercadier, vint dire au Consul, à M. Montmasson et à tous les Capitaines d'écrire au Maréchal d'Estrées de faire cesser les bombes, sinon que tous les Français passeraient au canon. Et, le même jour, un Renégat du Pacha vint prendre Fournillier, Capitaine de vaisseau, et le conduisit devant le Pacha qui lui ordonna d'un ton de colère contre la France, d'écrire cette Lettre au Marquis d'Amfreville :
" Monsieur, je viens d'être présenté devant le Pacha; il m'a dit que si M. le Maréchal fait encore tirer une bombe, il pouvait être assuré que le Consul était mort et ensuite nous tous, et qu'après les Nations étrangères y passeraient comme nous, et que par-là on se souviendrait du nom de Mezzomorto. "
" Fournillier, Esclave, à la Maison du Pacha, " le 2 juillet 1688. "
Ces Lettres furent portées, mais sans effet ; car le matin du 3 du dit mois, on tira des bombes avec un très grand fracas de toutes parts ; sur les 11 heures du matin, le Gardien du Port vint prendre le Consul pour la seconde fois et quatre autres Français avec lui. Piolle fut si fort maltraité de coups de bâton et de couteau qu'on lui donna par les rues qu'il expira avant d'être mis au canon. Ses quatre compagnons après lui, subirent le même supplice.
Le 4 juillet, les bombes firent feu à l'ordinaire, mais on ne mit personne au canon.
Mais, dès le lendemain matin, le Capitaine du Port vint chercher M. Montmasson. Lorsque le Vicaire apostolique, après avoir subi d'infâmes outrages, fut arrivé au lieu du supplice, on ne l'expédia pas tout de suite: on le laissa longtemps languir et il fut spectateur de l'exécution des autres et de la cruauté avec laquelle ont les avait traités avant d'être lui-même exposé aux derniers excès de leur fureur, qu'ils n'exercèrent pas sur lui tout entière à la fois, mais peu à peu et par progrès. Enfin, on le mit au canon après avoir attaché ses membres en forme de croix de St-André.
Les 6, 7 et jusqu'au 13, le bombardement d'Alger continua, et, chaque jour, de nouvelles victimes succombèrent de la même manière. Dix mille deux cents bombes tombées dans la ville, la ruinèrent presque entièrement. Car, de dix mille maisons dont elle était alors composée, il n'en resta qu'environ huit cents où l'on put habiter. La maison du Dey fut tout à fait détruite ; les Casernes des soldats, les Mosquées, les Bagnes et presque tous les autres édifices furent entièrement délabrés ou renversés. Il y eut cinq navires d'Alger coulés à fond, et trois sur les chantiers furent brisés par les bombes ; enfin, après cette terrible punition, qui était la juste peine des insultes que les Barbaresques avaient faites à la France, il ne restait plus que 350 bombes ou environ à tirer, que le mauvais état dès galiotes ne permit pas de lancer alors.
Toute l'Armée appareilla et prit sa route vers l'Ouest, le 18 juillet. Le Dey qui se trouvait occupé au siège d'Oran, contre les Espagnols, n'arriva à Alger que le 13, avec le Camp.
Les principaux Français sur lesquels, en cette circonstance, les Algériens déchargèrent le poids de leurs fureurs contre la France, furent M. Montmasson, Vicaire apostolique ; M. Piolle, Consul de la Nation française ; M. de la Croisière de Motheux, et, avec lui, trois autres Capitaines; le Frère Lazariste Francillon, 5 Patrons, 6 Écrivains et 25 Matelots.
Le bombardement d'Alger n'ayant pas eu le résultat qu'on en attendait, c'est-à-dire la soumission à la discrétion du Roi, quoique les neuf dixièmes des habitations ne présentassent que des monceaux de ruines, le Commandant de la Flotte se vit obligé de quitter les eaux de la ville, après avoir épuisé ses munitions et rentra dans la rade de Toulon.
Furieux des désastres essuyés, les Algériens se hâtèrent de lancer à la mer de nouveaux bâtiments, et de faire une guerre à outrance à tous les vaisseaux portant le pavillon du Roi ; en peu de temps, ils firent éprouver au Commerce des pertes considérables, malgré les croisières incessantes des Escadres françaises.
L'année suivante, 1689, de Vauvrée, Intendant de la Marine à Toulon, reçut avis du Renégat de Marseille, Mercadier, Trucheman de l'ancien Consul Piolle, que Mezzomorto se prêterait à un accommodement. La Cour de France informée de ces dispositions donna ordre, en septembre, à l'Intendant de la Marine d'envoyer Marcel à Alger, pour négocier cette Paix si vivement désirée par les Commerçants. Un habile Négociateur, au rapport de Dussault, aurait pu obtenir davantage. Marcel se borna à faire renouveler, par Mezzomorto, le Traité que le Chevalier de Tourville avait déjà obtenu en 1684.
Nous avons vu, plus haut, que lors du deuxième bombardement d'Alger, par Duquesne, les habitants du Comptoir de La Calle, contre lesquels on craignait des représailles, avaient été rembarqués en toute hâte. Quand la Paix fut faite, l'année suivante, Dussault, l'ancien Directeur, essaya de former une nouvelle Compagnie, et conclut, à cet effet, une nouvelle Convention avec le Divan. Mais les Anglais venaient de s'établir à La Calle, et le Comptoir du Bastion où la Société française devait s'installer, n'inspirait plus aucune confiance au Commerce Dussault, ne put réussir à l'organiser.
Les choses demeurèrent en cet état jusqu'en 1694, Cette même année, le bail des Anglais expirait, et le Divan ayant refusé de le renouveler, plusieurs Négociants de Marseille qui attendaient ce moment, s'empressèrent de traiter avec le Gouvernement Algérien pour l'exploitation des Concessions africaines.
A SUIVRE
ALGER, TYP. DE L'ASSOCIATION OUVRIÈRE V. AILLAUD ET Cie
Rue des Trois-Couleurs, 1877
Livre numérisé en mode texte par M. Alain Spenatto.
| |
|
¤¤¤ LA SOUPE AUX FEVES ¤¤¤
De Jocelyne B.
|
Ingrédients :
¤ Pour 6 à 8 personnes :
¤ 2 courgettes,
¤ 1 tomate bien rouge coupée en morceaux,
¤ 3 carottes,
¤ 2 oignons,
¤ 1 kg de fèves fraîches ou congelées,
¤ 1 cuillère à café de coriandre,
¤ 1 cuillère à café de cumin,
¤ 4 petites pommes de terre,
¤ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive,
¤ sel, poivre.
| ¤¤¤ Préparation ¤¤¤
1¤ Hachez les oignons, faites-les revenir dans une cocotte avec l'huile.
2 ¤ Ajoutez les morceaux de tomate, les carottes coupées en petits bâtonnets. Couvrez d'eau. Faire cuire 15 minutes.
3 ¤ A mi-cuisson ajoutez le sel, le poivre, les épices, puis les fèves, les courgettes pelées et coupées en rondelles, les pommes de terre coupées en petits cubes.
Ajoutez de l'eau s'il le faut à votre convenance. Cuire 15 à 20 minutes.
4 ¤ Versez la soupe dans une soupière pour servir.
Elle est meilleure le lendemain.
¤¤¤ Suggestions ¤¤¤
1 ¤ Pour ceux qui aiment, vous pouvez ajouter dans la soupe des petites pâtes ou du blé concassé. 30g par Personne.
2 ¤ Certaines familles mettaient des petits carrés d'agneau ou des petits morceaux de poulet (à faire revenir avant les oignons pour une 1ère cuisson) pour avoir un plat complet et résistant. De 80g à 100 g par personne.
|
|
| Une dame en vol
Envoyé Par Chantal
|
Une dame survole la Réunion, avec juste le pilote et elle dans le petit avion... Le pilote meurt brusquement d'une crise cardiaque.
Frénétiquement elle lance un appel de détresse : "May Day ! May Day ! May Day ! A l'aide ! Help ! Au secours ! Venez m'aider ! May Day ! Mon pilote vient d'avoir une attaque, il est inconscient , je crois qu'il est mort, je ne sais pas piloter ! Au secours ! S'il vous plaît, aidez-moi !"
Presque instantanément, elle entend une voix dans la radio : "Ici la tour de contrôle, j'ai reçu votre message et je vais vous indiquer les manoeuvres à suivre pour vous sortir de là, j'ai une grande expérience de ce genre de situation.
Maintenant détendez-vous, tout va bien se passer... Donnez-moi votre hauteur et votre position."
Elle répond : "Je fais 1,70 m et je suis assise sur le siège avant."
"OK", dit la voix de la tour, répétez après moi : "Notre Père qui êtes aux cieux...."
|
|
|
ANECDOTE
Envoyé par M. Doblido
|
127ème Division Le 3 Mai 1919.
ETAT-MAJOR 1er BUREAU
N'° 3.233/1 du Q.G.
Ordre général d'opérations. - 3° Partie
ACCAPAREMENT DES MAISONS
PUBLIQUES PAR LES TIRAILLEURS.
" Le général a reçu plusieurs lettres anonymes de chasseurs, fantassins et cavaliers, se plaignant de ne plus pouvoir pénétrer dans les maisons de tolérance, accaparées par les tirailleurs opérant en grandes bandes. Ces derniers resteraient trop longtemps en exercice et occasionneraient de fréquents embouteillages.
L'administration supérieure de la Sarre et nos autorités municipales se préoccupent d'augmenter notablement l'effectif des filles de joie, mais. en attendant que cet effectif ait pu être renforcé, il faut que les tirailleurs se montrent plus expéditifs dans leurs ébats ; des théories leur seront faites à ce sujet. "
Le Général commandant la 127 ème division
Signé : ( Brissaud-Desmaillet.)
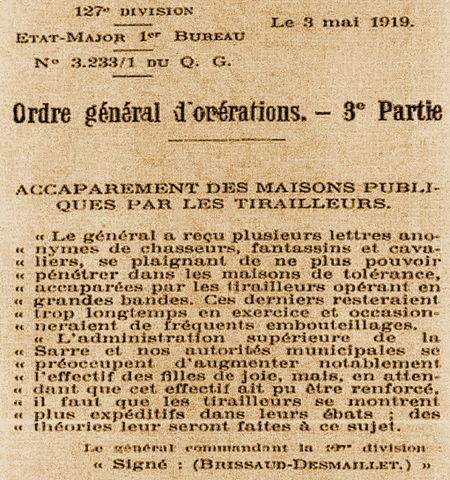
| |
|
|
Chers Amis, Chers Lecteurs,
Je reçois chaque jour du courrier de parution de livres, d'œuvres de spectacle ou autres événements à caractères lucratifs au sens financier.
Sans entrer dans les justifications ou non du caractère financier des annonces, je me dois encore, de préciser que le site de Bône et la Gazette ne vivent que par mon investissement financier (matériel informatique, hébergement, achats de documentation et même déplacements) et sans regret ; par ma disponibilité dont l'emprise est plus forte que celle qui revient normalement au domaine familial qui ne me l'a jamais reproché et dont je loue la patience ; par le bénévolat, la gentillesse et le dévouement des chroniqueurs qui contribuent à cette Gazette et qu'il faut remercier mille fois ; par l'apport gracieux de documentation des lecteurs que je remercie aussi pour comprendre l'esprit de cette modeste réalisation.
Une fois ces précisions dites et redites, je dois encore rajouter que ce site et cette Seybouse n'ont aucun caractère commercial, haineux, racial, repentant, spécialement politique ou religieux, etc… ou contraire à la loi et aux respects des bonnes mœurs et des mémoires plurielles. Les seuls buts sont la mémoire et la vérité telles que nous les avons vécues et que nous connaissons, nous les Pieds-Noirs, les expatriés d'Algérie. La diffusion, l'explication et la compréhension de ses buts nous amèneront, je le pense sincèrement, au but suprême qui est la Paix. La Paix des Mémoires, des Âmes, des Cœurs, en un mot celle des Hommes.
Donc en regard de cela, je réserve le passage des annonces et publicités sur la Seybouse dans ce respect. Pour accomplir cette tâche, surtout pour les livres, pour l'audio ou la vidéo, je dois m'assurer que ceux-ci sont conformes à ce respect, à cet esprit en ayant aussi et surtout mon libre choix.
Pour exercer ce libre choix de faire de la publicité gratuite des annonceurs, il faut que je lise des ouvrages ou des chapitres publiables sur le site, que je visionne des DVD ou que j'écoute des CD. Il me faut du temps. Certains annonceurs m'envoient ou me proposent spontanément leurs œuvres (même si je dois les renvoyer) et en plus ils ont l'amabilité et la patience d'attendre ma décision. Je les en remercie sincèrement car j'ai encore des livres reçus et à lire.
Par contre, d'autres annonceurs, que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Eve, font du harcèlement par messages interposés (d'autres Webmasters sont dans le même cas), alors qu'ils n'ont même pas le réflexe d'exprimer ce qu'ils attendent de nous, de nous faire parvenir leurs œuvres et (ou) de permettre la diffusion de très larges extraits. En plus de cela, certains sont impolis et même agressifs dans leurs propos si nous n'accédons pas à leurs " désirs ".
Je l'avais déjà dit et je le redis, je ne passerai plus de publicité pour des œuvres que je n'aurai pas lues, regardées ou écoutées. J'ai déjà refusé de faire de la publicité pour quelque chose qui n'était pas conforme à notre mémoire, à notre vérité et je le referai. J'ai peut-être commis des erreurs, si c'est le cas je les assumerai et les réparerai.
Je suis au regret de m'en tenir à cette décision qui sera comprise par la majorité et critiquée par une minorité. Je suis un bénévole parmi tant d'autres, qui s'investit financièrement et temporellement sans compter et qui a la liberté de se rendre ses comptes.
Je repasserai plusieurs fois cette Avis, car certains ne l'auraient pas lu auparavant et d'autres ne le liraient ni cette fois-ci ni plus tard, sur ce numéro.
Avec mes profonds remerciements.
Amicalement
J.P.B.,
Webmaster à but non lucratif du site de Bône et de la Seybouse.
|
|
PHOTOS
Diverses de BÔNE
Envois de diverses personnes
|
Envoyé par M. Charles Ciantar
Cours Bertagna

Port

Fort Gigogne

La Grenouillère
 Envoyé par M. Beghdadi
Envoyé par M. Beghdadi
Le Personnel des Galeries de France à Bône en 1956. Qui se reconnait dans cette photo !!!
 Envoyé par M. Bernard Kugler
Envoyé par M. Bernard Kugler
Bône - Monument à la gloire de l'Armée Française
Ce Monument a été détruit par les gardes-mobiles (Marteau piqueur et half track en protection).
M. Méléo me signale que des photos ont été prises de cette destruction. J'aimerais en avoir pour montrer qui était notre véritable ennemi.

|
|
Célébration du Massacre
du 26 mars 1962 à Alger
par M. Alain Algudo
Et un hommage de M. Guy Rolland
|
|
Ce superbe travail, exécuté à ma demande pour le cinquantenaire, a marqué notre cérémonie en souvenir du crime d'État du 26 mars 1962, fusillade de la rue d'Isly à ALGER !
A diffuser sans modération à vos correspondants à travers toute la France POUR MONTRER QUE NOUS N'OUBLIERONS JAMAIS !!!
Bravo et merci à nos compatriotes "NATRELLA fleuristes," de BOUGIE !!
Fraternellement !
Alain Algudo
************************
 FLEURISSEMENT DE LA STELE DE NOS MORTS EN ALGERIE
FLEURISSEMENT DE LA STELE DE NOS MORTS EN ALGERIE
Cinquantenaire de la fusillade de la rue d'Isly
26 mars 1962 - 26 mars 2012
Cérémonie du souvenir au cimetière neuf de BEZIERS
Allocution de Alain ALGUDO
devant la stèle des Martyrs de l'Algérie Française
Cinquante ans déjà ! Et aujourd'hui l'histoire semble bégayer ! Cinquante ans de mensonges sur les tenants et aboutissants de cette tragédie où la France Gaulliste de l'époque a édifié son mur de la honte par son silence, ses mensonges !
Mais contrairement au sort réservé au mur de BERLIN, celui-ci ne fait que se renforcer et tous les moyens sont bons pour que l'homme providentiel reste la référence.. même si sa responsabilité dans le drame du 26 mars 1962 est maintenant avérée. Nous avons affaire.. au plus haut niveau de l'Etat.. à des robots formatés et quand un homme sincère ose essayer de comprendre, de nous comprendre, un homme qui ose s'engager à nos côtés, alors s'abat sur lui la foudre des tenants de la trahison et hélas aussi souvent, incompréhensiblement, l'ingratitude de certains des nôtres !
L'Allemagne Nazie avait, entre autres, a son palmarès de l'horreur, ORADOUR SUR GLANE, La France Gaulliste aura comme tache indélébile, entre autres, ALGER et sa rue d'Isly en cette journée où devait ce produire l'inimaginable.
" Le massacre d'une population désarmée. Le comble de l'horreur " écrira dans " les feux du désespoir " Yves COURRIERE que l'on ne peut classer comme pro OAS.
Ce jour là, sous la coupe d'un parjure, commença la destruction de la belle armée Française qui allait, un certain 5 juillet 1962 et les mois qui suivirent, laisser ses compatriotes aux mains des égorgeurs.
Sur ces drames nous avons tout dit au cours de ces trop longues années et personnellement je me demande encore comment après tous mes articles parus sur VERITAS et mes communications sur la toile, je n'ai pas été traîné devant les tribunaux.
Je pense que la raison est que je n'ai jamais rien avancé qui ne puisse être vérifié, ou alors, j'ai plagié certains termes puisés dans le vocabulaire d'un grand responsable d'Etat intouchable, car comme vous le savez vous pouvez dire et écrire maintenant que vous aimeriez bien employer un Karcher pour nettoyer la racaille dans les quartiers interdits, vous n'avez rien a craindre !
Alors je dirai sans crainte aujourd'hui que j'aimerai aussi nettoyer au Karcher une certaine racaille médiatique ( je ne généralise pas, elle se reconnaîtra) qui fait passer des vessies pour des lanternes au " bon peuple " de France, car il est bien établi chez le quidam du coin que le 26 mars 1962 c'est l'OAS la responsable et pas les tirailleurs Algériens composés de ralliés de la dernière heure qui ont mitraillé la foule utilisant 1135 cartouches de pistolet mitrailleur, 427 de fusil, 420 de fusil mitrailleur, répondant à ce fameux coup de feu qui était le signal du massacre prémédité, POUR CASSER DEFINITIVEMENT L'ALGERIE FRANCAISE !
Alors OUI, vous désinformez encore à en faire vomir le moins concerné de nos compatriotes, vous qui, cinquante ans après, tuez une seconde fois nos disparus en vous moquant de la douleur de leurs familles puisque vous recevez encore aujourd'hui leurs assassins sur les plateaux de télévision et organisant des colloques avec les tueurs du FLN et leurs complices porteurs de valise dans les villes de France, alors que l'un de leurs descendants direct vient de semer la terreur sur le territoire national !
Le Maréchal Juin avait dit en 1962 que la France était en " état de pêché mortel ", alors aujourd'hui il est injuste que ce soit encore des innocents qui paient le prix de la justice divine qui devrait s'abattre sur ces monstres de duplicité ou leurs descendants !
Alors cinquante ans après, vous les victimes innocentes de cet immonde traquenard d'Etat appelés " accord d'Evian," vous qui nous nous regardez de la haut, nous, réunis devant cette stèle, SACHEZ QUE NOUS NE VOUS OUBLIERONS JAMAIS !!!
************************
Cher Alain,
Bravo et mille mercis pour ce panache de fleurs sur un monument qui représente toute la mauvaise conscience de la France. L'Algérie pouvait bien embrasser tous les destins possibles que ses habitants auraient communément choisis parce que l'Histoire ne s'écrit jamais du jour au lendemain ni contre la bonne foi abusée des peuples. La destinée des hommes s'écrit comme un arbre grandit. Il y faut des décennies et parfois des siècles. Il y faut le temps qui se déroule et la nature qui l'entoure de ses bénédictions et de ses épreuves.
Mais cette stèle célébrée presque dans la clandestinité par quelques mains pieuses et par quelques âmes indestructibles et fidèles, elle est comme cette petite herbe verte qui soulève le béton armé et que le béton armé regarde monter avec l'effroi des tyrans qui vacillent dans le déséquilibre de leur empire inique.
Dans une Algérie française, dans une Algérie où les chrétiens de Kabylie auraient infusé la foi de la Bonne Nouvelle à toute la population de ce pays, le jeune Mohamed Merah serait peut-être devenu le soldat français qu'il avait d'abord souhaité devenir. Il serait peut-être devenu le légionnaire qu'il avait rêvé d'être. Nous avons le droit de penser à ce que la destinée des humains aurait été en Algérie sans le passage, un jour, de l'ouragan de l'imposture incarnée dans la personne de l'invertébré de Colombey.
Les images des "Actualités" du 4 Juin 1958 montrent des femmes musulmanes en train de mettre publiquement le feu à leur voile. Voilà ce qu'offrait le déplacement de De Gaulle en Algérie et le salut promis. Le résultat fut différent. Il fut le contraire de tout cela. Le voile, c'est ici qu'il s'impose maintenant. Avec le Halal, la charia, les mosquées et l'Occupation.
Bilan éloquent de la richesse pour la France. Bilan éloquent du principe de précaution. Bilan éloquent de l'analyse puissante de Sarkozy : "L'islam c'est la finesse, c'est le progrès, c'est la civilisation". Bilan éloquent de l'intégration sans assimilation. Bilan éloquent des " enfilanthropes " de la république laïque et républicaine. Bilan éloquent de l'indépendance algérienne. Bilan éloquent du 19 Mars 62, victoire du FLN contre la France, fêtée par la France des vaincus comme un petit 14 Juillet. Bilan éloquent, oui. La réussite de cette France c'est Mohamed Merah, né en même temps que SOS Racisme et que "Touche pas à mon pote".
Dans les années 80, pour les attentats de la rue des Rosiers, de la rue Copernic, de la rue Marbeuf, les chiens pouvaient se ruer sans mal sur cette providentielle extrême-droite perpétuellement accusée, par les fabricants d'opinions, d'ourdir tous les complots les plus barbares et les plus insolubles. Quel désenchantement quand la racaille mondaine découvre que ni le Che, ni Carlos, ni Abou Nidal ne sont encartés au FN ! Mais les malfaiteurs de l'Opinion ne désarment jamais. Ils accomplissent toujours leur sale besogne. Et les instituts de sondage trop heureux d'annoncer aussitôt que Monsieur Mélanchon vient de dépasser Marine Le Pen. Ah! comme ils auraient défilé dans toutes les villes et les villages de France et par centaines de milliers si le tueur avait été retrouvé avec une fausse carte de faux adhérent du Front National !
Bilan éloquent de l'éducation prodiguée à nos "chances pour la France", le bilan d'un pur produit de cette république qu'ils aiment: Repris de Justice 15 fois interpellé, voleur, voyou, pur rejeton de cette religion d'amour, Merah convoque ces soldats dont il n'a pas été le camarade pour leur tirer dessus. Pur produit de cette France à la Mitterrand, corrompue et confite dans la dévotion antiraciste, Merah traite cette France au 11/43. Il touchait le RSA.
Dans l'école juive ce n'est pas en antisémite qu'il agit puisqu'il est sémite lui-même. C'est en terroriste antisioniste. Il tue des enfants avec le même sang-froid que le firent Ben Bella, Bouteflika et Zorah Drif avec des petits algériens chrétiens, juifs et musulmans d'Algérie. On attend toujours de la part de quelques millions de musulmans dits modérés un défilé géant de protestation contre cet islam qu'ils ne partagent pas. Et ces assassinats militants. Le monde entier les a vus à l'œuvre pour la bavure de deux d'entre eux, imprudemment réfugiés dans un transformateur qui leur fut fatal. La Police aurait du savoir qu'il est interdit de contraindre deux voleurs de vespa à se cacher dans un abri non sécurisé. Des dizaines de milliards d'euros partis en fumée, le galop d'essai des talibanlieusards. Quand les musulmans désapprouvent, ils savent le dire. Pour les 7 morts et le jeune soldat tétraplégique victimes de Mohamed Merah, soldat d'Allah, la France risque d'attendre longtemps ce désaveu public que des non musulmans certifient le plus fort. Les terrorisés persistent à rendre hommage aux terroristes en ne leur réclamant pas cette manifestation nationale monstre de désaveu universel. Ils leur rendent également hommage en leur montrant leur soumission. Au lieu de se contenter de la revendication claire et nette d'anti-sionisme et d'anti-France, le carnaval des cuistres continue de répéter l'antienne de l'antisémitisme et du racisme. Même après un pareil forfait, il est encore question de campagne électorale et de ne pas être capable de la simple exactitude. Mentir sur les attendus d'un terroriste qui les a exprimés par les actes et les paroles, c'est vouloir imprudemment exploiter ce terrorisme. Ce n'est pas beau du tout.
Qui sont les apologistes du Terrorisme que Sarkozy veut poursuivre ?. Qui sont-ils sinon tous les services de l'Etat français qui entretiennent, de la naissance à la mort, les parasites de l'Algérie algérienne en faillite ?
Pour camoufler les complicités et parce que les idiots ne peuvent produire que des idioties comme les pommiers des pommes, toute cette faune religieuse, politicienne, associative, se donne rendez-vous devant des monceaux de fleurs, piétinant le sol où périrent les victimes pour s'entendre une fois de plus sur une escroquerie supplémentaire: Mentir, encore et encore. Parler en chœur du racisme et de l'antisémitisme, parler du nazisme et du terrorisme en général en faisant semblant d'ignorer que ce terrorisme-là qui n'est ni français ni israélien ni allemand ni serbe ni moldave ni poldave, est bel et bien le terrorisme musulman qui tue au moins 50 ... musulmans par semaine dans le monde. C'est ce terrorisme qui tire des scuds sur Israël et dont les médias ne parlent qu'après la riposte de Tsahal.
Bilan éloquent des menteurs de la république: Aucun ne parle de la mort des harkis punis très exactement du même crime inexpugnable d'avoir choisi la France. Merah continue le travail de Ben Bella et de Bouteflika, ces assassins parvenus que Messieurs Hollande et Sarkozy prennent dans leurs bras. Ces assassins dont Merah n'est que la reproduction miniature et que toute la Gauche et l'extrême Gauche armaient et soutenaient. Bilan éloquent de la république après les splendides feux d'artifice de l'hiver 2005, ce jeune Français d'origine algérienne, pur produit de la faillite de l'Algérie algérienne de Monsieur De Gaulle, exportée en France comme un droit naturel, comme un devoir, comme une obligation que les Français devront jusqu'à la fin des temps.
Mélanchon, Artaud et Poutou absents aux funérailles des soldats Harkis martyrs de leur engagement français. Mélanchon, Artaud et Poutou, déserteurs publics de la cause nationale, fraudeurs de la Nation. Dignes héritiers de Marchais, de Thorez et de Doriot.
Le terrorisme auquel De Gaulle a livré l'Algérie après avoir embastillé, exilé, fusillé et persécuté tous ceux qui n'avaient pas accepté le bon droit de ses mensonges est devenu un label de qualité internationale. "Je vous ai compris" est entré dans le langage commun. Un langage qui identifie le Français sur la scène internationale. "Je vous ai compris, je vous l'ai bien mis." Voilà la figure de l'honneur national. On connaissait le mot de La Palisse, on savait la devise d'Henry IV, on connaissait le mot de Cambronne. La formule gaullienne, devise des spoliateurs et résumé référencé de la belle arnaque réussie. Merah n'est rien d'autre que le fruit de cette fumisterie.
Alors Monsieur Sarkozy et Monsieur Chirac qui doivent leur carrière politique au Soldat Inconnu de l'Etoile ne peuvent devenir historiens ni justiciers puisqu'ils sont politiciens. Ils étreignent donc publiquement Bouteflika en l'hospitalisant dans l'hôpital militaire où mourut le Général Salan. Hollande, dont le père fut inquiété pour sa participation à l'OAS, se fait photographier bras dessus, bras dessous, hilare, avec le terroriste majeur, Ben Bella. A Marseille Gaudin n'est pas de reste, l'inverti célèbre la poseuse de bombes Zorah Driff comme s'il recevait Mère Teresa. Et Delanoé qui n'a plus entendu parler de Carême depuis qu'il était Petit Chanteur à la Croix de Bois fait annoncer le Ramadan dans Paris par des milliers de panneaux municipaux lumineux. C'est Clemenceau qui disait que le meilleur moment de l'amour, c'est l'escalier.
Alors avec quel regard un Français d'Algérie, vaincu par les mensonges de De Gaulle, vaincu par les barbouzes, vaincu par les terroristes hissés aux nues par la célébration du 19 Mars et par tous les acteurs gaullistes, socialistes et communistes de ce génocide de la Civilisation, peut-il regarder couler les larmes des pleureuses professionnelles de la classe mediatico politique après les agissements de ce Ben Bella toulousain infortuné, puisque brisé net, dès l'envol, tel Amirouche, dans son élan anti-français ?
Ce regard n'est ni le regard du désespoir ni même celui de la vengeance satisfaite. C'est celui qui voit tomber la pluie sans étonnement. Quand les nuages ont longtemps pesé sur le ciel, ils finissent par s'éventrer. Quand on a survécu déjà à un déluge de ce genre, on n'a pas trop de mérite à être un peu prophète. Tant pis pour les jeunes loups et les vieilles buses qui ne veulent rien entendre. Tant pis pour les météorologistes stipendiés qui répètent que c'est la Brise Marine qui contient le collapsus. Le cumulo-nimbus qu'elle leur réserve un jour sera celui d'un autre raz de marée. Pour l'instant ils se contentent encore de mentir, de mentir, de mentir en bons et dignes héritiers de celui qui se servit du Général Salan pour s'emparer du pouvoir et jeter le Général en prison. Tout se paie. L'Histoire n'est pas pressée. Les exorcistes des fantasmes bruns sont à l'ouvrage. Ils masquent par tous les mensonges possibles le vert et blanc qui envahit l'espace de notre vie par le vert-de-gris qui restera le spectre de leur héroïsme raté et de leur trouille maquillée.
Comme ces phares qui continuent de clignoter dans les brouillards les plus opaques, la stèle des fusillés de l'Algérie française, maintient le cap des rares survivants du naufrage. Cette stèle marque la ligne de flottaison de la civilisation. Il y a cinquante ans quelques milliers de Français ont voulu sauver le poste avancé d'un monde qui ne croyait déjà plus en lui et qui venait de nouer son sort à celui de l'usurpateur dément. Ces quelques milliers parmi lesquels le successeur de Jean Moulin tentèrent une ultime mutinerie. Mais l'Histoire ne repasse pas les plats. La Bataille de Lépante ne s'est pas reproduite. Ils furent broyés par la vindicte du Massacreur de la rue d'Isly et par la très balnéaire indifférence de tout un peuple.
Survivants de la lucidité et d'un drame qui est désormais écrit et irréversible, ces courageux combattants honorent leurs camarades sacrifiés devant cette très noble stèle. Avec cinquante années d'avance sur l'Histoire, les combattants de l'OAS savaient le basculement fatal du monde si la France, fille aînée de l'Eglise, renonçait à sa mission. Ils savaient alors que le 19 Mars ne serait secrètement que l'anniversaire du retour chez Maman des trois quarts des militaires contraints et forcés de défendre un pays qu'ils n'aimaient plus depuis longtemps. Ils savaient aussi que pour les guerriers d'Allah cette conquête n'était qu'un pas de plus dans l'accomplissement de sa volonté de convertir le reste du monde de gré ou de force.
Cette stèle est le fanal de l'espérance des hommes libres. Elle est la mémoire des héros d'hier. Elle est aussi la référence et la force des héros d'aujourd'hui et de demain.
Honneur à ceux qui l'ont érigée dans la Foi, dans l'Honneur et dans la Fidélité.
Merci Alain.
Guy ROLLAND
- Résidence le printemps n° 41 - 2, avenue des Tilleuls -
- 81600 - GAILLAC
05 63 421 588 / 06 74 445 946
|
|
1er Mars 1962… Mers El-Kébir
L’assassinat de la famille Ortéga
|
« Aucune cause ne justifie la mort de l’innocent. Si je peux comprendre le combattant d’une libération, je n’ai que dégoût devant le tueur d’enfants »
(Albert CAMUS)
Le printemps était revenu, avec ses éveils de sève, les gouttelettes vertes et les blanches éclosions des fleurs au bout des branches. C’était le retour des papillons, des oiseaux, de la vie. Tout reverdissait comme par enchantement ; les mimosas, fleuris à profusion, ressemblaient à d’énormes bouquets dans lesquels les colibris chantaient de leur toute petite voix douce, pareille à la voix des hirondelles qui jaseraient en sourdine. Et la nature s’était tant hâtée d’enfanter tout cela, qu’en huit jours elle avait tout donné…
Pourquoi tant de hâte ? Savait-elle alors que c’était là son dernier printemps ?… Voulait-elle offrir une ultime vision de Paradis à ceux pour qui le glas allait sonner ?
Le 1er mars 1962, tombait un jeudi. Il faisait le temps même de la vie, le temps qu’on imagine pour le Paradis. Un air doux et léger, un ciel aux profondeurs bleues à qui le soleil réservait sa plus fastueuse débauche de lumière, une senteur subtile de jardin laissait supposer une journée radieuse…
Il était environ 11h, un groupe de Musulmans fit irruption dans la conciergerie du stade de La Marsa, à Mers El-Kébir, tout près de la base militaire. Dans une véritable crise de folie meurtrière collective, ces hommes s’emparèrent de la gardienne, une européenne de trente ans, Mme Josette Ortéga et, sans la moindre raison, à coups de hache, la massacrèrent. Couverte de plaies affreuses, dans un ultime effort, elle tenta de s’interposer entre les bourreaux déchaînés et son petit garçon, mais en vain. Les tortionnaires déments frappèrent encore sous les yeux horrifiés du petit André, quatre ans, puis quand il ne resta plus qu’une loque sanguinolente, ils se saisirent de l’enfant et lui broyèrent le crâne contre le mur.
Alors que, leur forfait accompli, ils s’apprêtaient à partir, ils aperçurent la fillette, Sylvette, cinq ans, qui venait du jardin, les bras chargés de fleurs. Aussitôt l’un des hommes se jeta sur elle, la roua de coups puis, la saisissant par les pieds, lui fracassa la tête contre la muraille.
Quand M. Jean Ortéga, employé à la direction des constructions navales, franchit la grille du stade, le silence qui régnait le fit frissonner. D’ordinaire, ses enfants accouraient, les bras tendus dans un geste d’amour. Une angoisse indéfinissable le submergea. Il approcha lentement, regarda autour de lui… puis, là, dans la cour, un petit corps désarticulé tenant encore dans ses mains crispées des géraniums, la tête réduite en bouillie, une large flaque de sang noirâtre tout autour.
L’univers qui tourne comme une toupie : rouge, noir, blanc ; parler… crier… non… rien : l’effondrement enfin, salutaire, libérateur, mort et vie à la fois : le hurlement. Il se précipita, se figea devant le corps de son enfant, les yeux fixes, la bouche ouverte, semblant avoir été atteint par une soudaine paralysie. Puis son regard se porta à l’entrée de la maison… une mare de sang, un corps gisant, disloqué, mutilé par d’horribles blessures et près de lui, une petite forme qui n’avait plus de visage humain. Ce fut l’écroulement, la folie, la fin du monde…
… Ce sont là des mots qui pleurent et des larmes qui parlent…
Comme on pouvait s’y attendre, la funeste nouvelle se répandit comme un éclair. Le nom des victimes courut sur toutes les bouches ; les commentaires, les controverses violentes, les supplications lamentables, les récits décousus, les vociférations se fondèrent en une rumeur profonde d’ouragan prêt à se déchaîner.
Les Kébiriens étaient anéantis. La famille Ortéga était connue et aimée de tous. Les supporters du club de football « La Marsa » la côtoyait chaque dimanche. Après le choc, ce fut la révolte… Comment demeurer impassible après une telle monstruosité ? Comment prêcher la modération à un père qui découvre pareille horreur ? Quelles paroles de consolation pourrait-on lui apporter ? La lutte pour l’indépendance de son pays justifie-t-elle de semblables abominations ?
Et la rumeur s’amplifia… et le tonnerre gronda…
Ils sont morts ? Comment sont-ils morts ? Qui a fait cela…
Il y avait dans ces questions un frémissement de colères, un foisonnement de fureurs, une tempête encore contenue de vengeances. L’amour patiemment cultivé depuis des générations s’était subitement transformé en une haine qui bouillonnait dans toutes les âmes.
Les opinions s’échauffaient, s’exaspéraient, s’entrechoquaient et l’esprit de vengeance se réveilla en cette population assommée et exacerbée par tant d’années de terrorisme sordide. Sous les rougeurs tragiques du crépuscule, la cohue houleuse prit l’apparence d’une horde de sauvages mutinés. L’unique pensée qui talonnait tous ces gens, la pensée soudaine qui avait traversé tous les esprits comme un éclair, c’était d’empoigner le premier arabe venu pour frapper.
Sur la grande clarté fauve du soleil déclinant, une sorte de fatalité pesait sur toutes les consciences… et le tragique enchaînement de la violence se perpétua aux confins de la folie.
Si l’on ne pouvait excuser tout à fait ce talion, on pouvait, tout au moins, essayer de le comprendre. Voilà sept années que l’on massacrait en Algérie, que l’on mutilait, que l’on violait et que l’on pillait. Aujourd’hui, les Européens répliquaient et versaient dans le désespoir. Voilà les causes des « ratonnades » et de la vengeance ! Voilà la raison de la création de l’OAS !
Si la France avait été vraiment à la hauteur de sa justice, elle n’aurait pas permis qu’un condamné à mort comme M. Chadli, avec cent-treize attentats sur la conscience, soit jugé le mardi et « évadé » le vendredi… Comment dans ce cas ne pas faire justice soit-même ?
Comme de coutume, la presse métropolitaine –hormis le journal « L’Aurore »- se garda bien d’évoquer dans le détail l’assassinat de la famille Ortéga. A l’inverse, elle se déchaîna contre cette « nouvelle ratonnade » en indiquant que « les tueurs nazis de l’OAS se livraient au racket et au massacre sur les Musulmans et les « patriotes » gaullistes ! »
Ainsi ces vertueux journalistes au « coeur sur la main » oubliaient la terreur qu’imposait quotidiennement le FLN ; ils ne se souvenaient plus des charniers de Melouza et d’El-Halia, des soldats français torturés et dépecés encore vivants dans les gorges de Palestro, des bombes du stade d’El-Biar et du casino de la Corniche ; ils ne prêtaient aucune attention aux grenades qui explosaient chaque jour dans les écoles, les cafés, les arrêts d’autobus et qui déchiquetaient les jeunes enfants ; ils feignaient d’ignorer les enlèvements, les égorgements et les viols qui se multipliaient, mais ils stigmatisaient le « drame des ratonnades » qu’un journaliste, Yves Lavoquer, avait, sans gêne aucune, comparé aux « pogroms de la Russie tsariste et aux massacres nazis ». « Ce n’est pas de tuer l’innocent comme innocent qui perd la société, c’est de le tuer comme coupable » écrivait Chateaubriand.
Ces atrocités ne révoltaient donc pas les consciences contre les criminels… mais contre les victimes. Ces milliers d’innocents versés dans la mort servaient à apitoyer le monde sur le sort des bourreaux. Le réflexe n’était pas l’indignation devant la sauvagerie du crime… mais la compassion envers les assassins à qui l’on trouvait toujours une excuse à « leur acte désespéré ». Et si les survivants excédés ou terrorisés prenaient les armes pour sauver leur vie, dans un geste de défense aussi vieux que les âges, ils soulevaient contre eux l’unanimité des censeurs.
Un poète persan a écrit : « Si la douleur, comme le feu, produisait de la fumée, le monde entier en serait obscurci ».
Il y avait tellement de fumée en Algérie, en ce terrible mois de mars 1962, qu’on ne voyait plus clair et qu’on étouffait…
José CASTANO
« Prends garde de ne point oublier ce que tes yeux ont vu et tu les enseigneras à tes enfants et petits enfants »
(ancien testament, deutéronome 4,9)
-o-o-o-o-o-o-o-
|
|
| LA CIGALE ET LA FOURMI
Façon provençale !!!
Envoyé Par Francine
|
A lire avec l’accent !!!!
Zezette, une cagole de l'Estaque, qui n'a que des cacarinettes dans la tête, passe le plus clair de son temps à se radasser la mounine au soleil ou à frotter avec les cacous du quartier.
Ce soir là, revenant du baletti ou elle avait passé la soirée avec Dédou, son béguin, elle rentre chez elle avec un petit creux qui lui agace l'estomac. Sans doute que la soirée passée avec son frotadou lui a ouvert l'appétit, et ce n'est certainement pas le petit chichi qu'il lui a offert, qui a réussit à rassasier la poufiasse.
Alors, à peine entrée dans sa cuisine, elle se dirige vers le réfrigérateur et se jette sur la poignée comme un gobi sur l'hameçon.
Là, elle se prend l'estoumagade de sa vie. Elle s'écrie : " Putain la cagade ! y reste pas un rataillon, il est vide se counas ! " En effet, le frigo est vide, aussi vide qu'une coquille de moule qui a croisé une favouille . Pas la moindre miette de tambouille.
Toute estransinée par ce putain de sort qui vient, comme un boucan, de s'abattre sur elle, Zezette résignée se dit, " Té vé, ce soir pour la gamelle, c'est macari, on va manger à dache ". C'est alors qu'une idée vient germer dans son teston.
" Et si j'allais voir Fanny ! " se dit-elle, " en la broumégeant un peu je pourrai sans doute lui resquiller un fond de daube ".
Fanny c'est sa voisine. Une pitchounette brave et travailleuse qui n'a pas peur de se lever le maffre tous les jours pour remplir son cabas. Aussi chez elle, il y a toujours un tian qui mijote avec une soupe au pistou ou quelques artichauts barigoules.
Zezette lui rend visite. " Bonsoir ma belle, coumé sian ! Dis-moi, comme je suis un peu à la déche en ce moment, tu pourrais pas me dépanner d'un péton de nourriture ! Brave comme tu es je suis sure que tu vas pas me laisser dans la mouscaille! " En effet, Fanny est une brave petite toujours prête à rendre service. Mais si elle est brave la Fanny elle est aussi un peu rascous et surtout elle aime pas qu'on vienne lui esquicher les agassins quand elle est en train de se taper une grosse bugade, ça c'est le genre de chose qui aurait plutôt tendance à lui donner les brégues.
Alors elle regarde Zezette la manjiapan et lui lance " Oh collégue ! tu crois pas que tu pousses le bouchon un peu loi. Moi tous les jours je me lève un tafanari comaco pour me nourrir ! et toi pendant ce temps là, que fais -tu de tes journées? Moi, lui répond la cagole ! " J'aime bien aller m'allonger au soleil ! ça me donne de belles couleurs et ça m'évite de mettre du trompe couillon. "
Ah ! tu aimes bien faire la dame et te radasser la pachole au soleil, et bien maintenant tu peux te chasper. Non mais, qu'es'aco ? C'est pas la peine d'essayer de me roustir parce que c'est pas chez moi que tu auras quelques choses à rousiguer, alors tu me pompes pas l'air, tu t'esbignes et tu vas te faire une soupe de fèves.
Texte de Caldi Richard
|
|
|
Billet d’humeur
par M. Alain Algudo. - Le 11Février 2012
|
ABOMINATION
En 1962, l’ALGERIE est le don d’une France dévoyée à une poignée de barbares ! Un don de son nom, de ses frontières, de son spectaculaire développement économique et démographique, en un mot, de sa magnificence !
Acteurs de cette réussite se sont succédés des gouvernements de constructeurs, des générations de créateurs, hommes et femmes de labeur, de courage et d’abnégation, géniteurs d’un pays aux mille splendeurs qu’un psychopathe allait plonger dans la haine, le désespoir et la violence.
L’Histoire étant un éternel renouvellement, nous aurions pu comprendre qu’une évolution devait raisonnablement se produire de manière pacifique.
Mais pour l’Algérie Française c’était sans compter sur le machiavélisme d’un être qui allait sceller le sort de ce « bijou dans son écrin » et de ses populations.
« Charles le méchant » était né pour détruire ! Il était né pour tuer et son règne sera un parcours sanglant !
Ainsi il instaurait L’ABOMINATION avec un système dévastateur : Le Gaullisme ayant pour base la duplicité qui perdure de nos jours par le mensonge d’Etat récurrent. Et nous en faisons toujours les frais, la naïveté de certains n’ayant pas disparu malgré la trahison endurée.
En effet, cinquante ans après, qu’y a-t-il de changé pour nous ?
Le résultat de nos principales revendications est pratiquement NUL !
La désinformation est toujours en place !
L’insulte et la provocation sont omniprésentes !
L’adulation du monstre est toujours intacte !
L’ennemi d’hier pavoise et provoque, avec l’aide des porteurs de valises, sur le sol National même !
Nous n’allons pas encore développer ces thèmes largement évoqués risquant de devenir radotages pour le quidam à œillères, quand il n’est pas sourd et aveugle ou encore plus grave, indifférent !
Indifférent car tant que la tuile ne lui tombe pas sur la tête (je suis poli) le sort du voisin n’est pas son problème et les habitants des quartiers « difficiles » en font aujourd’hui l’amère expérience, seuls devant une vie devenue insoutenable, les décideurs loin de ces nuisances dans leur douillet confort :
C’est : « chacun sa m…. ! »
Alors, cinquante ans après je vous laisse juge de l’attention qui peut être portée, par les mêmes, aux conséquences de la désinformation dont nous sommes toujours les victimes.
Certes la constatation journalière de cet ostracisme n’aurait certainement pour nous la gravité que nous voudrions bien lui donner, si une politique d’amnésie gravissime n’était pas menée parallèlement par cette idéologie mortifère qui étend ses ravages sur la mémoire de la Nation voire du monde entier. Il faut gommer, oublier les crimes perpétrés par l’icône : C’était après le 19 mars : « silence on tue ! » Pour le cinquantenaire c’est : « silence on vote ! »
Alors s’est installée par la manipulation médiatique, l’abomination de la méthode gaulliste : l’effacement d’une période dramatique de l’histoire de France de la mémoire des citoyens. Nous assistons, comme dans tous les pays totalitaires à la pérennisation d’un programme préétabli d’amnésie collective.
Ainsi les différents gouvernants qui se sont succédés ont intoxiqué une population persuadée que la politique menée, au prix d’un bain de sang, était indispensable au bonheur de deux peuples.
Nous constatons le résultat des deux côtés de la Méditerranée, pour des raisons différentes, mais intimement liées, le chaos et l’insécurité s’installent inexorablement. Un peuple est en fuite à tous prix ; l’autre amorphe, soumis, jouant l’autruche devant le risque mortel d’une guerre civile prévisible !
La forfaiture d’un certain 19 mars 1962 a été complètement occultée du discours officiel, et de ce fait, cet évènement dramatique a sombré dans l’oubli, et les exemples foisonnent, nos décideurs optant pour « une vision de l’avenir plutôt que de remâcher le passé. »
Ainsi un voile noir a été jeté aussi sur les 26 mars et 5 juillet 1962 pour ne citer que ces deux crimes d’Etat, cet Etat qui n’oublie pas de rappeler cependant ponctuellement, et à juste titre, ORADOUR SUR GLANE et la Rafle du Vel’d’hiv ! Mais alors pourquoi deux poids deux mesures ? : Il s’agit simplement d’une méthode qui a fait ses preuves dans tous les pays totalitaires : la mise en place d’une politique concertée de l’ignorance et de l’oubli des meurtres et des violences des dictateurs !
Ainsi l’insoutenable injustice nous laisse un goût amer et le constat est accablant, cette idéologie a réussi à soustraire du champ des consciences les conséquences majeures d’une trahison mortelle, expurgée des esprits d’un peuple. ABOMINABLE !
Mais cette entreprise de destruction massive des valeurs qui font que l’on est fier d’appartenir à une Nation ne semble pas s’arrêter à nos états d’âmes de patriotes trahis ; après avoir donné la victoire aux vaincus, elle l’installe sur le sol même de la mère Patrie. Et alors il faudrait être aveugle pour ne pas constater tous les jours autour de nous, dans la presse, la télévision, l’éducation Nationale, l’Armée, la Gendarmerie… bref, dans tous les rouages de la société, que maintenant les métastases du cancer de l’ABOMINATION GAULLISTE sont en progression fulgurante et le mal est certainement irréversible à ce jour.
Et, quant à nous, désespérément, au lieu retenir la leçon d’un drame récent qui nous a totalement déconsidérés, on en remet une couche, et certains privilégient encore l’affrontement fratricide au dialogue, ainsi nous sombrons définitivement, et disparaissent, lasses, les meilleures volontés dont l’abnégation n’avait d’égal que leur désintéressement.
Alors les croyants résignés diront :
Ita diis placuit
(Ainsi il a plu aux dieux)
je leur réponds, en effet :
It, missa est
(Allez, la messe est dite)
Alain ALGUDO
Président des Comités de Défense
des Français d’Algérie et des Agriculteurs exilés
|
|
LA DESINFORMATION
par Mrs. Méleo, Bartolini, Fournier, Vaudlet
|
Le Cessez le feu à Bône
Chers Bônois et Bônoises,Chers compatriotes,
La désinformation et le mensonge continuent à sévir contre notre communauté comme le montre cet article paru le 19 mars 2012 dans le Dauphiné Libéré.
Il semblerait d'après ce monsieur Gilibert (militaire à Bône en 62) qu'il y avait "une cabane" sur le cours Bertagna dans laquelle des Bônoises auraient fait brûler 9 petits musulmans !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment réagir à tant d'ignominie, cela dépasse l'entendement.............
Réaction de Mrs. Méléo et Bartolini
Le 19 mars 2012, de sinistre mémoire, a paru dans le Dauphiné libéré, un article de Charles Guiraud, journaliste, interwievant un denommé Robert Gilibert ancien maire de Montmiral. Celui-ci fait état des habituels clichés propres aux communistes et autres gars du contingent endoctrinés. A savoir qu'il est ecoeuré par le traitement dont font l'objet les musulmans qui sont retranchés dans des zones arides là où le diable aurait crevé de faim. Ils habitent à la périphérie des villes (en zones arides ?) dans des bidonvilles et on les exploitait au travail. Mais ce témoignage est une série d'élucubrations puisqu'il déclare ensuite avoir reçu en morse (sic) l'annonce du cessez le feu qu'il a porté en main propre au général Ailleret. Le tout en surveillant la nuit les voies de chemin de fer. Trop c'est trop. Et pourtant non ce n'est pas tout, ce "témoin" a vu de ses yeux 300 harkis se faire égorger les uns près les autres. Il ne dit pas à quelle date, à quel endroit surtout qu'à Bône aucun cas d'égorgement collectif n'a été signalé ou alors cela se serait passé bien après l'indépendance.
Et comme il faut en rajouter une dose il a vu sur le cours Bertagna, c'est à dire en plein centre ville, des mères de famille qui ont enfermé 9 (neuf) petits musulmans dans une cabane avant d'y mettre le feu ;" j'entends encore ces cris atroces des enfants qui brulaient vifs". Rien que ça. Là aussi pas de date, pas d'indication d'origine des supposées meurtrières, (le doute est volontairement suggestif) surtout qu'il n'y avait pas de cabane sur le Cours Bertagna. Même si l'on admettait que cela soit vrai à un autre endroit, pourquoi en tant que militaire n'est-il pas intervenu ? Il serait dans ce cas aussi assassin que les supposées vraies. Ce frère d'armes du sinistre Katz serait-il un monstre vivant ?
Passons sur le cas de ce dérangé cérébral. Ce qui est grave c'est que ce temoignage farfelu a été publié dans un journal qui se veut sérieux et dont les articles font office de preuves. Voilà de quoi nourrir la haine anti française dont Mohamed Merah est le symbole. Ce journal est particulierement néfaste et ne mérite pas d'être acheté par des P.N.. Aussi nous demandons à tous les Bonois d'écrire au "rigolo" et au journal pour manifester notre colère.
Souhaitons que nos dirigeants, qui sont tout attentif à nos désirs, relaient notre courroux. (dis tonton pourquoi tu tousses ?).
Vous trouverez l'adresse et N° de téléphone de cet "acteur" du mensonge organisé, dans les pages jaunes sur Internet. Idem pour le journal de la désinformation.
Georges Méléo et J.P. Bartolini
L'armée en opération
Un nouvel exemple de désinformation démontrée par le Général Henry Fournier suite à la parution dans l'édition du SUD OUEST DIMANCHE du 26 février 2012 d'un article de Dominique RICHARD, rendant compte de la récente parution d'un livre de Claude Juin sur la guerre d'Algérie.
L'interprétation de la photo faite par Mrs. Juin et Richard est complètement démontée et mise à mal par M. Fournier et tous ceux ayant fait la guerre ne pourront que lui donner raison.
Vous pouvez consulter cet article de SUD OUEST à l'adresse suivante.
http://www.sudouest.fr/2012/02/26/soldats-tortionnaires-643552-602.php
La lettre de M. Fournier est parue sur le site LIBRE OPINION
Réaction de M. Fournier envoyée par M. Vaudlet
Au cours de cette année 2012 qui marque le 50ème anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, les membres de l'ASAF et tous ceux qui sont soucieux de vérité historique relèvent une multiplication d'opérations de désinformation.
La lettre du général Henry FOURNIER adressée au Directeur du journal Sud Ouest démonte parfaitement le mensonge véhiculé par un commentaire de photo.
Cette lettre est à diffuser largement afin de contraindre ceux qui sont chargés d'informer les Français à plus d'honnêteté et de rigueur....
--------------------------------------------------
Le 26 février 2012
M. le directeur du Journal
SUD OUEST DIMANCHE
23 quai des Queyries
33094 BORDEAUX
Monsieur,
Dans votre édition du SUD OUEST DIMANCHE du 26 février 2012, vous avez publié, en page 14, un article de Dominique RICHARD, rendant compte de la récente parution d'un livre de Claude Juin sur la guerre d'Algérie.
N'ayant pas lu ce livre, je ne porterai pas d'appréciation sur les jugements complaisants de votre collaborateur qui transforme, d'un coup de plume, un million et demi de soldats français en tortionnaires et assassins.
Je laisse les milliers de soldats qui ont apporté leurs soins, leurs apprentissages scolaires ou tout simplement la sécurité aux habitants de l'Algérie durant des années, apprécier le tableau qui est ainsi fait de leur action au cours de cette guerre.
Je me contenterai de dénoncer l'opération de désinformation dont votre journal se fait le complice, en raison de la photo qui illustre cet article.
Montrant un jeune nord-africain progressant seul sur une piste, apparemment en avant de plusieurs soldats, elle est ainsi légendée : « adolescent algérien contraint d'ouvrir la route à des soldats français pour les protéger des mines ».
 Photo de SUD OUEST
Photo de SUD OUEST
Tout observateur, même peu qualifié militairement, ne manquera pas de s'apercevoir des invraisemblances de ce commentaire :
- 1) -la photo est prise de face, ce qui suppose que le photographe est...dans le champ de mines potentiel -
- 2) - l'adolescent porte sur le dos un poste de radio, appareil utilisé en nombre limité dans les unités militaires et que les employeurs du jeune « contraint » n'auraient certainement pas pris le risque de voir détruit par l'explosion d'une mine !mieux encore : l'appareil radio est relié
- 3) -par un cordon (visible sur la partie droite de la photo, à hauteur de l'épaule du porteur) au bout duquel se trouve généralement un combiné téléphonique et un homme : le chef de la section utilisateur de ce poste radio.
Ce qui signifie que ce chef de section (officier ou sous-officier) est suffisamment inconscient pour marcher à côté de l'adolescent....au risque de sauter lui-même sur une mine !
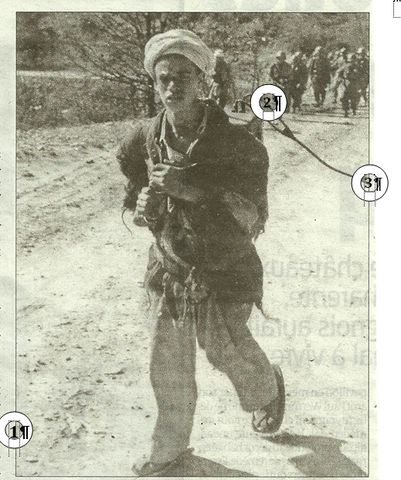 Photo LIBRE OPINION
Photo LIBRE OPINION
En fait, la photo est tronquée, de manière à ....illustrer la légende écrite pour convaincre des agissements des militaires en Algérie. C'est ce que l'on appelle purement et simplement de la DESINFORMATION.
Malgré ses prises de position habituelles sur la guerre d'Algérie, votre journal s'honorerait de publier un rectificatif qui aurait au moins le mérite de rassurer vos lecteurs sur votre capacité à les informer.
En espérant de votre part un sursaut d'honnêteté journalistique, je vous adresse mes salutations affligées par ce manque de professionnalisme et cette injure à la vérité, qui laisse supposer l'objectif de l'ouvrage recensé.
Henry-Jean FOURNIER
|
|
LES ANNALES ALGERIENNES
De E. Pellissier de Reynaud (octobre 1854)
Envoyé par Robert
|
|
LIVRE XII
Commencement d'agitation parmi les Arabes de la Mitidja. - Assassinat du kaïd de Beni-Khelil. - Excursions de la commission d'Afrique dans la plaine et à Blida. - Expédition contre les Hadjoutes. - Ben Zécri. - Expédition de Khachna. - Séjour de Vergé parmi les arabes. - Négociations avec Tugurth. - Expédition de Haouch-Hadji. - Seconde expédition contre les Hadjoutes. - Soumission des Hadjoutes. - Paix générale. - Les Européens se répandent dans la Mitidja - Camp de Douéra. -Marché de Boufarik. - Reconnaissance des fermes du Beylik. -Intrigues et faiblesse. - Négociations avec Titteri. - Révolution de Cherchell.
Pendant que M. de la Moricière était à Bougie, M. Gaillard, officier d'ordonnance de M. le général Voirol, dirigea un instant les affaires arabes ; mais des raisons de santé et de convenance personnelle l'ayant bientôt rappelé en France, le général en chef mit à la tète du bureau arabe M. de Laporte, récemment nommé, par le ministre, chef des interprètes. M. de Laporte, naguère chancelier du consulat de France à Tanger, était un parfait honnête homme et un orientaliste des plus distingués ; mais son âge déjà avancé lui ôtait l'activité que réclamait sa nouvelle position.
Nous étions arrivés, au moment de cette nomination, à cette époque de l'année où les Arabes, ayant terminé leurs moissons et ne s'occupant pas encore de semailles, sont assez disposés à s'abandonner à leur humeur vagabonde et aventureuse. Il était nécessaire que l'homme chargé de leurs affaires fût plus que jamais au milieu d'eux, et, malheureusement, M. de Laporte ne montait pas à cheval. Dans la dernière quinzaine d'août, les travailleurs des ponts de Boufarik furent attaqués et dispersés. On accusa de cet acte d'hostilité les gens de Bouagueb et de Haouch-ben-Khelil, lesquels en accusèrent les Hadjoutes. Cette petite levée de boucliers coïncida avec l'arrivée à Alger de la commission d'Afrique, dont nous ferons connaître la mission et les travaux dans un des livres suivants. Le mal était réparable si l'on pouvait punir les coupables. Malheureusement, on fut si mal servi qu'il fut impossible de les connaître, assez du moins pour ne pas craindre de commettre une injustice en frappant ceux qui furent vaguement désignés au général en chef. Le 4° de ligne poussa une reconnaissance sur les lieux, et ne put rien découvrir. Le colonel qui la commandait, tout à fait étranger à ce qui se passait dans le pays depuis quatre mois, fit tirer sur des spahis qui étaient montés à cheval pour se joindre à lui, et en fit arrêter d'autres qui ne durent rien comprendre à cette manière de récompenser leur exactitude à remplir leurs engagements. Ce n'est pas la seule fois que l'ignorance ou la brutalité de quelques chefs militaires a nui à nos relations avec les Arabes.
La reconnaissance du 4° de ligne ayant été sans résultat, il fallait établir des troupes à Boufarik et faire reprendre les travaux sous la protection de nos baïonnettes ; car il ne faut jamais reculer devant les Arabes, et ne leur céder en rien, surtout en ce qui est bon et juste, et tient à l'exercice de la souveraineté. Au lieu de cela, le général Voirol, craignant sans doute l'insalubrité de la position, abandonna l'entreprise commencée. L'insolence de nos ennemis s'en accrut, nos partisans se découragèrent, et tout annonça que cet acte de faiblesse porterait bientôt ses fruits. En effet, le kaïd de Beni-Khelil, Bouzeïd-ben-Chaoua, notre énergique et loyal serviteur, fut insulté, menacé, et, enfin, assassiné, le 9 septembre, au marché de Boufarik Sa mort fut héroïque : il ne fléchit pas un instant devant les factieux, et leur fit entendre jusqu'au dernier soupir la voix d'un chef irrité. La veille du jour qui fut pour lui sans lendemain, Bouzeïd avait été prévenu du danger qui le menaçait ; sa famille tout en larmes voulut le détourner d'aller au marché ; mais il n'écouta rien et partit. A peine arrivé à Boufarik, il se vit entouré de ses ennemis qui se mirent à lui reprocher son amitié pour les Chrétiens. Il leur répondit avec force qu'il était l'ami des lois et de l'ordre, que les Chrétiens n'étaient pas comme eux des perturbateurs et des assassins, et qu'il se faisait gloire de les servir, parce qu'en le faisant, il servait la justice et la raison ; que, du reste, ils eussent à se retirer et à le laisser vaquer aux devoirs de sa charge. Il y eut un instant de trêve ; mais vers la fin du marché, au moment où le kaki se préparait à se retirer, la querelle recommença : toujours les mêmes reproches d'un côté, et la même énergie et les mêmes réponses de l'autre. Les personnes qui m'ont raconté cette tragique histoire, qui s'est passée sous leur yeux, croient que les ennemis de Bouzeïd n'étaient pas bien décidés à le tuer, et qu'il aurait pu se sauver en évitant de les irriter par ses propos ; mais ce brave kaïd était un de ces hommes de fer qui ne plient jamais quand ils ont le droit pour eux. Bouzeïd, toujours entouré des mêmes hommes et leur tenant toujours tête, parvint jusqu'au Pont qui est le plus près du marché, et le dépassa même.
Arrivé là et voyant que les factieux s'acharnaient après lui, il se mit à les menacer de la colère des Français. C'est alors qu'un coup de fusil, bientôt suivi de dix à douze autres, l'abattit de son cheval. Le malheureux expira en remettant le soin de sa vengeance à ceux qu'il avait si loyalement servis. Les assassins se partagèrent ses dépouilles et s'éloignèrent. Le peuple de Boufarik ne prit aucune part à ce meurtre, qui fut l'ouvrage de quelques-uns de ceux que les Arabes appellent les grands, et de quelques brigands de profession. Sidi-Allal-Moubarek passa dans le temps pour n'avoir pas été entièrement étranger à l'assassinat de Bouzeïd. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il était présent, et qu'il ne fit pas tout ce qu'il devait pour l'empêcher, soit par peur, soit par sentiment de son impuissance.
Pendant que la terre de Boufarik buvait le sang du brave Bouzeïd, une partie des membres de la commission d'Afrique, ayant en tête M. le lieutenant général Bonnet, président de cette commission, se disposait à aller visiter Belida, sous l'escorte d'un corps de 4,000 hommes dont le général Voirol prit lui-même le commandement. Le général en chef apprit en route et annonça aux commissaires l'assassinat du kaïd. C'était le lendemain du crime. On n'en continua pas moins la reconnaissance, et l'on traversa Boufarik sans rencontrer personne. A peu de distance de Belida, on trouva une députation qui venait prier les Français de ne pas entrer en ville. M. le général Bonnet et M. le général Voirol crurent devoir accéder en partie au désir manifesté par cette députation. En conséquence, le gros de la troupe s'arrêta. Le général Voirol et M. Piscatory, un des membres de la commission, accompagnés de quelques officiers et d'un faible détachement de cavalerie, pénétrèrent seuls dans la ville. Ils n'y restèrent que quelques minutes, et se replièrent ensuite sur le corps d'armée qui reprit aussitôt la route d'Alger, MM. les commissaires ayant déclaré qu'ils ne voulaient pas en voir davantage. A peine était-on en marche, qu'une centaine d'Arabes vinrent tirailler avec l'arrière-garde, mais à une fort grande distance ; nos soldats, selon la mauvaise habitude qu'ils avaient alors, brûlèrent beaucoup plus de cartouches qu'ils ne devaient. D'un côté, le général Bonnet, qui aurait dû se borner à un pur rôle d'observation, de l'autre, le maréchal de camp qui commandait les troupes sous le général Voirol, firent exécuter des mouvements contradictoires et, du reste, sans but, puisqu'il n'y avait pas, à vrai dire, d'ennemis ; il résulta de tout cela une agitation et un bruit qui firent croire à quelques individus de la classe civile qu'ils avaient assisté à une bataille ; et comme on continuait le mouvement rétrograde, ils en conclurent que nous avions le dessous. Ces individus étaient des Européens d'Alger qui s'étaient mis à la suite de la colonne pour aller, eux aussi, visiter Belida.
Ils tenaient tant à se persuader à eux-mêmes et à persuader aux autres qu'ils avaient couru de forts grands dangers, qu'ils présentèrent cette échauffourée comme une affaire sérieuse.
Ce fut dans ce sens que les journaux en parlèrent. Dans le fait, il n'y eut pas un instant de désordre dans ce mouvement de retraite ou plutôt de retour d'une promenade que l'on savait d'avance devoir être fort courte ; pas une balle ennemie n'arriva dans la colonne ; il n'y eut que deux tirailleurs qui reçurent de légères contusions.
Sous le point de vue militaire, cette affaire, dont retentirent les journaux de l'époque, ne fut donc que ridicule, mais, sous le rapport politique, elle eut un caractère plus grave. L'armée trouva dans le défilé de Boufarik le cadavre d'un malheureux cantinier et celui de sa femme qui avaient été massacrés par les Arabes sur les derrières de la colonne, pendant qu'elle se portait sur Belida.
Les journaux racontèrent que deux enfants, appartenant à ces malheureux, avaient été pendus par les Arabes aux arbres de Boufarik, et que toute l'armée les y avait vus. Il est certain que le bruit s'en était répandu dans la colonne, et que plusieurs personnes étaient tellement préoccupées de cette idée qu'elles crurent en effet les voir. Une d'elles m'a avoué qu'elle resta longtemps persuadée de les avoir eus sous les yeux pendant plusieurs minutes: c'était une erreur d'optique, difficile à expliquer si l'on veut, mais c'était une erreur. Le cantinier massacré n'avait qu'une petite fille de dix ans qui se sauva dans le bois pendant qu'on égorgeait ses parents, qui fut recueillie par des femmes arabes et ramenée à Alger peu de jours après. Cette pauvre orpheline a été adoptée par M. Sapity, directeur de l'hôpital Caratine.
Ce double crime et celui qui avait été commis la veille sur la personne du malheureux kaki auraient dû être punis sur-le-champ et d'une manière exemplaire. Les villages du quartier de Boufarik, où sans aucun doute se trouvaient les coupables, n'étaient pas dégarnis de leurs habitants; on en eut la certitude par deux Européens que les Arabes avaient arrêtés et conduits dans un de ces villages, et qu'ils ne relâchèrent qu'en voyant notre artillerie se préparer à diriger son feu sur leurs habitations, où se trouvaient encore leurs femmes, leurs enfants et tout ce qu'ils possédaient. Il fallait s'établir à Boufarik, cerner les villages, s'emparer des troupeaux, faire sur les lieux une enquête sévère qui aurait amené des résultats; car les partisans de Bouzeïd, nous voyant bien décidés à agir avec vigueur, seraient venus nous donner des renseignements utiles à la justice. Les indifférents eux-mêmes auraient contribué à nous livrer Ies coupables, dans la crainte d'être confondus avec eux. L'armée s'attendait à quelque chose de semblable, tant il lui paraissait peu convenable qu'on laissât tant de méfaits impunis. Elle comptait donc s'arrêter à Boufarik Son mécontentement fut grand lorsqu'elle vit qu'on continuait à la faire marcher sur Douéra, où elle arriva le soir, écrasée de fatigue, peu satisfaite de sa journée et, il faut bien le dire, de ses chefs.
Le commandement fut de fait tellement partagé dans la journée du 10 septembre, que la responsabilité morale doit l'être également, bien que la responsabilité légale ne puisse porter que sur le général Voirol. Cependant la commission fit publier à Alger un avis où, sous prétexte d'indiquer la nature et la forme des réclamations qui pourraient lui être adressées, elle prévenait le public qu'elle ne prenait aucune part aux opérations politiques et militaires, et qu'elle se contentait de les voir et de les juger. Cette pièce était évidemment dirigée contre le général Voirol. Elle était peu généreuse, et en outre elle était coupable : car, dans un moment où tout annonçait la guerre, elle ne tendait à rien moins qu'à faire perdre au général en chef la confiance des troupes. Ce dernier aurait donc pu à la rigueur sévir contre celui qui la signa, et il aurait non-seulement pu, mais dû suspendre sur-le-champ de ses fonctions le chef du service de la police qui laissa afficher cette pièce, laquelle dans une armée ne pouvait être considérée que comme factieuse. Or, à cette époque, ce qu'on appelait l'établissement d'Alger n'était encore qu'une armée.
Les troupes, comme nous I'avons dit, étaient rentrées peu satisfaites de l'expédition du 10 septembre; mais, comme le général Voirol en était aimé, et que, du reste, il existe toujours en elles un grand esprit de justice, elles ne lui adressèrent pas d'autres reproches que celui que l'impartialité de l'historien nous force de lui adresser nous-même. Tout le poids de leur indignation retomba sur ceux qui avaient voulu le détourner; dans leurs idées, les choses auraient pris une autre tournure sans le cieux général et ceux qu'elles désignaient par la qualification dont se servent les soldats en parlant de tout ce qui ne porte pas l'uniforme. Le général Voirol ne tarda pas à leur annoncer, par la voie de I'ordre du jour, que leur vengeance n'était que différée, et que bientôt les crimes commis presque sous leurs yeux seraient punis.
Pendant les quelques semaines qui s'écoulèrent entre la publication de cet ordre du jour et l'expédition annoncée, le bureau arabe chercha à connaître les détails de l'assassinat de Bouzeïd. Il ne put pour le moment avoir que des renseignements fort incomplets. Les Hadjoutes paraissant les vrais coupables, ce fut contre eux qu'on dirigea l'expédition. Le général Trobriand la commanda. Il partit d'Alger avec des forces imposantes, passa le Masafran à Mocta-Kera, et pénétra chez les Hadjoutes, qui s'enfuirent à son approche. Leurs villages furent incendiés, mais on ne put les atteindre. Au retour, ils vinrent tirailler de fort loin, et ne nous firent ni ne reçurent aucun mal. Le corps d'expédition rentra après être resté cinq ou six jours en campagne.
Cette expédition prouva bien que nous n'avions pas oublié le meurtre de Bouzeïd ; mais, comme elle frappa à faux, et sur des gens qui n'étaient pour rien dans cette affaire, elle exaspéra les Hadjoutes, qui, dès ce moment, ne cessèrent de faire des courses sur les terres des gens de Beni-Khelil.
M. le général Voirol, voulant donner une nouvelle preuve que les services de Bouzeïd n'étaient pas méconnus, nomma, dans le mois de novembre, son fils Allal kaïd de Beni-Khelil. Celui-ci était loin d'avoir l'énergie de son père, mais il en avait le dévouement. Afin de le soutenir dans ce poste glissant, on mit auprès de lui, peu de temps après sa nomination, M. Vergé, sergent-major au bataillon de zouaves, jeune homme plein de courage et de capacité, qui connaissait parfaitement la langue et les usages des Arabes. Oulid-Bouzeïd, animé par ses discours, et encore plus par son exemple, prit un peu de force; il alla présider le marché de Boufarik. L'outhan lui remboursa la valeur des objets enlevés à son père après son assassinat, et ce crime parut dès lors oublié. Le général Voirol demanda au Gouvernement une faible pension de cent écus pour la famille Ben-Chaoua, qui n'est pas riche, et dont le chef avait versé son sang pour nous; on aura de la peine à croire qu'elle fut refusée, surtout lorsque l'on saura que Ben-Omar en touchait une de 6,000 francs, et qu'une semblable venait d'être accordée à Ben-Zécri.
Ce Ben-Zécri était un réfugié assez obscur de la province de Constantine, qu'un concours de circonstances heureuses pour lui fit passer, aux yeux du général en chef, pour un personnage d'importance qui pouvait nous être tort utile. C'était un homme qui allait bien au feu, mais du reste complètement nul. On l'établit au fort de l'Eau, avec quelques cavaliers et quelques fantassins indigènes ; pendant un an, ses fonctions se réduisirent à celles de sergent de vétérans, si ce n'est que lui et ses gens nous coûtaient 18,000 francs, ce qui était exorbitant pour la garde d'un point d'aussi peu d'importance que le fort de l'Eau.
M. Vergé resta assez longtemps auprès d'Oulid-Bouzeïd. Il serait parvenu à des résultats encore plus importants que ceux que nous venons de rapporter, s'il avait pu s'appuyer sur quelques cavaliers soldés; mais l'utile institution des spahis avait été abandonnée dès le mois d'octobre. On les crut inutiles, parce qu'on ne sut pas les employer, la pensée qui avait présidé à leur formation n'étant plus celle qui, à cette époque, dirigeait les affaires arabes. M. Vergé ne borna pas ses courses à l'outhan de Beni-Khelil : il pénétra jusque dans les montagnes de celui de Khachna, où il fut bien reçu.
Quelque temps auparavant, une expédition, conduite par le colonel Schauenbourg, commandant le 1er régiment de chasseurs d'Afrique, avait été dirigée sur cet outhan, dont un habitant avait enlevé, avec son consentement du reste, la maîtresse d'un des cavaliers de Ben-Zécri. Par une de ces contradictions qui nous caractérisent, nous punîmes cette peccadille amoureuse avec beaucoup plus d'exactitude que le meurtre du fidèle Bouzeïd. Le colonel Schauenbourg s'empara de beaucoup de bétail dont le général en chef ne sut que faire, lorsqu'il connut les détails tout à fait inoffensifs de l'enlèvement de la nouvelle Hélène. Il profita, quelque temps après, de la bonne réception faite, dans l'outhan, au sergent-major Vergé, pour rendre en argent la valeur du bétail, comme témoignage de satisfaction, et sans paraître revenir sur un acte de l'autorité. Comme il fut bientôt démontré que le jeune fils de Bouzeïd n'aurait jamais les qualités propres au commandement, le général Voirol songea un instant à nommer M. Vergé kaïd de Beni-Khelil, et le ministre le laissa libre d'agir à cet égard comme il le jugerait convenable; mais, comme cette mesure pouvait avoir des conséquences qui se rattachaient à tout un nouveau système, il ne crut pas devoir mettre son projet à exécution dans la position intérimaire où il se trouvait. Le grade de sous-lieutenant fut peu de temps après la récompense des services du sergent-major Vergé.
Dans le mois de janvier 1834, on vit arriver à Alger un envoyé d'Ali-ben-Djellab, cheikh de Tugurth. Nous avons fait connaître, en parlant de la province de Constantine, la position de cette ville, centre d'un état assez florissant. Les Arabes donnent par déférence le titre de Sultan au petit prince de Tugurth, mais il ne prend officiellement que celui de cheikh. Il est riche et vit avec un certain éclat. Le pouvoir est héréditaire à Tugurth dans la famille des Beni-Djellab. Le cheikh de Tugurth était au nombre des ennemis d'Ahmed, bey de Constantine. Dans les premiers mois de 1855, il fit marcher contre lui quelques troupes, que le bey vainquit, grâce à son artillerie. Ben-Djellab en conserva un profond ressentiment, et, d'après les conseils de Farhat-ben-Saïd, il résolut de contracter avec la France une alliance, dont le but serait de renverser Ahmed et d'élever à sa place le cheikh de Tugurth lui-même, qui reconnaîtrait la souveraineté de la France et lui paierait tribut. L'envoyé de Tugurth arriva à Alger par Tunis. Lorsqu'il se présenta au consul de France dans cette résidence, il était dans un état presque complet de dénuement, qu'il expliqua en disant qu'il avait été dépouillé par les Kbaîles au-dessus de Kairouan. Du reste, il était porteur de lettres de créance qui parurent en règle Le consul de France l'envoya en conséquence au général Voirol par le premier bâtiment partant pour Alger. Les offres qu'il fit, au nom de son maître, étaient tellement avantageuses, qu'elles parurent exagérées; cependant on y répondit de manière à donner suite à la négociation. L'ambassadeur partit très satisfait de la réception qu'on lui avait faite. Il ne revint que sous l'administration du comte d'Erlon.
Le cheikh de Tugurth ne fut pas le seul ennemi d'Ahmed-Bey qui se mit en relation avec le général Voirol. dans le but de renverser cet homme féroce, mais habile et redoutable. Farhat-ben-Saïd, qui se maintenait toujours dans le Sahara, El-Hadji-Abd-el-Salem, cheikh de Medjana, qui, par sa position, était maître du fameux passage des Bibans ou Portes de Fer, Hasnaoui, cheikh des Hanencha, Abou-Diaf-ben-Ahmed, cheikh de la puissante tribu nomade des Oulad-Maadi, enfin Bel-Cassem, cheikh de Skikda ou Stora, ce point si important de la côte, s'adressèrent tous au général en chef pour lui offrir leur coopération dans le cas d'une expédition sur Constantine, et même pour le prier de régulariser au moins leurs efforts en leur fournissant quelques secours en artillerie, en traçant le plan d'attaque, et enfin en les aidant des lumières et de l'expérience de quelques-uns de nos officiers. Que l'on diminue de moitié les espérances de succès que pouvaient faire naître tant de démonstrations amicales, que l'on fasse à la mobilité du caractère arabe une part aussi large que l'on voudra, et que l'on admette même que quelques-unes des ouvertures qui nous furent faites n'avaient d'autre but que de sonder nos intentions, il n'en demeurera pas moins avéré, par tous ceux qui ont suivi ces négociations et qui ont pu comparer les paroles avec les actions, les antécédents avec la position présente, et analyser les intérêts mis en jeu, que nous avons eu, dans le courant de 1854, de grandes chances d'établir notre autorité dans la province de Constantine. Le Gouvernement ne pouvait sans doute s'engager dans une entreprise de cette importance, sans avoir autre chose que des promesses; il voulait des garanties, et il avait raison. Ces garanties étaient bien offertes, mais il les exigeait comme éléments de la décision à intervenir.
Or, le général en chef ne pouvait évidemment mettre les parties en demeure de les fournir, sans leur donner en échange, non les éventualités d'une délibération du conseil des ministres, mais l'assurance d'un parti pris et arrêté dont l'exécution ne dépendrait plus que de ces mêmes garanties: en effet, ces garanties ne pouvaient être que la remise d'étages, des fournitures de bétail et de vivres, ou enfin des dépôts d'argent, toutes démarches tellement significatives qu'elles devaient sur-le-champ mettre ceux qu'elles concernaient en état d'hostilité contre Ahmed et ses partisans. La guerre devait donc s'ensuivre immédiatement, et par conséquent les secours fournis par la France, quelles qu'en fussent la nature et l'étendue, ne devaient pas se faire attendre.
Il existait donc, dans la manière dont ces négociations furent conduites, un cercle vicieux qui devait en éloigner le terme indéfiniment. Le général Voirol se vit forcé d'employer des faux-fuyants avec des gens qui avaient bâte de conclure, et qui finirent par douter de la puissance de la France, ou du moins de sa volonté de s'établir en Afrique.
Tout fut paisible dans la province d'Alger dans l'hiver de 1855 â 1854, excepté du côté des Hadjoutes, qui commirent des vols continuels au détriment des gens de Beni-Khelil, et surtout au détriment des habitants du Sahel, qu'ils regardaient comme nos alliés les plus directs. Ceux-ci se trouvaient sans défense depuis que la rigueur de la saison des pluies nous avait forcé de lever le camp de Douéra, où il n'y avait point encore d'établissement. On crut d'abord que quelques lettres menaçantes suffiraient pour arrêter les brigandages des Hadjoutes, mais ils n'en tinrent nul compte. Vers le milieu de janvier, on résolut d'enlever de la ferme d'Haouch-Hadj, où on les disait réunis, les plus déterminés de ces pillards. Une colonne commandée par M. de la Moricière, et composée de quatre compagnies de zouaves et d'une centaines de chevaux, partit dans la soirée du 20 pour cette ferme, éloignée d'Alger de 14 lieues. L'infanterie ne devait qu'appuyer le mouvement de la cavalerie dirigée par l'aide de camp du général Voirol. Mais cet officier, trompé par les distances encore imbu d'idées de guerre méthodique, peu applicables au pays, et ayant d'ailleurs rencontré un marais où il fut obligé de laisser une partie de son monde, ne mit pas dans son mouvement la promptitude nécessaire, n'arriva qu'au jour, et ne put saisir les pillards qui l'aperçurent et s'évadèrent. Il ne resta à Haouch-Hadji que des femmes et des enfants, à qui on ne fit aucun mal. Au retour de la ferme, d'où on enleva des armes et quelques chameaux, la petite colonne fut assaillie par les Hadjoutes, mais elle rentra sans avoir éprouvé de perte en hommes, et n'ayant eu que quelques chevaux blessés.
Cette petite expédition, quoiqu'elle n'eut pas atteint le but qu'on se proposait, rendit néanmoins pour quelque temps les Hadjoutes plus circonspects : ils firent plusieurs fois demander la paix, mais on y mit toujours pour condition la restitution du bétail enlevé aux Beni-Khelil, à quoi ils ne voulurent jamais consentir. On profita alors du besoin que ceux-ci avaient de nous pour établir une sorte de hiérarchie administrative dans leur outhan, que l'on divisa en cantons, à la tête de chacun desquels on mit un cheikh. On étendit plus tard cette mesure à Khachna et à Beni-Mouça. C'était faire renaître des idées d'ordre presque perdues depuis quatre ans, les kaïds ayant besoin, pour asseoir leur autorité, de fonctionnaires inférieurs. Le général Voirol était dans l'intention de donner un traitement aux kaïds et aux cheikhs, et d'attacher à leurs personnes quelques cavaliers soldés. La demande d'allouer un traitement aux kaïds, quoique basée sur un arrêté du général Clauzel, fut rejetée par le ministre. Quant à la proposition de créer une force publique dans les outhans, elle fut repoussée comme impolitique, sans que Son Excellence daignât expliquer ce qui la lui faisait considérer comme telle. La seule chose qu'accorda le ministre, ce fut l'autorisation de donner des fusils de commandement aux kaïds et cheikhs nouvellement promus. Un crédit fut ouvert à cet effet.
Malgré les refus du ministère, on n'en continua pas moins l'organisation commencée, et les kaïds et une grande partie des cheikhs eurent une solde. Voici comment on s'y prit : on créa, aux termes de l'ordonnance du 17 novembre 1831, et en revenant aux errements de l'arrêté du 5 août 1833, un certain nombre de spahis que l'on considéra comme en service permanent, ce qui procurait une solde de 80 francs par mois et par homme. On fit figurer sur les états de ces spahis les noms des kaïds et des cheikhs. Toutes les soldes réunies formaient une masse que l'on distribua de la manière suivante : 80 fr. aux kaïds, 60 aux cheikhs, et 30 aux simples cavaliers, dont le nombre fut beaucoup plus considérable que celui qui était porté aux états. Tout le monde fut satisfait de cet arrangement, dont on ne vit que le résultat. S'il n'y avait pas de crédit pour les kaïds et les cheikhs, il y en avait un pour les spahis, de sorte que, par un simple changement de dénomination, on obtint ce qu'on n'avait pu obtenir par le raisonnement. Au reste, quoique le ministre n'eût pas adopté le plan qu'on lui avait proposé, il désirait que quelqu'un fit la police du pays, puisqu'il laissait établir des spahis. Le but fut atteint, et l'aurait été encore mieux, si l'on avait donné plus d'extension à la mesure; mais on ne voulut pas dépasser certaines bornes, sur un terrain solide, il est vrai, sous le point de vue moral et politique, mais un peu glissant sous le rapport administratif. Les dépenses pour cet objet, dans le courant de l'année 1834, ne dépassèrent jamais 3,000 fr. par mois à Alger, et souvent n'allèrent pas à 2,000.
Les kaïds et les cheikhs étant payés, et pouvant, dans les localités les plus importantes pour nous, se servir de quelques cavaliers également soldés, se sentirent définitivement liés à notre cause, et remplirent leur devoirs avec plus de zèle. Ils arrêtèrent les malfaiteurs, et firent enfin la police du pays. Vers le milieu de mai, le camp de Douéra ayant été occupé de nouveau et définitivement, et les Hadjoutes ayant recommencé leurs courses, le général en chef résolut d'en finir avec eux. Les gens de Beni-Khelil et ceux de Beni-Mouça étant disposés à marcher avec nous, leurs kaïds reçurent l'ordre de se trouver, le 17 mai dans la nuit, aux ponts de Boufarik, avec le plus de monde qu'ils pourraient réunir. Le général Bro se dirigea sur le même point avec 2,000 hommes d'infanterie et de cavalerie et quelques pièces de canon. Les Arabes avaient été exacts au rendez-vous; le lendemain 18, nous pénétrâmes sur les terres des Hadjoutes, précédés de 600 auxiliaires en burnous. Le corps d'expédition se dirigea sur le bois de Kareza, entre l'Ouedjer et la Bouroumi, où l'on savait que les ennemis avaient conduit leurs troupeaux. On y pénétra vers le soir et on y fit un butin considérable, que l'on abandonna aux auxiliaires, en dédommagement des pertes qu'ils avaient éprouvées depuis quelques mois. Les Hadjoutes, qui avaient reconnu tout d'abord l'inutilité de la résistance, ne songèrent pas même à combattre. Quelques Kbaïles de Chénouah, qui se trouvaient chez eux, tirèrent seuls, en fuyant, quelques coups de fusils sur nos troupes. Le fils de Sidi-Allal, marabout, se présenta pour traiter de la paix au nom des Hadjoutes; mais, comme il ne put s'engager à donner des otages, ni à faire rendre le bétail volé, le général Bro continua les hostilités. Le lendemain, au moment où il se préparait à faire une battue générale dans le bois de Kareza, un cavalier se présenta à notre avant-garde et demanda à parlementer. M. Vergé et M. Pellissier, nommé récemment chef du bureau arabe, s'abouchèrent avec lui.
II dit, au nom de ses compatriotes que, si l'on voulait leur accorder la paix, ils s'engageraient à indemniser les Beni-Khelil, sous la condition que le bétail qu'on leur avait pris la veille serait compté en déduction de celui qu'ils seraient condamnés à rendre par le marabout de Coléa, qui serait juge dans la question. Il promit en outre que Ies Hadjoutes prendraient un kid nommé par le général en chef, qui avait d'avance destiné ce poste à Kouider-ben-Rebeha. On rendit compte de ces propositions au général Bro. Celui-ci voulut voir lui-même l'envoyé des ennemis. Comme il hésitait à revenir, M. Vergé, pour exciter sa confiance, se rendit au milieu des Hadjoutes, et y resta pendant tout le temps de la conférence du général et du parlementaire arabe. Cette conférence fut sans résultat, car le général voulait des étages, et l'Hadjoute disait que dans l'état d'anarchie où se trouvaient ses compatriotes, ils ne pouvaient en donner, attendu qu'ils n'avaient point de chef pour les désigner, et que personne ne se présenterait volontairement. Les hostilités recommencèrent donc. Le bois de Kareza fut fouillé dans toute son étendue, et nos auxiliaires firent un butin si considérable, qu'ils furent plus que dédommagés de toutes leurs pertes. On brûla aussi quelques villages, et l'on chercha à incendier les récoltes, mais elles étaient encore trop vertes pour que le feu y prit.
Le jour d'après, un nouveau parlementaire se présenta, non plus pour parler de paix, mais, ce qui était mieux, de soumission. Les Hadjoutes reconnurent pour kaid Kouider-ben-Rebeha, et s'engagèrent à rendre libres les routes de l'ouest. Il ne fut plus question d'otages. On convint que ce qui était pris l'était bien, et que, de part et d'autre, on oublierait le passé. Le petit corps d'armée du général Bro reprit alors la route d'Alger. Une dizaine de coups de fusil furent tirés, pendant la marche, sur l'arrière-garde, par des Hadjoutes isolés, qui ne savaient pas ce qui venait de se passer avec le gros de la tribu; mais aussitôt qu'ils l'eurent appris, ils se retirèrent, et nous envoyèrent un des leurs pour s'excuser.
Cette expédition fut la première qui se termina par une négociation régulière avec les vaincus, et où nous ayons eu des Arabes pour auxiliaires. L'usage que l'on fit du butin, tout à fait conforme à la sage politique que le général Voirol avait adoptée dès le principe, prouva que la justice seule lui mettait les armes à la main. Cette vérité, sentie par tout le monde, augmenta le nombre de nos partisans.
Il y eut, quelques jours après la rentrée du corps d'expédition dans ses cantonnements, une grande cérémonie à Blida, où les Hadjoutes et les Beni-Khelil cimentèrent la paix avec toutes les formalités consacrées par l'usage et la religion. Le général en chef rendit alors la liberté à Sidi-Mohammed, le plus célèbre des marabouts de Colée, détenu à Alger depuis le combat de Boufarik, sous le duc de Rovigo, et dès lors la tranquillité la plus parfaite régna dans la plaine. Pour prévenir les petites perturbations qui auraient pu naître, le général en chef voulut établir, pendant quelque temps, dans l'outhan de Beni-Khelil, un commissaire investi de pouvoirs supérieurs à ceux du kaïd. Il fit choix de Ben-Omar, ex-bey de Titteri, qui s'établit à Haouch-Kaladji, près de Douéra.
Le général Voirol, considérant alors que tout ne consistait pas à faire régner la paix parmi les Arabes, mais qu'il fallait encore les habituer à nous voir en amis au milieu d'eux, envoya fréquemment sur divers points de la plaine les officiers attachés au bureau arabe pour examiner l'état du pays, écouter Ies plaintes et étudier les besoins des habitants. Le chef du bureau arabe et M. Allégro, jeune Tunisien, qui, pour le courage et l'intelligence, ne le cédait à aucun Français, se rendirent au marché de Boufarik, la première fois que Sidi-Mohammed y parut depuis sa captivité. Kouider-ben-Rebeha s'y trouva avec un grand nombre d'Hadjoutes. Ces messieurs l'engagèrent à se rendre à Alger, où il n'avait pas mis les pieds depuis trois ans. A cette proposition, les Hadjoutes murmurèrent le nom de Meçaoud, si indignement décapité sous le duc de Rovigo. M. Allégro prit alors la parole, et leur proposa de rester au milieu d'eux pendant que Kouider irait à Alger. Cette proposition fut accueillie avec empressement. Kouider fut très bien reçu par le général en chef, qui fut très-satisfait de la sagesse de son langage et de la dignité de ses manières. Il resta plusieurs jours à Alger, et fut ramené par le chef du bureau arabe à Mokta-Kera, où se rendirent de leur côté le marabout de Colée, une cinquantaine d'Hadjoutes et M. Allégro, que ses hôtes avaient fêté de leur mieux.
La confiance étant ainsi rétablie de part et d'autre, tout parut possible. L'espérance fondée, selon moi, de tirer parti des Arabes pour la défense et la prospérité matérielle du pays, ramena le général en chef à des mesures d'avenir abandonnées dans ces moments de découragements si fréquents, et je dirai si naturels, lorsqu'on travaille sur des éléments aussi difficiles à étudier que ces peuples. La garde des blockhaus fut confiée, comme dans la dernière année, aux habitants du Fhas, et l'on unit à Rassoutha, ferme du beylik, située à deux lieues en avant de la Maison-Carrée, les Arib dispersés dans les diverses tribus de la Métidja, pour en former une colonie militaire. Le général Voirol avait conçu le projet de cette réunion dans l'été de 1835, mais l'exécution en ayant été confiée à Ben-Zécri, il échoua pour lors complètement
Les Arib, comme nous l'avons déjà vu, sont des Arabes originaires du Sahara, qui vinrent s'établir dans la plaine de Hamza, d'où les Oulad-Maadi les chassèrent. Un grand nombre d'entre eux se réfugièrent dans la Métidja. Comme ils n'y trouvèrent pas tous des moyens légaux d'existence, ils se mirent, pour la plupart, à y exercer le brigandage, de sorte que leur présence y était, en général, une vraie calamité. En les réunissant tous sur un point, et en leur donnant des terres à cultiver, à la charge du service militaire, on pouvait faire des éléments d'ordre de ces vagabonds dangereux. Cette réunion eut lieu deus le mois de juin 1854. On permit aux Arib de cultiver pour leur compte l'immense territoire de Rassoutha, moins les prairies du bord du Hamise. On leur donna des charrues, et on leur fit des avances en semences. Le projet du général Voirol était d'introduire peu à peu chez eux nos procédés agricoles et d'en faire une tribu modèle qui, par le bien-être dont elle aurait joui, aurait donné aux autres la preuve de l'avantage de nos méthodes de travail et de la douceur de nos lois. C'était certes une belle et noble pensée. Les Arib, dont Ben-Zécri fut nommé kaïd, sous la surveillance immédiate du bureau arabe, s'engagèrent, de leur côté, à prendre Ies armes chaque fois qu'ils en seraient requis pour la défense commune, à monter la garde au fort de l'Eau et à la Maison-Carrée, et à faire la police de cette partie de la plaine, au moyen d'un service de patrouilles régulièrement établi. Ils s'acquittèrent loyalement de leurs promesses, et nous n'eûmes qu'à nous louer d'eux. Mais, pour qu'ils pussent rompre avec le passé, il fallut les amnistier pour leur anciens brigandages et interdire toute poursuite pour les faits antérieurs à leur réunion.
La paix et la confiance s'affermissant de plus en plus, un avis officiel annonça aux Européens que ceux d'entre eux qui voudraient visiter la plaine pour leurs plaisirs ou pour leurs affaires le pouvaient sans crainte; que cependant, pour ne rien laisser au hasard, ils devaient se présenter au bureau arabe, qui leur donnerait des lettres de recommandation pour les cheikhs des cantons, lesquels leur fourniraient, moyennant une légère rétribution, des guides armés. Cette mesure fut très-bien accueillie du public européen et des Arabes. Un grand nombre d'Européens parcoururent la plaine dans tous les sens; des voitures françaises conduisirent jusqu'au pied de l'Atlas des meules à un marabout qui faisait construire un moulin. Un vol ayant été commis par les gens de l'outhan de Khachna, nos gendarmes allèrent au loin arrêter les coupables ; enfin le procureur du roi d'Alger, voulant aussi instrumenter dans la plaine, fit en personne une arrestation dans celui de Beni-Mouça.
Tout ce qu'on avait entrepris depuis la paix avec les Hadjoutes ayant réussi au-delà de toute espérance, on songea à introduire des Européens sur les marchés des Arabes. En conséquence, le chef du bureau arabe alla coucher à Douéra le 2 juin, pour se présenter le lendemain à celui de Boufarik, avec plusieurs personnes de la classe civile. Mais cette démarche ne plaisait point à Ben-Omar, qui aspirait aux fonctions d'agha, dont il se faisait même donner le titre par ses affidés. Il souffrait de voir les Français agir directement sur les Arabes. En conséquence, il écrivit au général en chef qu'il savait, d'une manière certaine, que les Européens qui se rendraient au marché courraient de grands dangers. Le général, trompé par ce faux rapport, envoya contre-ordre au chef du bureau arabe, qui se le fit répéter, car il avait des renseignements positifs sur la situation des esprits et sur le mauvais vouloir de Ben-Omar. Dès quatre heures du matin, il était entouré de plus de cent cavaliers arabes qui étaient venus à sa rencontre ; mais il fallut obéir : au lieu d'aller au marché, il se dirigea sur la ferme du kaïd de Beni-Mouça, où il passa la nuit. Dans la soirée, le kaïd de Beni-Khelil et une trentaine de cavaliers vinrent lui dire qu'on l'avait attendu longtemps à Boufarik, et que, lorsque le Maure Ben-Omar s'y était présenté, il avait été froidement reçu ; qu'alors, croyant plaire aux Arabes, il avait dit que c'était lui qui, par son adresse, avait empêché les Français d'y venir, et qu'à cela on lui avait répondu qu'il avait eu tort, attendu que, puisque les Musulmans étaient bien reçus sur les marchés des chrétiens, on ne voyait pas pourquoi ceux-ci ne pourraient pas venir sur les leurs. Cette conclusion très logique déconcerta Ben-Omar. Mais malheureusement, ceux des Arabes qui n'étaient que résignés à nous voir au milieu d'eux, voyant chez nous de l'hésitation, et dans un de nos principaux agents des dispositions hostiles au système que nous paraissions avoir adopté, revinrent à l'espérance de nous éloigner. Ces opposants étaient en général les grands des tribus, qui avaient intérêt à ce que nous ne fussions pas témoins des petites vexations qu'ils font éprouver au peuple.
Cependant, le lundi suivant, le général en chef ayant été convaincu de la fausseté des rapports de Ben-Omar, le chef du bureau arabe se rendit au marché de Boufarik avec quelques Européens, et fut bien reçu. Cela continua pendant quelque temps.
Dans le courant du mois de juillet, le général Voirol fit procéder à une opération fort utile, celle de la reconnaissance des fermes du beylik, dans les outhans de Beni-Khelil, de Beni-Mouça et de Khachna. Cette opération constata l'existence, et donna la position et la description de dix-neuf beaux domaines, tous susceptibles d'un grand rapport. Elle fut faite par M. Bernadet, contrôleur des domaines, et par le chef du bureau arabe. La position dé chaque ferme fut relevée et indiquée sur la carte du pays, par le chef du service topographique. La plupart de ces fermes furent louées à bas prix aux Arabes, qui déjà les habitaient sans titres, mais pour un an seulement, et dans le but de constater, aux yeux de tous; notre prise de possession. Il est à remarquer que, de ces dix-neuf fermes, il y en a sept qui occupent une zone de près de cinq lieues de longueur, dans le milieu de la Métidja, et au centre desquelles se tient le marché de Boufarik; ce sont, de l'ouest à l'est : Haouch-ben-Salah, Haouch-ben-Khelil, Haouch-bou-Agueb, Haouch-Chaouch, Haouch-Souk-Ali, Haouch-bou-Ladjoura et Haouch-Mimmouch, dont le beylik n'a que la moitié. Le terrain en est d'une fertilité admirable ; elles sont bien boisées et bien arrosées, ayant toutes de vastes jardins et de superbes vergers d'orangers.
Pendant la durée de l'opération dont nous venons de parler, et, par conséquent, l'éloignement du chef du bureau arabe, Ben-Omar, qui remplissait toujours ses équivoques fonctions dans l'outhan de Beni-Khelil, parvint à faire destituer Oulid-Bouzeïd-ben-Chaoua; qui du reste était incapable, et à faire nommer à sa place El-Arbi-ben-Brahim, cheikh de Beni-Salah, qui avait déjà été kaïd une fois. C'était un homme de mérite, mais il affectait une indépendance qui aurait dû l'éloigner de ces fonctions. Le premier acte de son administration rut de déclarer aux Français qui se rendirent au marché, la première fois qu'il le présida, que leur présence à Boufarik était une déclaration de guerre, et qu'ils ne pouvaient plus s'y présenter qu'en ennemis. Une centaine de cavaliers appuyèrent de démonstrations plus ou moins hostiles ces paroles du kaïd. Deux jours après, il écrivit au général en chef qu'il avait été forcé de paraître adopter les passions de la multitude pour sauver les Français et éviter les plus grands malheurs. El-Arbi attribuait ici à la multitude ce qui n'était le fait que de quelques grands, pour parler lé langage des Arabes, et le fait du kaïd lui-même. Au reste, il ajouta "que, si l'on voulait continuel à fréquenter le marché de Boufarik, il fallait y envoyer dés troupes tous les lundis, pour en faire police. C'est le parti que l'on aurait dû prendre; mais on préféra reculer devant les répugnances de quelques Arabes, entretenues par les intrigues du Maure Ben-Omar. Celui-ci, le jour où les Français furent en quelque sorte expulsés du marché, avait eu dans la matinée un entretien secret avec El-Arbi au premier pont de Boufarik C'est ainsi que, deux ans de suite, des insultes non vengées vinrent nous faire perdre tout le terrain gagné par une politique de douceur et de persuasion, mais qui devient impuissante dès l'instant qu'elle craint au besoin de s'appuyer sur la force.
Ce qui venait de se passer à Boufarik, et notre patience à le supporter, firent sourire les ennemis de notre domination, et arrêtèrent tout court, dans leur mouvement d'attraction, ceux qui étaient disposés à venir à nous. Kouider-ben-Rebeha prit des prétextes pour ne plus paraître à Alger. Les Hadjoutes auraient peut-être recommencé à intercepter les routes de l'ouest, si le vénérable marabout Mohammed ne les eût menacés de les maudire et de se retirer à Alger, dans le cas où ils troubleraient le moins du monde la paix. Les Européens n'osèrent plus s'étendre dans le pays ; enfin, il y eut rétrogradation sensible. Ben-Omar, dont le général en chef comprit enfin les secrètes intentions, rentra de nouveau dans l'obscurité dont il n'aurait jamais dû sortir ; mais le mal était fait.
Le kaïd de Khachna, El-Mokfy, étant mort sur ces entrefaites, le général en chef nomma à sa place El-Arbi-ben-Kaïa, sur la demande de l'outhan.
Les mois d'août et de septembre se passèrent sans événements importants dans les environs d'Alger. A Titteri, on fit quelques efforts pour sortir de l'anarchie. Voici ce qui se passa dans cette province. A Médéa, le parti d'Ahmed-Bey, presque tout composé de Koulouglis, était parvenu à faire reconnaître hakem de la ville un certain Mohammed-el-Khadji, qui s'intitulait lieutenant du bey de Constantine. Le parti français, qui était découragé, ne s'opposa pas ouvertement à cette nomination, mais il fit connaître au général en chef combien elle était hostile pour nous, et le pria de déclarer une fois pour toutes si la France voulait ou ne voulait pas de Médéa. Pour comprendre ce langage; il est nécessaire de savoir que Ben-Omar avait toujours conservé des rapports avec ses anciens amis de Médéa, et qu'il avait eu soin de les entretenir dans la pensée que les Français n'avaient pas renoncé à rétablir leur autorité et la sienne dans cette ville. Dans l'hiver précédent, il y avait même eu quelques négociations entamées dans ce sens ; mais elles n'aboutirent, et ne pouvaient aboutir à rien, par les raisons que nous avons expliquées en parlant de celles de Constantine.
Peu de jours après avoir reçu la lettre des gens de Médéa, le général Voirol en reçut deux autres de la province dont cette ville est la capitale. La première était des Abid et des Douair de Berouakia qui, las d'être confondus avec les autres tribus, et de ne plus jouir des avantages et de la prépondérance que leur valait leur position auprès des anciens beys, offraient leurs services à la France, dans le cas où elle voudrait établir un gouvernement de son choix à Titteri. La seconde était de Ben-Aouda-el-Moktari, cheikh des Oulad-Moktar, qui, ayant à se plaindre du hakem de Médéa, Mohammed-el-Khadji, faisait des offres dans le même sens, conjointement avec Djelloul, cheikh des Oulad-Aïed, Ben-Chara, cheikh de Rbeia, beau-père de l'ancien bey Bou-Mezrag, et Djedid, cheikh d'Oulad-Chaïb. On répondit à tous ces gens-là de s'entendre, afin de faire en commun des offres acceptables qui pussent servir de base à une négociation régulière. Dans la pensée qui dirigea cette affaire de notre côté, c'était Ben-Aouda-el-Moktari qui devait être nommé bey de Titteri, comme étant celui qui, ayant déjà plus de puissance réelle, devait rencontrer le moins de difficultés. Mais cet homme, considérant que le titre de bey lui ferait des jaloux parmi ceux qui étaient encore ses égaux, qu'il lui imposerait l'obligation de s'établir Médéa, où il craignait d'avoir des ennemis, et ne voulant pas peut-être trop s'engager avec nous, fit décider, dans une réunion qui eut lieu à Beni-Bouagueb, que l'on proposerait au général en chef de reconnaître pour bey Ben-Omar, nommé à ce poste par le général Clausel, et chez lequel ce titre était déjà une chose acquise qui ne devait pas exciter de jalousie ; que ce bey résiderait à Médéa, et ne pourrait s'occuper des affaires de l'extérieur que par l'intermédiaire de Ben-Aouda qui serait son agha; que les Abid et les Douair reprendraient leurs anciennes fonctions ; que l'on livrerait des filages pour garantie des conventions, et qu'enfin on prierait les Français de venir jusqu'à la ferme de Haouch-Chaouch de Mouzala pour recevoir les filages, et rester sur ce point. pendant que la révolution s'opérerait, afin d'imposer aux dissidents par cette démonstration.
Jamais négociation avec les provinces ne s'était aussi nettement dessinée ; mais il fallait avoir quelque argent à donner à Ben-Omar, qui évidemment ne pouvait s'embarquer dans cette affaire sans avances. Il était bien dit que les Arabes paieraient l'achour ; mais enfin, pour les commencements, il fallait une première mise. quelconque. C'est ce qu'on ne put trouver. Ben-Omar voulut emprunter 50,000 fr., moyennant certaines signatures que notre législation financière ne permit pas de donner, de sorte que cette affaire n'alla pas plus loin. Ensuite, nous étions déjà parvenus au mois de septembre, le comte d'Erlon, nommé gouverneur des possessions françaises du nord de l'Afrique, allait arriver, et il était naturel que te général Voirol, qui devait lui remettre le commandement, lui laissât le soin de donner à cette négociation la suite qui lui paraîtrait convenable. Mais n'anticipons pas sur les événements ; revenons plutôt sur nos pas pour faire connaître au lecteur ce qui se passa à Cherchell dans l'été de 1834.
Le kaïd de cette ville, Mohammed-ben-Aïssa-el-Barkani, avait reçu en 1830 l'investiture de son commandement du général Clauzel. C'était un homme sage, qui se maintenait dans de bonnes relations avec nous, et qui favorisait le commerce entre Cherchell et Alger. Quant à nous, nous ne nous occupions peut-être pas assez de lui, car il y avait quelque chose à faire de ce côté, en rendant les rapports plus fréquents et plus intimes. EI-Barkani, malgré la sagesse et la modération de son gouverneraient, avait des ennemis; ceux-ci attendaient avec impatience quelque germe de mécontentement à exploiter. Ils en trouvèrent un dans l'été de 1834: le kaïd, pressé par les besoins de l'administration, et principalement par des réparations à faire au port, mit un léger droit sur les bâtiments chargés qui en sortaient ; aussitôt grand murmure parmi les raïs (Capitaines marins) et grande joie chez les ennemis du kaïd. On excite le peuple à la révolte, mais le peuple ne bouge pas. Les ennemis de Barkani changent alors de batterie et répandent le bruit qu'il a été destitué, et qu'ainsi on ne doit plus le reconnaître pour kaïd. Ce mensonge trompant peu de monde, les perturbateurs virent qu'ils n'avaient d'autres moyens de réussir que d'obliger leur adversaire, par quelque ruse, à abandonner de lui-même la partie. A cet effet, ils dirent à quelques personnes, mais de manière à ce que la chose fût répétée, que des plaintes avaient été portées au général en chef contre lui. Quand le. bruit s'en fut bien répandu, et que le temps nécessaire pour qu'on fût censé avoir reçu une réponse d'Alger fut écoulé, ils publièrent que le général avait résolu d'envoyer un bâtiment de guerre à Cherchell pour arrêter le kaid. El-Barkani commença alors à être ébranlé. Sur ces entrefaites, le hasard voulut que le bateau à vapeur qui fait le service de la correspondance entre Alger et Oran vint à paraître, en longeant les côtes de plus près qu'à l'ordinaire, et de manière à faire croire qu'il se dirigeait sur Cherchell A cette vue, le kaïd, ne doutant plus de la vérité des assertions de ses ennemis, se hâta de sortir de la ville et se rendit chez les Beni-Menasser, tribu à laquelle il appartenait et dont il était chef.
Les perturbateurs, se trouvant ainsi maîtres de la ville, proclamèrent la déchéance de Mohammed-el-Barkani. Cependant, comme ils craignaient le ressentiment des Beni-Menasser, chez qui les Barkani sont en grande vénération, ils nommèrent pour kaid un autre membre de cette famille. Cet arrangement ne désarma pas la colère des Beni-Menasser, qui vinrent bloquer la ville. Les habitants de Cherchell se défendirent; mais, comme ils avaient peu de poudre, ils en envoyèrent demander au général Voirol, en le priant de reconnaître le nouveau kaïd.
Cet événement fut mal apprécié à Alger; on crut y voir un acte de soumission d'une ville qui n'avait encore eu avec nous aucun rapport de cette nature, tandis qu'au contraire un kaïd investi par nous en avait été expulsé. La poudre fut promise, et peu après délivrée. Le général Doguereau, inspecteur général d'artillerie, se trouvait à cette époque en mission à Alger. Il se mêla de cette affaire, j'ignore à quel titre, et, comme il devait passer quelques jours à Oran, il fut convenu qu'à son retour il s'arrêterait à Cherchell pour l'arranger comme il l'entendrait. Cet officier général, partageant l'illusion qui faisait considérer les événements de Cherchell comme une révolution en notre faveur, prit à Oran deux petites pièces de canon dont il voulait faire cadeau à nos nouveaux alliés. Mais quand le bateau à vapeur fut arrivé au mouillage de Cherchell, et que les nouvelles autorités venues à son bord lui eurent déclaré ne pouvoir répondre de deux officiers qu'il voulait envoyer à terre pour reconnaître la ville, ses idées se modifièrent, et il s'abstint de cet acte de munificence.
Peu de temps après, la paix fut rétablie entre Cherchell et les Beni-Menasser, fatigués de l'interruption du commerce. El-Barkani les engagea lui-même à cesser les hostilités, réservant de faire agir ses partisans dans l'intérieur de la ville et de détromper les Français. Il écrivit en effet au général Voirol une lettre fort sage, où il expliquait sa conduite, qui était à l'abri de tout reproche. Le cadi et le muphti de Cherchell, qui avaient quitté la ville en même temps que lui, vinrent eux-mêmes à Alger pour plaider en sa faveur. Ils dirent qu'un ordre précis du général et une simple démonstration suffiraient pour le rétablissement de son autorité.
Les choses en étaient là lorsque le comte d'Erlon arriva dans la colonie. Sur le compte qui lui en fut rendu, il donna d'abord des ordres pour que El-Barkani fût rétabli à Cherchell par tous les moyens convenables. Mais bientôt on le fit revenir sur cette résolution, et il fut décidé qu'un officier irait sur les lieux reconnaître quel était le vœu réel de la population. On en prévint les habitants de Cherchell, à qui l'on dit en même temps que l'envoi de poudre qu'on leur avait fait ne préjugeait en rien la question principale. Les meneurs de cette ville avaient déjà renvoyé leur nouveau kaid et en avaient nommé un troisième, lorsque l'officier, M. le capitaine Gougeon, chef du service topographique, qui fut chargé d'aller examiner l'état des esprits y arriva. Les choses étaient disposées de manière à ce qu'une majorité compacte parfit formée contre El-Barkani dans la ville. On savait déjà que les campagnes étaient pour lui, mais les citadins s'étant déclarés pour son rival, il succomba. Il fut dans toute cette affaire trop confiant en son bon droit; il ne sut pas faire agir ses partisans, qui, très-nombreux dans le principe, finirent par être réduits à un tiers de la population.
Nous avons rendu un compte fidèle des actes politiques et militaires du général Voirol et de tout ce qui s'est passé sous lui dans la province d'Alger. Dans les deux livres suivants, nous parlerons des événements de Bougie et d'Oran, auxquels il resta à peu près étranger, et des actes de l'administration civile.
A SUIVRE
|
|
| Réunion d'anciens
Envoyé Par Chamaloo
|
Tous les 10 ans, d'anciens copains de classe se retrouvent pour passer une bonne soirée ensemble.
Au moment de fêter leurs 40 ans, ils se retrouvent et se demandent où passer cette soirée.
Au début, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le lieu mais l'un d'eux propose :
"Allons au restaurant 'Le Lion', la serveuse est vraiment jolie et porte toujours un chemisier avec un décolleté bien plongeant."
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Et 10 ans plus tard, pour leurs 50 ans, ils se retrouvent à nouveau et se demandent où passer la soirée cette fois.
Au début, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le lieu mais l'un d'eux propose :
"Allons au restaurant 'Le Lion', on y mange très bien et la carte des vins est excellente."
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Et 10 ans plus tard, quand ils fêtent leurs 60 ans, ils se retrouvent à nouveau et se demandent comme d'habitude où passer la soirée.
Au début, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le lieu mais l'un d'eux propose :
"Allons au restaurant 'Le Lion', c'est calme et non-fumeur."
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Et 10 ans plus tard, pour leurs 70 ans donc, ils se retrouvent et se demandent où passer la soirée.
Au début, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le lieu mais l'un d'eux propose :
"Allons au restaurant 'Le Lion', c'est bien adapté aux fauteuils roulants et il y a un ascenseur."
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Dernièrement, ils fêtaient leurs 80 ans et se demandaient où aller. Au début ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le lieu mais l'un d'eux proposa :
"Allons au restaurant 'Le Lion'."
Et tous de répliquer :
"Bonne idée, nous n'y sommes jamais allés !"
|
|
|
Le Refus des Honneurs
par M. Alain Algudo
|
Monsieur Elie ABOUD député de l’Hérault
Président du Groupe d’Etudes aux Rapatries à l’Assemblée Nationale
Béziers le 21 Janvier 2012
Cher Elie
Permets moi de te faire savoir combien je suis sensible que tu ais pensé à moi pour l'octroi d'une médaille honorifique et pas des moindres, envisageant même déjà toute une organisation avec location de salle, bristol d'invitation etc... pour me la remettre.
Je ne doute pas de ta motivation de reconnaissance pour le travail que j'ai accompli au service de mes compatriotes. Sensible certes, mais comment ne pas être étonné de constater que tu me connaisses aussi mal en pensant que je serais susceptible d'accepter quelque décoration que j'ai toujours refusé, et que je refuserai toujours tant que le but de mon combat, maintenant cinquantenaire, n'aura pas été atteint ! Non Elie, je ne peux en aucun cas accepter, le drame que j'ai vécu avec tous mes compatriotes expatriés n'ayant pas été reconnu au préalable par la plus haute autorité de l'État, comme Le Président Jacques CHIRAC l'avait fait lors de son mandat pour nos compatriotes Juifs.
Nous avons été d'abord trompés, puis abandonnés sciemment aux mains des égorgeurs, puis volés sans aucune compensation matérielle véritable, tout ceci en violation de la Constitution de 1958, de l'article 22 des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 545 du code civil de la République Française.
En outre, la compensation morale qui aurait pu nous être accordée en disant la vérité sur notre petit peuple qui ressemblait tellement à celui de n'importe quel autre département de Métropole, a été complètement occultée. C'est au contraire une propagande éhontée, faisant du moindre petit commerçant de quartier ou employé de bureau d'affreux colonialistes qui a été toujours menée et continue à l'être, l'insulte est permanente, et le nom de notre bourreau Charles DE GAULLE sévit toujours partout en France alors que ses crimes devraient être passibles, même à titre posthume, du tribunal international pour crime contre l'Humanité.
Si certains de nos compatriotes ont accepté ce genre d'avantage et bien d'autres encore, c'est leur problème et je ne suis pas là pour les juger, mais personnellement tant que mes compatriotes n'auront pas obtenu justice et vérité, il sera de toute manière pour moi hors de question d'accepter quoique soit d'honorifique venant d'une V° République, mère Patrie infanticide pour une partie des siens.
Monsieur le Député il faut que vous le sachiez, pour moi les 2 étoiles d'un Général à titre provisoire et parjure, pèsent peu dans la balance avec les 20 étoiles de nos quatre glorieux Généraux du putsch !
Avec DEGUELDRE, BASTIEN-THIRY, DOVECAR, PIEGTS et tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur de la parole donnée, ils resteront ma référence, cet honneur ou l'acceptation d'une médaille venant d'une Assemblée qui glorifie encore la mémoire d'un criminel, serait pour moi le renoncement de ce que justement je ne veux pas perdre : L'HONNEUR !
Alain ALGUDO
Président des Comités de Défense des Français d’Algérie et des Agriculteurs exilés
|
|
| HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ET DU COMMERCE FRANÇAIS
DANS L'AFRIQUE BARBARESQUE
(1560-1793) (N°16)
|
|
(Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc)
PAR Paul MASSON (1903)
Professeur d'Histoire et de Géographie économique
à l'université D'Aix-Marseille.
TROISIÈME PARTIE
CHAPITRE XVIII
LE COMMERCE DE LA COMPAGNIE ROYALE D'AFRIQUE
II. - La pêche du corail.
Le nom des Concessions et des compagnies d'Afrique évoque immédiatement le souvenir de la pêche du corail. On n'a jamais oublié que le Bastion de France avait été fondé spécialement pour pratiquer cette pêche, et la tradition courante est que le corail était toujours resté la principale, sinon la seule raison d'être, des établissements français. De nombreux documents semblent au premier abord confirmer cette impression et pourraient faire croire que, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la pêche resta la principale occupation des Compagnies et leur fournit leur principal revenu.
Dans les délibérations de la Compagnie royale ou dans sa correspondance, on trouve souvent répétée cette affirmation que la pêche du corail était la partie la plus importante de son trafic. L'abbé Poiret écrivait en l785 :
" Cette pêche fut longtemps la base et le fondement de son commerce. C'était une récolte dont le produit calculé était réputé invariable, qui seul procurait et la rentrée des dépenses que nécessite un grand établissement et les bénéfices qu'il doit donner : mais alors la pêche était constamment abondante et belle, les frais d'exploitation étaient beaucoup moindres, les débouchés autant et peut-être plus avantageux, et, quelque révolution qu'éprouvassent les autres branches du commerce de la Compagnie, la pêche du corail suffisait pour la maintenir, sinon dans un état florissant, au moins dans cet état d'équilibre et de solidité dont une compagnie de commerce ne doit jamais sorti. "
Mémoire instructif pour M. Garavaque, gouverneur de La Calle, 16 sept. 1778: " La Compagnie a toujours regardé la pêche comme la base de son établissement et la branche la plus solide de ses bénéfices et elle a fort à cœur son accroissement. " Arch. des Bouches-du-Rhône, C. 2464. - Lettre du directeur principal Bertrand, à l'intendant de La Tour : " Si la pêche du corail vient à manquer à la Compagnie, elle perd la base de son établissement. Les autres objets sont trop incertains et trop variables pour assurer son existence et sa prospérité. " Ibid, 2472. - Il Importe de remarquer que la pêche n'était pas en décadence au XVIIIe siècle, ni la production moindre. Il suffit de comparer les chiffres donnés ci-dessous à ceux des chapitres précédents.
Telle était donc l'opinion bien établie à la veille de la Révolution, puisque l'abbé Poiret ne faisait que reproduire les renseignements qu'il avait recueillis auprès des officiers de la Calle.
Et cependant cette importance attribuée à la pêche du corail était, en partie, illusoire. Quelque insuffisantes que soient les statistiques qui nous sont parvenues, antérieurement à la Compagnie royale, il semble bien, qu'à aucun moment du XVIIe ou du XVIIIe siècle, le corail ne joua un rôle aussi prépondérant qu'on le croit dans le trafic des Concessions d'Afrique. Peut-être, même, ne donna-t-il pas souvent de bien sérieux bénéfices. Il est, en tout cas, certain, pour ce qui regarde la Compagnie royale, que jamais, depuis 1741, la valeur des ventes de corail n'atteignit celle des grains, des cuirs et des laines.
D'un autre côté, le corail, alors d'un prix très élevé, tenait fort peu de place dans les chargements des navires et n'alimentait guère le mouvement de la navigation. Quant aux bénéfices procurés par la vente du corail, ils étaient, en effet, parfois relativement fort élevés, mais bien loin d'être assurés et invariables comme l'affirmait l'abbé Poiret. L'auteur du mémoire inséré dans l'Encyclopédie méthodique, disait plus justement : " Le privilège de la pêche du corail est quelquefois un objet fort utile, niais casuel et précaire. " C'est pourquoi, en 1773, au moment de la plus grande prospérité de la pêche, les directeurs de la Compagnie faisaient un traité à long terme pour la vente des coraux " afin, disaient-ils, de s'assurer un profit certain sur un article de mode et sujet à des révolutions. " Quand on parlait sous Louis XV de l'importance capitale de la pêche, c'était peut-être en souvenir d'un passé à demi-légendaire, auquel le présent ne répondait certainement pas, et qu'on aurait voulu faire revivre. Peut-être encore lui attribuait-on cette importance spéciale, parce que c'était le privilège des compagnies dont elles étaient le mieux en possession et qu'elles pouvaient exploiter le plus sûrement, sans avoir à craindre les caprices des Puissances Barbaresques.
Quoi qu'il en soit, la pêche du corail à cause de son ancienneté, du rôle qu'elle jouait ou qu'on lui attribuait, de son organisation curieuse, mérite d'être étudiée à part parmi les opérations des compagnies d'Afrique. La Compagnie royale se préoccupa toujours de la développer, soit en améliorant son organisation, soit en faisant des recherches de corail dans des mers nouvelles. C'est surtout en vue d'en accroître le rendement qu'elle songea à s'emparer de Tabarque en 1741. En 1751, elle envoyait un bâtiment chargé de deux bateaux corailleurs faire des essais dans le golfe de Stora, puis dans celui d'Arseny (Arzeu ?), entre Alger et Oran. A partir de 1768, elle ne négligea rien pour tirer le meilleur parti du privilège exclusif qu'elle avait obtenu du bey de Tunis, et elle multiplia les essais à la Galite, à Bizerte, sur les côtes orientales de la Régence.
Malgré ces multiples recherches, les parages de la Calle continuèrent d'être, jusqu'à la Révolution, le principal et presque le seul centre de production pour la Compagnie. Jusqu'en 1750, la pêche languit et ne donna pas de bénéfices ; pendant ces dix premières années, la vente moyenne n'avait été que de 8.527 livres et les prix avaient été peu élevés, puisque, en 1745, les 7200 livres vendues n'avaient produit qu'une somme de 72.000 livres ; sans le fret et les assurances pour le transport à Marseille, les frais de la pêche avaient dépassé cette somme. Cette année-là, la Compagnie n'avait pas eu plus de 19 bateaux occupés à la fois à la pêche.
État des traites... Archives de la Compagnie. - Il est bien difficile d'évaluer la production annuelle. Les statistiques de la Chambre de Commerce ne donnent malheureusement pas les prix-courants du corail vendu à Marseille. Or, les prix variaient beaucoup, suivant les assortiments. On distinguait le corail premier, le corail second, les branchettes et les menus : en 1785, tandis que le corail premier fut payé 30 livres aux pécheurs, Ils ne reçurent que 5 livres pour les menus.... Il y avait aussi des Fondettes, mais la Compagnie ne les recevait pas dans ses assortiments. (De Castries à de La Tour, 24 septembre 1786. Archives des Bouches-du-Rhône. C, 2472). " Ces Fondettes ne sont que des germes dont un enlèvement trop hâtif détruit la reproduction. " (abbé Raynal. Hist. philos.). En 1745, la Compagnie paya en moyenne son corail 3 livres 10 sols la livre, prix exceptionnellement bas, puisqu'en 1751, elle donna aux pécheurs 15 livres, 12 livres en 1768, 23 en 1785 et 24 en 1787. Elle le revendait beaucoup plus cher. En 1745, le corail acheté 3 livres 10 sols fut revendu 10 livres, mais, à ce moment-là, le système de la Compagnie consistait à payer très peu les corailleurs. D'après Desfontaines, la Compagnie vendait le corail de 48 à 96 livres (1785).
En 1760, M. de Verrayon, l'un des directeurs, écrivait au retour d'une tournée d'inspection : " La pêche du corail est sans contredit la branche la plus onéreuse du commerce de la Calle... ce qu'il y a de pis, c'est que je ne pense pas que l'on y puisse mettre jamais un autre ordre, ni remédier à tous les troubles qu'elle entraîne. " Il proposait, cependant, lui-même, des améliorations et, peu à peu, dans la période qui suivit, les quantités de corail pêché augmentèrent, les assortiments devinrent plus beaux et les prix plus élevés ; la pêche finit par donner chaque année de beaux bénéfices. De 1752 à 1760, le produit moyen fut d'environ 11.000 livres; dans les cinq années qui suivirent, il s'éleva à plus de 15.700, et dépassa ensuite 20.000 jusque vers 1780. Produit de la pêche en livres de Marseille : moyenne des années 1752-65 = 12.600 livres, État des traites. Pour les dernières années, les statistiques ne nous donnent plus le poids exact du corail pêché, mais on sait qu'avant 1780 " le produit était de 180 caisses de coraux bien assortis " qui devaient peser environ 25.000 livres. La pêche donnait alors " ordinairement 150.000 livres de profit. " Lettre du 16 juillet 1786. Les caisses étaient de 100 ou de 150 livres. - Cf. Raynal : Les recettes de la Compagnie, antérieurement à 1777, s'élevaient à 36.000 kilos. Ce chiffre est absolument fantaisiste.
Peu à peu, la Compagnie avait pu employer un nombre de plus en plus grand de bateaux. En parcourant les registres de délibérations on voit que, dans la campagne de 1753, il n'y avait eu que 14 bateaux en service et les directeurs se demandaient " s'ils pouvaient être augmentés jusqu'à 20 " ; en 1759, 23 bateaux furent équipés, puis on trouve 32 bateaux en 1777. L'année suivante, les directeurs approuvaient les vues du directeur principal, qui avait l'intention d'en porter le nombre à 50, mais ce chiffre ne fut jamais atteint ; en 1780, il n'y avait que 38 bateaux à la Calle.
Cette prospérité ne dura pas, car, dans les années qui précédèrent la Révolution, la pêche redevint onéreuse pour la Compagnie. On lit dans une lettre de 1786: " La pêche du corail est à la veille d'être entièrement perdue… Le produit est réduit aujourd'hui à 60 ou 50 caisses de la plus basse qualité. La Compagnie est dans le montent dans le plus grand embarras, pour payer à Alger le tribut de deux caisses de gros corail qu'elle lui doit. " Les statistiques de la Compagnie confirment ce renseignement, puisque la moyenne de la vente pour les années 1783-89 fut de 65 caisses. La Compagnie employait encore cependant une trentaine de bateaux.
Pour expliquer la décadence de la pêche, dans les périodes où elle déclinait, on parlait déjà, au XVIIIe siècle, du dépeuplement des fonds et de la nécessité d'en rechercher d'autres. C'est parce que la Compagnie en était convaincue, vers 1750, qu'elle fit faire une série d'essais, sur les côtes algériennes ou tunisiennes. Cependant, c'est dans les parages de la Calle que la pêche redevint ensuite prospère. Desfontaines écrivait, en 1785 : " Huit bateaux ne prennent plus, dans une année, autant de corail qu'un seul bateau en prenait jadis dans le même espace de temps. Ces mers sont maintenant épuisées et le corail ne se renouvelle que très lentement. " Mais les pêcheurs invoquaient l'épuisement des fonds pour dissimuler leurs contrebandes. Leur épuisement n'était pas la vraie cause de son nouveau déclin, vers 1789, puisque jamais leur exploitation ne fut aussi active ni aussi fructueuse qu'au XIXe siècle : de 1821 à 1882 l'exportation du corail algérien diminua de moitié et pourtant elle était encore, il y a vingt ans, de 20.000 kilos., chiffre bien supérieur à ce que recevait autrefois la Compagnie. Il est vrai que les ventes de la Compagnie ne représentaient pas tout le produit de la pêche ; il faudrait tenir compte du corail vendu en contrebande par les corailleurs.
Le succès de la pêche dépendait alors surtout de l'habileté des corailleurs et de la bonne organisation donnée à l'exploitation. Chose curieuse, dans un pays de marins comme la Provence, où le corail était pêché sur les côtes de Cassis, la Ciotat, Six-Fours, Saint-Tropez, Antibes, les compagnies, au lieu d'employer des pêcheurs d'élite, ne purent même pas avoir à leur service des marins de profession.
C'étaient des paysans de l'intérieur, qui n'étaient jamais allés sur mer, qui s'engageaient à leur service et la Compagnie royale eut souvent affaire aux patrons corailleurs d'Aubagne.
Elle se rendait bien compte de l'infériorité et de l'insuffisance de pareils équipages. On lit, dans une délibération du 29 décembre 1750 : " La pêche du corail ne donne peu de profit que parce que les bateaux ne sont équipés que par des gens qui n'ont jamais été à la mer. " Quelques mois après les directeurs s'en plaignaient au ministre en ces termes :
" La Compagnie aurait tort d'attribuer à la disette de corail le peu de profit qu'elle retire de la pêche ; l'expérience de dix ans nous a appris qu'on ne doit l'attribuer qu'à l'ignorance des pêcheurs et à la nature des bateaux qu'elle emploie. Les bateaux sont équipés de sept hommes, ils sont lourds et beaucoup plus grands qu'il n'est nécessaire. Inutilement on entreprendrait de faire embarquer nos pêcheurs sur des bateaux plus petits ; étant peu faits au métier de la mer, plus le bateau est grand et moins ils se croient en danger de périr. Cela ne doit pas étonner de la part de nos pêcheurs qui sont ou vignerons ou laboureurs ; mais... attendu que l'équipage de ces bateaux est de sept hommes et que celui des petits n'est que de trois, la Compagnie retire peu de profit de leur pêche. De plus, au moindre mauvais temps, les patrons échouent leurs bateaux de peur de se noyer...
La Compagnie s'est arrêtée au projet de faire la pêche comme font les Catalans, qui est la meilleure façon, c'est-à-dire avec des bateaux et des engins semblables aux leurs ; mais, comme elle a besoin pour cet effet de former des pêcheurs, elle a délibéré de vous supplier, Monseigneur, de lui obtenir du roi le privilège exclusif de la pêche du corail dans les mers de Provence, où les Français ne la font pas et où aucune autre nation, si ce n'est la Catalane, ne la fait. "
Ainsi les Provençaux ne pratiquaient même pas la pêche sur leur côte. Outre l'absence de traditions, le peu de profit que la Compagnie laissait à ses corailleurs, la vie rude des pêcheurs, les dangers d'une mer souvent agitée et d'une côte sans abri, la terreur inspirée par les corsaires de Salé, suffisent à expliquer pourquoi les marins ne mettaient aucun empressement à s'engager au service des compagnies. Mais il semble aussi que les règlements des classes mettaient obstacle au recrutement des pécheurs puisque, dans son mémoire de 1750, M. de Verrayon écrivait qu'il ne voyait pas de remède à la triste situation de la pêche " si le roi n'accordait à la Compagnie les gens de mer dont elle avait besoin. "
Pour former des pêcheurs, la Compagnie songea à diverses reprises à employer les corailleurs étrangers les plus expérimentés. Les Génois établis à Tabarque avaient quelque réputation. Lors de la prise de cette île par le bey de Tunis, deux cents d'entre eux se réfugièrent à la Calle et demandèrent au gouverneur à être employés, mais le dey d'Alger envoya plusieurs bâtiments pour les prendre et c'est alors qu'eut lieu le sac de la Calle, en 1744 ; la Compagnie fut donc obligée de renoncer aux Tabarquins. On a vu plus haut qu'en 1750 elle songeait à employer les Catalans; ce projet ne fut pas non plus suivi d'exécution. Elle fut obligée, par les circonstances, en 1768, de rompre le traité qu'elle avait conclu avec trente patrons italiens, pour organiser la pêche à Bizerte. Enfin, l'annexion de la Corse au royaume donna l'idée d'engager des Corses qui, avec les Catalans, passaient pour les plus habiles corailleurs de l'Europe. C'était le moment où le bey de Tunis venait enfin d'accorder à la Compagnie le privilège de la pêche sur ses côtes ; c'est avec douze bateaux corses qu'elle fit d'heureux essais autour de l'île de la Galite, en 1771. L'année suivante, vingt-quatre bateaux d'Ajaccio étaient au service de la Compagnie. Dès lors, des Corses furent engagés régulièrement pour les Concessions, concurremment avec des Provençaux.
Pour négocier avec eux, la Compagnie eut recours au commissaire de la marine à Ajaccio qui, bientôt, fut nommé officiellement par elle, en 1773, son agent en Corse. Chargé de présider à tous les détails de l'expédition des pécheurs, à leur rapatriement, au remplacement des malades et des morts, il ne signait pas sur place les contrats à l'exécution desquels il était chargé de veiller. Périodiquement, on vit venir à Marseille des députés corses munis des pouvoirs des corailleurs, et les contrats avec eux ne furent signés souvent qu'après des négociations délicates. L'abbé Moresco et le patron Jean Reno turent les premiers députés envoyés en 1771. Délibérations du 26 février, 9 mars, 19 mars. - En 1772, il y eut en concurrence deux députés, l'abbé Moresco, muni de la procuration de 30 pêcheurs et le sieur Carbonne avec la procuration de 24 autres. Délibération du 10 avril 1772.
La Compagnie eut à se louer de l'activité nouvelle donnée à la pêche par les Corses. Le directeur principal l'écrivait au gouverneur de la Calle, en 1777 : " Ils sont utiles à la Compagnie puisqu'ils aiguisent l'émulation des Provençaux et qu'ils nous ont procuré des gondoles à leur manière. Ainsi, dans les nouvelles constructions vous vous ne ferez construire que des gondoles jusqu'à ce que, les anciens bateaux étant hors de service, nous puissions en donner à tous nos patrons. Les patrons provençaux veulent des bateaux corses, il convient de n'avoir plus que de ceux-là.. " En 1787, la Compagnie faisait acheter deux bateaux trépanais pour en faire adopter le modèle à ses corailleurs provençaux, parce que les Trapanais passaient pour des pêcheurs émérites.
Ainsi, la Compagnie s'était sans cesse efforcée de rendre ses pêcheurs plus habiles et mieux équipés, mais on est étonné de voir qu'elle se soit moins préoccupée de retarder dans les parages de la Calle, l'épuisement des fonds corallifères, qu'elle déplorait et qui la décida à rechercher de nouvelles pêcheries dans les mers de Tunis.
Cet épuisement était, en effet, rendu beaucoup plus rapide par les procédés défectueux employés pour la pêche. Personne ne semble s'en être avisé alors; du moins aucun document ne montre que quelqu'un ait songé à empêcher la dévastation des fonds et à enseigner ou à imposer aux pêcheurs des méthodes plus rationnelles que celles qu'ils employaient. Dans les contrats entre les pêcheurs et la Compagnie qui nous sont parvenus, aucune clause ne parle des engins et des procédés à employer. Les patrons continuaient donc de pratiquer la pêche suivant la mode traditionnelle, qui semblait n'avoir pas changé depuis le moyen-âge, puisqu au XIe siècle on tramait déjà sur les fonds ces filets attachés à une croix de bois, qu'on employait à la fin du XVIIIe siècle. Le naturaliste Desfontaines, qui visita la Calle en 1785, décrit ainsi ce procédé séculaire.
" La machine dont se servent les pécheurs, pour saisir et amener le corail, se nomme engin; en voici la description : au bout d'un fort câble de soixante brasses de longueur, entouré de cordes dans sa partie inférieure, pour qu'il ne se coupe pas sur les rochers, sont attachés en croix deux bâtons de la grosseur du bras et longs de trois pieds environ. Une pierre, pesant environ cinquante ou soixante livres, est fixée au centre de la croix et sert à faire descendre la machine au fond de la mer. A chaque bout des deux bras de la croix sont deux filets dont les cordes, peu tendues et grosses comme une plume à écrire, forment des mailles larges d'environ douze doigts : ces huit filets, traînant au fond de la mer, accrochent le corail et, lorsque les bateliers sentent qu'ils ont saisi leur proie, ils ramènent en haut les filets, au moyen du câble, après avoir enlacé le corail en faisant faire au bateau plusieurs tours circulaires. Outre les filets attachés à la croix, il y en a encore quatre autres fixés deux à deux au bout de deux cordes longues d'une brasse, qui partent du centre de l'engin ; ceux-ci peuvent ressaisir le corail qui est échappé aux autres ; ainsi chaque engin porte douze filets.
Chaque bateau provençal employé à la pêche du corail est monté par sept hommes : un patron, un pilote, et cinq matelots. Il y a huit hommes sur les bateaux corses; le patron se tient ordinairement au timon ; sa fonction est de jeter et de retirer l'engin. Il arrive souvent, lorsqu'il faut retirer une grosse pièce de corail, que les efforts des sept hommes réunis sont nécessaires pour ramener en haut les fuels. Les patrons provençaux pêchent toujours à la voile lorsqu'ils ont les vents et les courants favorables; les Corses et les Siciliens pêchent à la rame… Les bateaux pêcheurs s'éloignent de la côte à la distance de trois, quatre et même cinq lieues. "
Cependant, quelque temps après que Desfontaines écrivait sa relation, l'Académie de Marseille proposait, en 1786, une récompense a l'inventeur de la meilleure machine applicable à la pêche du corail et M. Remuzat, directeur de la fabrique marseillaise où le corail était travaillé, ajoutait 600 livres au prix. D'après l'historien de l'Académie, des naturalistes et des mécaniciens proposèrent des moyens ingénieux pour enlever le corail. Mais le prix fut gagné par le P. Béraud, de l'Oratoire, qui reçut les félicitations du conseil de ville, de la Chambre de Commerce, du ministre de la marine ; les chefs d'atelier de la manufacture royale lui firent agréer son buste en corail.
Le bruit fait autour de l'invention du P. Béraud semble prouver qu'on attachait une grande importance à la question. Cependant, il est surprenant que la Compagnie d'Afrique, intéressée le plus directement à la solution, semble ne s'être associée ni à la préparation de ce concours, ni à la satisfaction causée par ses résultats. Le nouvel appareil n'était-il pas réellement pratique, ou bien la vieille routine fut-elle plus forte ? Pour l'une ou l'autre de ces raisons, l'usage de l'ancien engin devait se perpétuer jusqu'à la lin du XIXe siècle, bien que Lautard alarme que l'instrument du P. Béraud, adopté en 1786, servait encore de son temps, c'est-à-dire vers 1820, aux pêcheurs corailleurs.
Le succès et les bénéfices de la pêche, pour les compagnies d'Afrique, dépendaient plus encore, peut-être, de l'organisation plus ou moins bonne qu'elles savaient lui donner que de l'habileté des pêcheurs, de la construction ou du gréement de leurs bateaux, et de l'excellence des procédés de pêche employés. La Compagnie ne cessa jusqu'à la fin de la remanier dans le détail et, malgré toute son application, ne put jamais résoudre complètement les difficultés, ni éviter les mécomptes.
La Compagnie signait avec les patrons corailleurs des contrats (Accord du 9 juin 1768), dressés par-devant notaire, généralement pour la durée de trois ans. Elle devait remettre à chaque patron un bateau bien gréé, que celui-ci s'engageait à bien entretenir et à rendre dans le même état qu'il l'aurait reçu. La construction et le radoub des bateaux à la Calle, où il était difficile de se procurer des bois, fut toujours une des graves préoccupations de la Compagnie ; elle se demanda, à diverses reprises, s'il ne serait pas plus économique de les construire à Marseille. En 1754, elle attribuait la fréquence des avaries et la dépense exagérée des radoubs à ce que les bois des environs de la Calle étaient trop cassants et elle décidait d'envoyer dorénavant des bois de France.
Les bateaux souffraient, surtout l'hiver, des tempêtes ou des fortes houles fréquentes en ces parages ; les avaries et même les naufrages de corailleurs étaient fréquents en cette saison. Aussi fut-il question de faire pêcher les barques de la Compagnie, l'été seulement, et une décision fut prise en ce sens, en 1751. C'était d'ailleurs l'usage ordinaire, dans la Méditerranée, de pêcher seulement depuis le commencement d'avril jusqu'à la fin de juillet. Le 30 mars 1754, Raynal écrit. " La durée de la pêche du corail sur les côtes d'Afrique est de six mois, c'est-à-dire depuis la fin de mars jusqu'à la fin de septembre. " Mais, sans doute, parce qu'il était difficile de tenir les pêcheurs inoccupés à la Calle pendant plusieurs mois, sans de graves inconvénients, l'usage contraire prévalut pour la Compagnie, qui continua de pratiquer la pêche toute l'année.
La Compagnie fournissait, au prix coûtant, aux patrons corailleurs, les filets et agrès de toutes sortes nécessaires pour la pêche, les victuailles pour leur nourriture ; les contrats limitaient la quantité de vin à consommer par barque : " huit barils de trente pots en hiver, neuf barils en été. " Toutes les hardes et linges nécessaires à l'entretien des pêcheurs devaient être achetés à la Compagnie, ainsi que le tabac, à des prix déterminés. Pour être reçus à l'hôpital de la Calle pendant leurs maladies et recevoir gratuitement les aliments ou médicaments nécessaires, les corailleurs donnaient 20 ou 30 livres, par an et par barque, à la Compagnie. Quand les corailleurs séjournaient à la Calle, ils y étaient traités comme les soldats et les frégataires et recevaient la ration journalière de deux livres de pain, d'une livre de viande et d'un pot de vin.
Afin de sauvegarder les droits des corailleurs et de la Compagnie, les plus grandes précautions étaient prises pour que tout le corail pêché fût remis au patron de chaque barque et entrât dans les magasins de la Calle.
" A l'avenir, disait le règlement de 1745, les patrons corailleurs ne garderont plus chez eux, pendant tout un quartier, le corail de leur pêche. Chaque patron aura une caisse formant à clef qu'il gardera. Cette caisse sera dans le magasin du corail. Chaque patron revenant de la pêche serrera son corail dans sa caisse qu'il connaîtra par le numéro imprimé dessus ; il fera sécher son corail, le nettoiera et le purgera de sa rocaille dans le magasin où sera le corail, ou dans tel autre endroit que le directeur indiquera. "
L'expérience prouva qu'il fallait des précautions plus strictes, telles que celles établies par l'article 9 du contrat de 1788 :
" Il y aura dans chaque bateau une caisse dans laquelle le corail sera déposé au sortir de l'eau ; le patron en aura seul la clef. Toutes les fois que les bateaux reviendront… cette caisse sera transportée fermée pour être vidée dans le magasin… avec les précautions nécessaires pour que le corail de chaque bateau soit distingué. Lorsque les patrons et compagnons travailleront à faire sécher ou nettoyer le corail, ils seront enfermés dans le magasin ou autre endroit destiné pour cette opération et seront fouillés en sortant, après que les patrons auront déposé leur corail dans ce magasin. Celui qui sera trouvé ailleurs sera confisqué. "
En outre, la compagnie redoublait de surveillance quand, par hasard, d'autres bâtiments que les siens relâchaient à la Calle.
" S'il vient à la Calle, lit-on dans le règlement de 1745, quelque sandal de Tunis, Bizerte ou autre endroit, il sera mis un soldat de confiance en sentinelle auprès pour empêcher que les patrons, sous prétexte d'acheter des fruits du sandal, ne leur vendent du corail ou qu'ils ne traitent avec eux du prix et conviennent avec eux de l'endroit, le long de la plage, où les patrons devront cacher leur corail qu'ils leur auront vendu. - Il sera fait à l'avenir, disait l'article suivant, plus d'attention qu'on n'en a fait par le passé à empêcher qu'il ne soit volé du corail; pour cet effet, on se ménagera quelque espion à Bizerte et l'agent de Bône veillera à ce que les bateaux corailleurs ne séjournent pas longtemps. "
Quatre fois par an, seulement, la Compagnie recevait le produit de la pêche, aux quatre rendues, fixées par une longue tradition à Pâques, à la Madeleine, à la Saint-Michel et à Noël, c'est-à-dire en avril, en juillet, en septembre et en décembre. Les .rendues correspondaient donc à peu près aux quatre saisons et permettaient aux pêcheurs de séjourner à la Calle, à l'époque de quatre fêtes particulièrement chères aux Provençaux. Quand la Compagnie fit des essais de pêche en Tunisie, des rendues furent exceptionnellement établies tous les deux mois parce que, loin de la Calle, les pêcheurs avaient besoin d'être plus étroitement surveillés pour éviter les contrebandes.
Aux rendues, la Compagnie achetait le corail à des prix soigneusement déterminés par les contrats. Ceux-ci distinguaient le corail de première et de seconde qualité, les branchettes, les menus et les fondettes. Il y avait en dépôt à la Calle des échantillons de chacune de ces catégories, qui servaient d'étalons de comparaison, et dont le double restait à Marseille aux archives de la Compagnie. Les qualités devaient être déterminées par deux " patrons de plage ", choisis parmi les meilleurs, et par deux officiers de la Compagnie. En cas de contestation, les patrons corailleurs devaient s'en remettre provisoirement à la décision du gouverneur de la Calle, en attendant celle de la Compagnie. Pour exciter l'émulation des patrons, le gouverneur de la Calle devait faire délivrer à chaque rendue trente pots de vin au patron qui avait pêché la plus belle branche, puis vingt pots et dix pots pour celles qui seraient jugées les plus belles ensuite.
Au début, celle-ci payait le corail à des prix très bas; en revanche, elle vendait les fournitures et les vivres aux corailleurs au-dessous de leur valeur réelle. Ce système était coûteux pour la Compagnie, il n'encourageait pas les pêcheurs et les poussait à la contrebande. " La Compagnie préférerait abandonner la pêche du corail plutôt que de la laisser montée sur le pied qu'elle est actuellement ", lit-on dans la délibération du 24 août 1751.
Elle se décida à donner aux pêcheurs, pour leur corail, des prix de plus en plus élevés. Dès 1751, elle paya les branchettes, les première et deuxième qualités, de 14 à 16 liv. la livre. Dans le contrat de 1785, " pour rétablir la pêche en obviant à la contrebande, les prix furent fixés à 30 livres la livre pour le corail premier, à 25 livres pour le second, à 15 pour les branchettes, à 5 pour les menus, à 1 pour les fondettes. Deux ans après, les branchettes étaient fixées à 18 livres, les menus à 6, les Fondettes à 30 sols.
Le produit de la pêche, estimé à chaque rendue, était enfin divisé en un certain nombre de parts dont la répartition varia peu pendant la durée de la Compagnie. En 1785, on faisait douze parts et demie dont quatre pour le patron, deux pour le proyer ou pilote, une pour chaque matelot et une et demie pour la Compagnie, pour l'indemniser des frais d'armement des bateaux. Dureau de la Malle. Desfontaines, p. 229. - Jusqu'en 1754, la Compagnie m'avait pris qu'une part ; elle décida, dans la délibération du 14 mai 1754, de prendre une part et demie parce que les pêcheurs faisaient des profits trop considérables depuis que la Compagnie leur payait le corail plus cher. Dans le contrat fait pour Bizerte en 1768, la Compagnie se réservait même deux parts sur douze (3 1/2 au patron, 1 3/4 au proyer, 4 3/4 aux cinq compagnons). - Féraud, p. 627-78, donne un calcul des bénéfices de la pêche pour la Compagnie, mais les chiffres dont il se sert n'ont pas grande valeur.
Il s'en fallait de beaucoup que tout le produit de chaque campagne fit remis à la Compagnie aux rendues trimestrielles. Les patrons avaient trop de profit à vendre, pour leur compte, le corail que la Compagnie leur achetait bien au-dessous de sa valeur. Malgré les précautions stipulées dans les contrats, malgré la sévérité de la surveillance, malgré la difficulté de faire passer clandestinement en Italie le corail dissimulé, malgré la prison qui attendait les délinquants surpris, les contrebandes étaient fréquentes, considérables et faisaient beaucoup de tort à la Compagnie. Ce sont elles qui firent baisser dans d'énormes proportions la quantité de corail reçue par la Compagnie dans les dernières années de l'ancien régime. Un mémoire adressé au ministre, en 1785, l'affirmait. Elles avaient pris des proportions toutes nouvelles depuis que la Compagnie avait des Corses à son service, et la correspondance de ses agents était remplie de plaintes à leur égard.
Bientôt, c'est à eux qu'on attribua, un peu injustement, tout le mal. " La direction s'est aperçue, écrivait-on, en 1786, que ces vols n'ont lieu que depuis qu'elle a admis à son service des pécheurs corses… qui ont induit par leur mauvais exemples les autres pêcheurs à les imiter. "
Le gouverneur de la Calle se reconnaissait impuissant à enrayer le mal : " L'infidélité des patrons corses, écrivait-il, nous est connue depuis bien du temps, mais c'est un mal presque sans remède. "
L'ingéniosité des Corses les faisait recourir aux moyens les plus extraordinaires pour dissimuler le produit de leur pêche. C'est ainsi que la Compagnie apprit, en 1785 ou 1786, de son agent en Corse, sans doute à la suite d'une dénonciation, que trois caisses de corail avaient été déposées par des patrons corses au cap Tavolaro, en un coin écarté de la Sardaigne. Instructions pour le capitaine Lieutaud, commandant Le Senault le Postillon d'Afrique : " Il dirigera sa route vers le cap Tavolaro situé entre Caillery et saint-Pierre ; Il y choisira le meilleur mouillage et, descendu à terre, se rendra au bout d'une petite plage sous une éminence inaccessible; il y cherchera trois caisses de corail qui y ont été déposées par six patrons corses. " - Le Postillon d'Afrique, bateau de la Compagnie, qui lui servait de courrier, était chargé aussi de la surveillance des pêcheurs. V. Instructions pour le capitaine Carnavant, commandant le Postillon d'Afrique, 21 avril 1787. Reg. des Instructions, commencé en 1783. Arch, de la Compagnie.
Les emprisonnements prononcés à diverses reprises par l'intendant, de La Tour, et par le ministre, contre des patrons corses reconnus coupables, ne suffirent pas à décourager la contrebande. Au sujet de la contrebande du corail une série de lettres de 1785-1787. Archives des Bouches-du-Rhône. C, 2471-73. - C'était le temps où les pêcheurs napolitains envahissaient les pêcheries de la Compagnie et favorisaient en même temps la contrebande. Un nouveau contrat conclu avec les Corses, en 1787, qui imposait à chaque patron engagé par la Compagnie la consignation de 1000 livres, eut un peu plus d'effet.
Les Corses donnaient d'autres sujets d'inquiétude à cause de leur caractère. Indisciplinés, querelleurs, ils vivaient en fort mauvaise intelligence avec les patrons provençaux et le gouverneur de la Calle avait fort à faire pour empêcher ou étouffer leurs disputes.
Tous ces inconvénients faisaient que la Compagnie songeait parfois à renoncer à les employer.
" Ce n'est pas d'aujourd'hui, écrivait, en 1777, le directeur au gouverneur de la Calle, que nous sentons la justesse des réflexions que vous faites sur les Corses. C'est pour éviter les inconvénients de leur caractère que la Compagnie s'est déterminée depuis quelque temps de n'en employer qu'un petit nombre, mais, dans ce moment-ci, il serait difficile de les renvoyer sans susciter à la Compagnie une querelle avec la nation Corse. Depuis qu'ils sont sous la domination française, on veut les faire jouir des mêmes privilèges que les Français.. "
Mais les Provençaux n'étaient pas, non plus, toujours dociles et les gouverneurs se plaignaient souvent de leur mauvaise conduite, difficile à réprimer, parce qu'on hésitait à sévir contre eux de peur de désorganiser la pêche. A la suite du renvoi de quelques-uns d'entre eux en France, le directeur principal écrivait à la Calle :
" De tout temps, cette classe de gens a donné beaucoup de peine par la difficulté qu'il y a de les contenir. Il convient cependant d'user de quelque ménagement et d'avoir toujours quelque condescendance ; il serait fâcheux de les voir tous déserter par mécontentement, fondé ou non, et que la pêche vint à languir et à diminuer. "
D'un autre côté, quand les corailleurs séjournaient à la Calle, le gouverneur avait besoin de les ménager pour éviter une mutinerie due leur nombre eût rendue facile. En 1780, sur 409 noms que renferme l'État du total des gens de la place de la Calle, il y avait 185 patrons, proyers ou corailleurs ; en outre, 80 pêcheurs corses figuraient sur une liste à part. Il eût été dangereux pour la petite colonie, qui disposait alors de 46 soldats et de 45 frégataires maures, de trop mécontenter ces hommes turbulents et déterminés. Ainsi la pêche du corail, qui donna parfois des déboires à la Compagnie, lui causa toujours de graves soucis pour son organisation.
Le corail de Barbarie était l'un des plus recherchés au XVIIIe siècle. D'après l'état général des marchandises du Marseillais Carfueil, inséré par Savary de Bruslons dans son Dictionnaire du commerce, les coraux de Barbarie, à la fin du XVIIe siècle, étaient cotés plus bas que ceux de Catalogne et de Provence.
Mais, en 1763, la Compagnie royale répondait à une lettre de Peyssonnel, qui l'invitait à essayer la pêche à la Canée pour y faire concurrence aux Ragusais : " La pêche que font les Ragusais ne porte aucun préjudice à la Compagnie... Elle ne craint aucun concurrent sur cet article parce que son corail, étant le plus beau en couleur, quoiqu'il ne soit pas le plus gros, est préféré à tous les coraux qu'on pêche dans les autres côtes maritimes. " Compagnie d'Afrique, 1760-67. - Bernard, gouverneur de la Calle, à de La Tour, 27 août 1777, sur une proposition du consul de Rhodes, en vue de la pêche dans les eaux de cette île ; il doute que ce corail soit de belle qualité " car les juifs de Venise, de Livourne et de Gênes auraient bien pensé à sen emparer ".
On n'estimait alors, au dire de Desfontaines, que " le corail uni, bien rouge, non carié " ; celui qui était " blanc, noir ou d'un rouge pâle ", avait peu de valeur.
Tout le corail des Concessions apporté à Marseille y était travaillé, au XVIIe siècle, dans des fabriques qui étaient une des curiosités de la ville et attiraient la visite des étrangers.
Le Hollandais Spont écrivait, en 1678 : " Il me semble que les étrangers ne devraient pas négliger de voir les boutiques de corail, Marseille étant la seule ville de France où l'on sache bien travailler le corail. " Tournefort, de passage à Marseille, en 1700, y avait admiré la taille du corail : " Les boutiques des marchands de corail, écrivait-il à Pontchartrain..., méritent d'être vues avec soin. On ne trouve des marchands de corail qu'à Marseille et à Gênes ; ceux de Marseille en débitent beaucoup plus... Celui que l'on pêchait (dans l'antiquité) sur les côtes de Provence, autour des îles d'Hyères et sur les côtes de Sicile, était le plus recherché. On en pêche encore dans ces quartiers-là, mais la plus grande partie vient du Bastion de France... Le corail travaillé se vend 5 francs l'once. "
Au début du XVIIIe siècle, sans doute à cause de la décadence de la pêche à la Calle, peut-être lorsqu'elle était entre les mains de la Compagnie des Indes, l'industrie du corail disparut de Marseille et passa en Italie, à Gènes d'abord, puis à Livourne. Au milieu du XVIIIe siècle, une ou deux maisons de Marseille seulement achetaient aux enchères tout le corail de la Compagnie pour le revendre aux Italiens.
" Cette vente, disaient les directeurs dans un mémoire de 1767, se fait ordinairement aux enchères deux fois l'an, chacune de 80 jusqu'à 100 caisses, elles sont assorties en branchettes, assorti et menu. La caisse branchettes doit peser cent livres net poids de table, elle est évaluée à 2.200 livres. La caisse assortis pèse 150 livres net, évaluée à 1.800 livres. La caisse menus pèse 150 livres net, est évaluée 950 livres. La Compagnie ne reçoit pas des offres au-dessous de ces prix ; la demande de cet article et l'opinion des acheteurs décident du bénéfice de chaque vente ; il en a été fait au prix fixé et d'autres ont été poussées jusqu'à 40 % de bénéfice. Les acheteurs sont en petit nombre ; dans l'intervalle d'une vente à l'autre, il ne s'en présente aucun pour des petites parties ; il y a longtemps que MM. Joseph et Georges Audibert et MM. Timon et Chaudière sont les seuls négociants qui font des offres aux enchères pour la partie entière, ils spéculent sur le corail... on se plaint depuis quelque temps, en Italie, de la qualité et de l'assortiment du corail de la Compagnie ; ces plaintes peuvent être fondées. Les mers de la Calle doivent être épuisées. "
La Compagnie cherchait alors à entrer directement en relations avec les fabricants italiens, mais sans succès, et l'achat du corail finit par devenir un monopole des frères Audibert, associés à une maison de Livourne. Dans un mémoire de 1774, ceux-ci faisaient ressortir les avantages de cette situation pour la Compagnie et la nécessité de la rendre plus stable en contractant un long bail.
" Tant que ce commerce sera exposé de passer d'une main à l'autre, disaient-ils, il essuiera des variations continuelles, comme on l'a éprouvé ; Il y a des exemples d'une baisse subite de 20 à 30 %, sans autre motif que la concurrence des vendeurs ou l'accord des fabricants, double inconvénient que l'on prévient lorsqu'il n'y a qu'un seul magasin... Ce n'est que depuis que nous nous sommes conduits sur ce principe que les coraux ont augmenté de valeur et qu'on les vend avec une prime. Autrefois, la Compagnie... n'est jamais parvenue à le vendre en totalité que lorsque nous avons acheté pour la Compagnie des Indes, qui en consommait au-dessus des 3/4, et le 1/4 restant a toujours rempli les besoins des fabricants d'Italie. Aujourd'hui, la ressource de la Compagnie des Indes nous manque, il faut en chercher d'autres, soit en faisant fabriquer en ouvré, soit en envoyant nous-mêmes du brut en Chine et dans l'Inde et surtout en tenant ferme avec les corailleurs italiens et leur laissant ignorer la quantité que nous en avons et, s'il se pouvait, le prix que nous payons ; notre ami de Livourne achète près de 200.000 piastres de corail ouvré, c'est ce qui seul peut nous favoriser dans la vente du brut. Au reste sur les 200.000 d'ouvré acheté par l'ami de Livourne, il n'y a pas pour 50 caisses de corail du Bastion dont la couleur n'est pas assez vive, elle est au contraire d'une couleur de rose gai et badin, propre seulement pour Chine. "
Les Audibert conclurent, en effet, un bail pour cinq ans et restèrent les acheteurs de la Compagnie jusqu'en 1780, offrant des primes variant de 7 à 22 %, en sus de la mise à prix des enchères. Cependant, ils se plaignirent, à diverses reprises, de l'irrégularité et de la défectuosité des assortiments qui leur étaient vendus ; ils achetaient, en effet, les caisses telles qu'elles venaient de la Calle, sans les ouvrir, et les envoyaient à Livourne encore scellées du plomb de la Compagnie. Mémoire des sieurs J. et G. Audibert, adjudicataires des coraux du Bastion. 1780. On y trouve un tableau des livraisons faites aux Audibert de 1770 à 1779. Total des 10 années: 693 caisses de branchettes. 262 caisses d'assortis, 634 caisses de menus.
Grâce aux Audibert et à leur correspondant, cette dernière ville avait tout à fait supplanté Gênes pour le travail et le commerce du corail, comme le constatait un mémoire de 1780 :
" Au moyen de l'acquisition des coraux de la Compagnie, cette maison de Livourne, ayant en mains la grande partie du corail qui entre annuellement dans le commerce, est parvenue à rendre cette branche presque exclusive à cette ville.... Les bons ouvriers en ce genre se sont donc formés à Livourne, et le travail y est assez abondant et assez bien payé pour leur procurer une honnête subsistance. Il est assez extraordinaire que les négociants français se soient ainsi laissé enlever un commerce qui est bien plus à leur portée.... Il y a encore des personnes qui le cultivent et qui y trouvent un profit fort honnête, quoiqu'ils ne le suivent qu'en petit, soit par la faiblesse de leurs moyens, soit à cause que le corail qui est apporté au marché par les pêcheurs catalans et français, qui s'adonnent à cette pêche, n'est pas en grande quantité et que le produit de nos mers n'est pas abondant. Nonobstant cela, la petite ville de Cassis subsiste en partie des bénéfices de ce commerce et l'on y compte deux ou trois maisons qui le suivent et le font avec quelque succès. "
En 1780, un négociant, Miraillet, eut l'honneur de vouloir enlever à Livourne l'industrie du corail pour la ramener à Marseille.
" Il serait facile, disait-il, dans un mémoire où il exposait son plan, d'attirer des ouvriers de Livourne.... Le déplacement d'un ouvrier de ce genre est d'autant plus facile que l'attirail le plus complet des instruments nécessaires à son travail, ne vaut pas plus de 10 louis et qu'il peut sen procurer partout de fort bons à ce prix. Il s'agit actuellement de fixer les fonds pour cette entreprise ; on pense qu'en temps de paix un fonds de 200.000 à 300.000 livres serait suffisant parce que le débouché de cette marchandise, soit brut, soit fabriqué, étant alors extrêmement courant, les fonds de la société seraient en circulation continuelle et les ventes feraient successivement fonds pour les achats. D'ailleurs, au moyen d'un crédit bien établi de 100 ou 200.000 livres qui suppléerait aux accidents, il est impossible que l'entreprise souffrit le moins du monde. Les circonstances actuelles de guerre ne permettent pas de bâtir sur un fonds aussi peu solide, les débouchés étant interceptés.... il faudrait au moins un fonds de 600.000 livres.... Les débouchés de cette marchandise sont très nombreux et, outre la Chine et l'Inde, dont le commerce est en souffrance pour le moment, il en faut pour toute la Guinée, pour différentes échelles du Levant, pour l'Allemagne et la Pologne. D'ailleurs, les Anglais seraient bien forcés d'en faire acheter ici, pour fournir à leur commerce dans les Indes Orientales et à la Chine où ils feraient passer aisément par la voie du Caire, comme cela se fait actuellement à Livourne. Ainsi l'on regarde le fonds de 800.000 livres comme surabondant au besoin de l'entreprise.... Au surplus, cette entreprise est purement mercantile et doit être traitée comme telle avec toute l'économie et l'ordre qu'une maison en commandite doit mettre dans ses affaires. Il suffit d'un homme pour diriger et conduire et celui que l'on proposerait est tel que l'on peut le désirer; c'est à son activité et à sa pénétration que l'on doit les connaissances qui ont donné l'idée de ce plan et qui en font la base, et son honnêteté est encore au-dessus de son intelligence et de ses talents. "
Celui que vantait ainsi Miraillet, c'était sans doute Jacques Remuzat, avec lequel il s'associa, en effet, pour fonder sa manufacture et qui en fut le directeur. Miraillet à de La Tour, 23 avril 1781 : " Dès que j'ai pu présumer ne plus trouver d'obstacles dans ce projet de manufacture, j'ai jeté les yeux sur M. Jacques-Vincent Remuzat, ancien courtier de la Compagnie, que vous honorez de votre estime et qui joint à beaucoup d'honnêteté une intelligence dans cette partie et des lumières qu'il m'a communiquées.
La Compagnie fut heureuse de faire un bail avec la société Miraillet, Remuzat et Cie à laquelle elle s'engagea à vendre tous ses coraux, pendant dix ans. De leur côté, Miraillet et Cie avaient besoin de s'entendre avec la Compagnie pour créer leur manufacture. Ils avaient fait un marché à long terme pour l'achat des coraux de diverses pêcheries de la Méditerranée, mais Ils avaient besoin aussi des coraux de la Compagnie qu'il fallait pouvoir mélanger avec les autres, parce qui ils avaient des couleurs qu'on ne trouvait pas dans les autres pêcheries. - Remuzat avait pris une part active la conclusion de l'affaire, puisque la Compagnie lui alloua 1 % de courtage.
Le ministre, de Castries, approuvait fort cette combinaison et se flattait qu'on parviendrait bientôt à priver Livourne d'une branche de commerce dont elle était en possession depuis longtemps. Il avait même été question que la Compagnie prit un intérêt dans la nouvelle entreprise, mais les directeurs y renoncèrent pensant que cela pourrait être un embarras. La combinaison aurait pu cependant être heureuse. Elle aurait au moins évité à la Compagnie les contestations assez vives qui s'élevèrent entre elle et la société Miraillet, au sujet des assortiments de corail qu'elle lui vendait.
Le directeur principal, Bertrand, se plaignait amèrement, en 1784, des exigences de Miraillet et Remuzat. " Je vois, écrivait-il à l'intendant de La Tour, une réclamation de plus de 50 % sur les coraux que ces messieurs ont reçus et doivent recevoir, et je ne puis me rendre et donner les mains à une avanie de cette espèce. Je ne puis pas vous dire au surplus la triste impression que m'a faite le dernier mémoire ; le résultat en est le sentiment profond de la dépendance et de la servitude dans laquelle la Compagnie se trouve et qu'on lui fait sentir d'une manière bien dure. " Cependant, les réclamations de Miraillet et Remuzat furent reconnues justes par deux des officiers les plus expérimentés de la Compagnie, Ramel et Don, désignés pour examiner les assortiments de coraux. Une transaction équitable eut lieu et la Compagnie veilla avec plus d'attention à la composition de ses caisses de corail.
Quant à la manufacture, elle eut un plein succès. Miraillet et Remuzat avaient pu faire venir un certain nombre d'ouvriers de Livourne, malgré les obstacles mis par le grand-duc de Toscane à leur départ. Ils eurent bientôt 157 ouvriers (hommes ou femmes en grand nombre, dont 30 Français. 29 Italiens, 27 apprentis, 11 ouvriers travaillant en ville, 16 ouvriers attendus de Livourne, 35 enfants d'ouvriers vivant dans la manufacture, 4 polisseurs, 3 commis au bureau, 1 médecin et 1 apothicaire.) et, quelques années après, jusqu'à 300. Cependant, malgré l'appui de l'intendant de La Tour, ils ne purent obtenir pour leur fabrique le titre de manufacture royale qu'il sollicitaient.
De Calonne à La Tour. 9 septembre 1784. Il a lu avec plaisir les détails satisfaisants sur la manufacture de corail qu'il a établie à Marseille. " J'accepte avec reconnaissance l'offre que vous voulez bien me faire, pour mon cabinet d'histoire naturelle, d'une Collection des différentes qualités de coraux qui se pèchent dans la Méditerranée. "
Au moment où la Révolution allait amener la disparition de la Compagnie d'Afrique, la manufacture de corail de Marseille était en pleine prospérité, malgré tous les efforts que n'avaient cessé de faire les Livournais pour la faire tomber.
Dans un mémoire rédigé pour solliciter le renouvellement de son bail, en 1791, Remuzat écrivait :
" Les Livournais, jaloux des succès d'un établissement que je leur ai enlevé et qu'une ancienne possession leur faisait regarder comme leur propriété, n'ont cessé de m'opposer des obstacles pour en arrêter le cours; ils ont récemment fait répandre parmi mes ouvriers, dont plusieurs sont de leur nation que, l'époque de l'expiration du bail que j'ai avec la Compagnie d'Afrique devant arriver dans quelques années, ils me remplaceraient dans l'achat du corail qui fait la base de mes travaux et que la chute de mon établissement ferait cesser les avantages dont je les fais jouir. "
Le corail était le seul des produits des Concessions apportés à Marseille qui ne fût pas consommé dans le royaume. Quelques pièces rares étaient achetées par des amateurs comme curiosités. " La pièce la plus remarquable que j'aie, écrivait le naturaliste Tournefort à Pontchartrain, est un morceau de corail rouge de demi-pied de haut. " D'après un autre naturaliste, Desfontaines, des pièces de beau corail étaient payées jusqu'à cent louis. Mais la mode féminine délaissait, ou connaissait peu, les bracelets et les colliers des fabriques marseillaises. C'est en Barbarie, en Guinée, dans le Levant et aux Indes-Orientales que le corail trouvait ses principaux débouchés.
" Tout se travaille à Marseille, lit-on dans un mémoire de la fin du XVIIe siècle, et se consomme en Barbarie, Salez, Saphis, Tétouan, Levant, Indes Orientales, par la Hollande, Italie, ports de Ponant et encore en Allemagne et au Siam. " D'après Desfontaines, c'est en Egypte qu'on expédiait les coraux les plus précieux pour les faire passer en Asie.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
A SUIVRE
|
|
| LA CIGALE ET LA FOURMI
Versions allemande et française
Envoyé Par Renè
|
C'est bien là où l'on fait la différence économique!!!!!!
VERSION ALLEMANDE
Une fourmi travaille dur tout l'été dans la canicule.
Elle construit sa maison et prépare ses provisions pour l'hiver.
La cigale pense que la fourmi est stupide, elle rit, danse et joue.
Une fois l'hiver venu, la fourmi est au chaud et bien nourrie.
La cigale grelottante de froid n'a ni nourriture ni abri, et meurt de froid.
FIN.
________________________________________________
VERSION FRANCAISE
La fourmi travaille dur tout l'été dans la canicule.
Elle construit sa maison et prépare ses provisions pour l'hiver.
La cigale pense que la fourmi est stupide, elle rit, danse et joue tout l'été.
Une fois l'hiver venu, la fourmi est au chaud et bien nourrie.
La cigale grelottante de froid organise une conférence de presse et demande pourquoi la fourmi a le droit d'être au chaud et bien nourrie tandis que les autres, moins chanceux qu'elle, ont froid et faim.
La télévision organise des émissions en direct qui montrent la cigale grelottante de froid et qui passent des extraits vidéo de la fourmi bien au chaud dans sa maison confortable avec une table pleine de provisions.
Les Français sont frappés que, dans un pays si riche, on laisse souffrir cette pauvre cigale tandis que d'autres vivent dans l'abondance.
Les associations contre la pauvreté manifestent devant la maison de la fourmi.
Les journalistes organisent des interviews, demandant pourquoi la fourmi est devenue riche sur le dos de la cigale et interpellent le gouvernement pour augmenter les impôts de la fourmi afin qu'elle paie "sa juste part".
Des Syndicats, des Partis politiques, des associations de ceci et de cela, organisent sit-in et manifestations devant la maison de la fourmi.
Des fonctionnaires décident de faire une grève de solidarité de 59 minutes par jour pour une durée illimitée.
Un philosophe à la mode écrit un livre démontrant les liens de la fourmi avec les tortionnaires d'Auschwitz ou les capitalistes qui gagnent 4000 € par mois (hors politiciens, bien sur).
En réponse aux sondages, le gouvernement rédige une loi sur l'égalité économique et une loi (rétroactive à l'été) d'anti-discrimination.
Les impôts de la fourmi sont augmentés et la fourmi reçoit aussi une amende pour ne pas avoir embauché la cigale comme aide à ne rien faire.
La maison de la fourmi est préemptée par les autorités car la fourmi n'a plus assez d'argent pour payer son amende et ses nouveaux impôts.
La fourmi quitte la France pour s'installer en Suisse où elle contribue à la richesse économique.
La télévision fait un reportage sur la cigale maintenant engraissée. Elle est en train de finir les dernières provisions de la fourmi bien que le printemps soit encore loin. Des rassemblements d'artistes, de journaleux et d'écrivains du politiquement correct, se tiennent régulièrement dans la maison de la fourmi. Un chanteur compose la chanson : Fourmis, barrez-vous !
L'ancienne maison de la fourmi, devenue logement social pour la cigale, se détériore car cette dernière n'a rien fait pour l'entretenir. Des reproches sont faits au gouvernement pour le manque de moyens de la cigale qui bien sur continue sur sa voie d'assistée.
Une commission d'enquête est mise en place, ce qui coûtera 10 millions d'euros.
La cigale meurt d'une overdose de.... oisivité professionnelle dont elle touchait la pension.
Des journaux bien pensant, commentent l'échec du gouvernement à redresser sérieusement le problème des inégalités sociales....
La commission d'enquête rend sa Conclusion : il faut plus d'assistance, plus d'impôts, plus d'oppression sur les fourmis encore en France.
La maison est squattée par un gang, de cigales et cigalons issus d'une catégorie inclassable socialement dont le politiquement correct interdit la prononciation.
Le gang organisent un trafic de marijuana, des cellules de combats, des révoltes urbaines, des feux de joie avec des voitures... et terrorisent les bonnes communautés des fourmis ...
Le gouvernement se félicite de la diversité multiculturelle du pays qui s'appelle encore la France sans séparer le bon grain de l'ivraie.
MORALE FRANCAISE....
Le politiquement correct
et le bordel médiatique
favorisent la réussite du fiasco.
FIN...!
|
|
|
|
Envoyé par Mme Marquet et M. Mayens
 Une grande figure d'un passé qui nous est cher vient de disparaître. Il a «perdu son dernier combat » dans la nuit du 8 au 9 mars 2012. Il restera pour nous le modèle du Français qui aura consacré sa vie militaire et civile.
Une grande figure d'un passé qui nous est cher vient de disparaître. Il a «perdu son dernier combat » dans la nuit du 8 au 9 mars 2012. Il restera pour nous le modèle du Français qui aura consacré sa vie militaire et civile.
Issu d’une famille catholique de militaires originaire de l’Aude, le Lieutenant-Colonel Armand Bénésis de Rotrou est né en 1932 à Bône en Algérie, dans le Constantinois, où son père sert comme capitaine au 3° régiment de tirailleurs algériens.
A partir de 1938, il passe son enfance dans le centre et l’est de la France, au gré des mutations de son père, de la guerre et de l’Occupation, puis poursuit des études secondaires avec l’idée de devenir soldat.
A la suite d’une défaillance auditive remontant à l’enfance qui l’empêchera d’intégrer une école militaire, il devient officier de réserve et est volontaire pour combattre en Algérie, avec un double objectif : servir son pays et, suivant l’exemple familial, devenir officier d’active. Aspirant, il arrive en Algérie en avril 1956 et commande une section de combat, puis une unité de harkis.
Sous-lieutenant à la fin de la même année, il est nommé lieutenant fin 1958.
En août 1959, désigné sur sa demande officier adjoint au commando musulman de Saïda, le prestigieux commando « Georges » créé par le colonel Bigeard, le lieutenant « Armand » (son nom de guerre à Saïda) y reste plus de deux ans au bout desquels, en raison de sa participation sur ordre de son supérieur à l’O.A.S., il est, pour échapper à l’arrestation, muté précipitamment dans le Constantinois, à la tête d’une compagnie de combat isolée et d’un tandis que son chef ? le fameux Georges GRILLOT, abandonnait et sacrifiait ses hommes pour faire carrière et terminer général. Nous garderons l’image d’un camarade simple et modeste comme tous les authentiques héros, d’un PUR FRANÇAIS fier d’avoir fait son devoir et qui ne REGRETTAIT RIEN.
Après l’indépendance de l’Algérie (2 juillet 1962), il rejoint l’école d’application de l’infanterie de Saint-Maixent (Deux-Sèvres), où il entre major de sa promotion et est activé en octobre 1962.
Il sert dans l’infanterie en Algérie et en France jusqu’en juillet 1966 puis, volontaire pour servir à la Légion étrangère, il rejoint le 2° Régiment Etranger d’Infanterie stationné au Sahara.
Au début de 1968, et pour cinq ans et demi, il est muté au prestigieux 2° Régiment Etranger de Parachutistes avec lequel il participe à la campagne du Tchad pendant laquelle il est, en juillet 1969, nommé capitaine. De 1973 à 1979, il sert successivement au 1er régiment étranger à Aubagne et au 3° régiment étranger d’infanterie en Guyane. Il est chef de bataillon depuis juillet 1977. Début 1979, étant astreint à effectuer un « temps d’état-major », il quitte à regret la Légion Etrangère pour servir, jusqu’en 1983, à la 5° division blindée en Allemagne. Il est nommé lieutenant-colonel en juillet 1983.
La même année, il quitte l’armée sur sa demande et poursuit une deuxième carrière civile à l’étranger.
Parachutiste depuis mai 1954, deux fois blessé, le Lieutenant-Colonel Bénésis de Rotrou est titulaire de six citations. Le trente avril 2005 lors de la célébration du combat de Camerone, sur la voie sacrée de la maison mère de la Légion Etrangère à Aubagne, devant le front des troupes et des milliers de sympathisants, il est décoré de la croix de commandeur de la Légion d’honneur, juste témoignage de la nation envers cet officier ayant consacré sa vie à l’armée de la France, SA PATRIE.
Retiré dans le Midi, le lieutenant-colonel Bénésis de Rotrou participe à la vie de nombreuses associations. Auteur du livre Commando "Georges" et l’Algérie d’après qui a obtenu les prix "Armée et défense" 2009 de l’U.N.O.R. et "Histoire militaire" 2010 du Cercle Algérianiste, il est cité par les médias, publie des articles, tient des conférences.
Armand BENESIS DE ROTROU nous a quittés dans le courant de ce mois de Mars, tellement tragique pour nous.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 16 mars, à 9 heures, à Cannes, en l’église N-D des Pins.
================
©§©§©§©§©§©§©
|
|
|
RESTAURATION DE TOMBE
Voici une nouvelle tombe restaurée dans notre cimetière.
M. Aldo Riboni a confié cette tâche à notre entrepreneur et ami, Mounir Hanéche qui comme d'habitude a mené à bien ce travail. C'est la seule façon d'entrenir notre cimetière et d'exprimer notre respect pour notre mémoire restée là-bas. Faites le savoir autour de vous et cela ne coûte pas grand chose pour des familles réunies.
Merci Mrs Riboni et Hanéche.
Tombe avant travaux

Tombe après travaux

Ces photos sont protégées par un copyrigth et ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
--------------------
|
De Mme Joanna Dron
Bonjour,
J’ai épousé en 1966 Gérard DRON, né en 1942 à Souk Ahras, résidant à Bône. Son père, Raoul Dron, travaillait à la SNCFA. Sa famille habitait aux Mille Logements. Gérard est resté très secret sur sa vie en Algérie de 1942 à 1962, il est décédé l’année dernière, et nos enfants, adultes maintenant, souffrent de ne pas en savoir plus. L’auriez vous connu ? C’est une bouteille à la mer...
Les quelques mots prononcés par mon fils ainé aux obsèques de son père m’ont bouleversée : il évoquait son appartenance à trois cultures, ses regrets de ne pouvoir faire sienne celle de son père par manque d’informations...
Je sais que Gérard a fréquenté une école technique du bâtiment tout corps d’état à Bône. Je connais quelques détails sur sa vie à Bône, les journées à la plage, les promenades sur le cours Bertagna, des anecdotes de la vie de famille, mais pas de noms, pas de références, pas de relations, en un mot, pas grand chose !
Je vous remercie encore d’avoir pêché cette bouteille lancée sur le web et si vous pouvez nous apporter cette aide sur le passé de Gérard, vous nous feriez le plus grand bien.
Toutes mes amitiés
Joanna Dron
Mon adresse : joanna.dron@free.fr
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
M. Gilles Martinez et son site de GUELMA vous annoncent la mise à jour du site au 1er Mars 2012.
Son adresse: http://www.piednoir.net/guelma
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
Le Guelmois
M. Robert Antoine et son site de staoueli vous annoncent une mise à jour du site au 1er Mars 2012, avec présentation du nouveau Blason.
Son adresse: http://www.piednoir.net/staoueli
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
Le Guelmois
| |
| Lessive OMO, cerveau BABA
Envoyé par Chantal
| |
|
.
Alors que son gynécologue vient de lui annoncer qu'elle est enceinte, une jeune femme s'écrie :
- Docteur, c'est une catastrophe !
D'après les dates, le père n'est pas mon mari, mais mon amant, et il est de couleur !
Vous imaginez le scandale si je mets au monde un enfant de couleur ?
Je préfère avorter.
- Il y a peut-être une autre solution, madame.
Vous allez chaque matin prendre un bain de siège dans une eau tiède additionnée de trois cuillers à soupe d'Omo.
- Et vous pensez que j'aurai un enfant blanc ?
- J'en suis certain.
Effectivement, huit mois plus tard, la dame donne naissance à un superbe bébé à la peau laiteuse.
Un an s'écoule et la femme se retrouve à nouveau chez son gynécologue :
- Docteur, je suis allée passer quelques jours avec mon amant de couleur, et j'ai oublié de prendre la pilule. Je suis à nouveau enceinte.
- Eh bien, madame, vous allez refaire le traitement qui vous a si bien réussi : bain de siège quotidien dans une eau tiède additionnée de trois cuillers d'Omo.
Et elle accouche d'une petite fille à la peau parfaitement blanche.
Dix huit mois passent, et la dame, décidément incorrigible, se retrouve à nouveau enceinte de son amant de couleur..
"Inutile, se dit-elle, d'en parler au gynécologue, je connais la recette."
Et ponctuellement, chaque matin, elle prend un bain de siège dans une eau additionnée de trois cuillers d'Omo.
Huit mois plus tard, scandale : elle met au monde un adorable bébé bien coloré.
- Je ne comprends pas, dit-elle au médecin, j'ai pourtant pris quotidiennement le bain de siège que vous m'aviez prescrit pour les deux autres.
- Madame, vous auriez dû m'en parler !
Vous avez commis une erreur.
Omo lave deux fois plus blanc, pas trois !
|
|
|